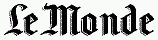
DOSSIER
VENDREDI 16 MAI 2003
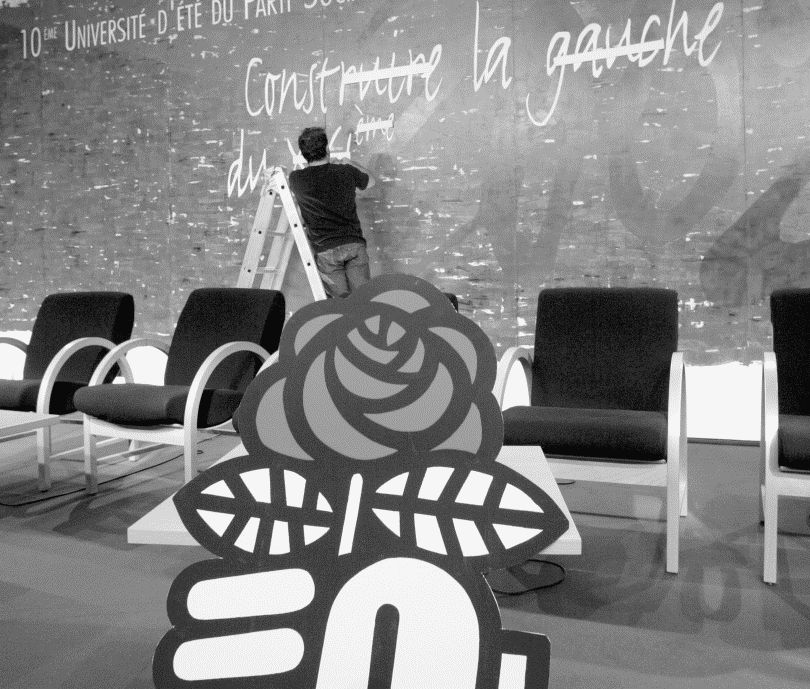
(L’université d’été du Parti socialiste, août 2002, à La Rochelle)
QUEL
SOCIALISME
DEMAIN ?
Réuni en congrès à Dijon du 16 au 18 mai, le Parti socialiste est
placé devant de multiples défis. L’échec de Lionel Jospin, le 21 avril 2002, a refermé
le cycle ouvert par François Mitterrand au congrès d’Epinay, trois décennies plus tôt.
Tout est à reconstruire: une base sociale plus large et plus jeune, dans un parti où
les moins de 40 ans ne constituent que 14% des effectifs, un projet capable de répondre
aux attentes des Français, une nouvelle stratégie de reconquête du pouvoir, le choix
d’un(e) présidentiable pour l’avenir.
Mais quel avenir ont le socialisme et la social-démocratie ? Le débat fait rage en
Europe. En question: leur capacité à réformer la société face à la mondialisation et aux
mutations structurelles et sociales. |
L E S O C I A L I S M E
E N F R A N C E
Quatre lignes de fracture au sein du PS
| <> Meeting du Nouveau Parti
socialiste en octobre 2002, à la Sorbonne, à Paris. La motion du courant animé désormais
par Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, Julien Dray s’étant depuis rallié à François
Hollande, a recueilli 16,7% des mandats. |
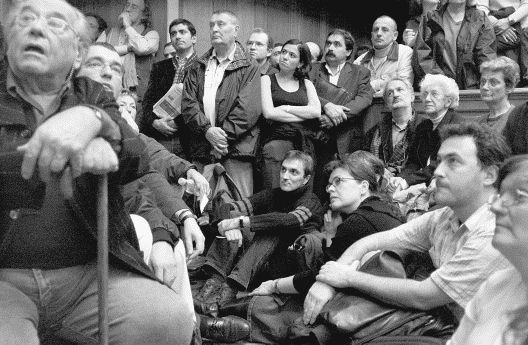 |
quelle mondialisation ? Quelle europe ? quelle république ?
quel parti socialiste ? derrière ces quatre débats, une grande question: quel
socialisme pour demain ?
CENT onze pages en petits caractères. Les 5 motions soumises au vote des militants
ont succédé à 18 contributions générales et 140 contributions thématiques: sur
l’Europe, l’immigration ou le féminisme…
Temps réels, la section des internautes du PS, a fait les comptes: les
militants attentifs auront parcouru, en additionnant le tout, une petite encyclopédie de
la «pensée socialiste au début du troisième millénaire». Ces internautes ont
repéré, dans le corpus des motions, 19 occurrences du mot Internet. Plus que les 15 du
mot «ouvrier», qui, notent-ils, «semble disparaître du vocabulaire». Reste
«salariés» (144 références). Après tout, écrivent-ils, le choix des mots
indique «l’importance qu’accordent les motions à tel ou tel enjeu».
| |
Comment réinventer l’union des gauches
Le désarroi des communistes et l’immaturité des Verts privent les socialistes de
partenaires solides
PLUS que jamais depuis trente ans, le Parti socialiste constitue le socle de la
gauche. Avec 24,3%des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives de
juin 2002, il rassemble les deux tiers du vote de gauche. Mais, plus que jamais, il est
seul, privé de partenaires solides: le Parti communiste s’est effondré à 5% et les Verts
ont plafonné à 4,5%. Hégémonique mais isolé, ainsi peuvent se résumer l’impasse dans
laquelle se retrouve le PS et l’obligation où il est, s’il veut reconquérir le pouvoir,
de réinventer une stratégie de rassemblement, de repenser une gauche en miettes.
Le constat, en effet, n’a pas changé depuis 1971: «Le PS ne peut réussir seul»,
notait François Hollande au début de l’année. Hormis les élections législatives
organisées en 1981 et 1988 dans la foulée de présidentielles gagnées par François
Mitterrand, son parti n’a jamais dépassé la barre des 25% au premier tour, y compris en
1997, lorsqu’il l’emporte sur la droite. Les socialistes sont donc contraints de
s’inscrire dans des démarches d’alliances.
La matrice initiale de l’union de la gauche entre PS, PCF et radicaux de gauche n’a
pas résisté longtemps à la concurrence entre les deux principaux partenaires, les
communistes rompant l’union, dès l’été 1977, sans parvenir pour autant à conserver leur
prééminence aux législatives de 1978. Mais ils rassemblent encore, à l’époque, 20% de
l’électorat, et disposent de puissants relais locaux et syndicaux. La dynamique
présidentielle de François Mitterrand gommera, en 1981 et plus encore en 1988,
l’affaissement des communistes vers la barre des 10% de l’électorat – où ils se
maintiendront jusqu’en 1997.
Or l’émergence des écologistes au début des années 1990, puis le rapprochement
entre les Verts et les socialistes au sein de la «gauche plurielle», sont loin d’avoir
compensé l’étiolement communiste. Pis, malgré la victoire de 1997 et une législature de
gouvernement en commun, la gauche plurielle a explosé à la présidentielle de 2002,
chacune de ses composantes (socialistes, communistes, Verts, radicaux de gauche et
chevènementistes) reprenant sa liberté et dispersant les voix de gauche jusqu’à
contribuer à l’échec de Lionel Jospin.
UNE UMP DE GAUCHE
Tout est donc à reconstruire. Or les bases sont fragiles. L’objectif que se fixe le
PS de «fidéliser 30% de l’électorat» est loin d’être à portée de main. Quant à ses
partenaires historiques, ils sont dans un triste état. Les congrès récents des Verts à
l’automne 2002, puis du PCF au printemps, ont témoigné, de façon pathétique, de
l’immaturité des premiers, égarés dans d’incessantes querelles tribales, et du désarroi
des seconds, déprimés et en pleine crise d’identité. Jean-Pierre Chevènement a rejoint un
improbable Aventin. Quant aux radicaux de gauche, ils sont satellisés depuis belle lurette.
Envisager, comme le fait François Hollande, des candidatures communes à toutes les
élections, sur la base d’un programme commun en bonne et due forme, préfigure à demi-mots
la réunification de l’ensemble des gauches sous la houlette du PS, à l’instar de la
droite avec la création de l’UMP. Reste que les clivages idéologiques à gauche, qui plus
est sous la pression de l’extrême gauche, demeurent vivaces. Et qu’un tel chamboulement
du paysage n’est guère concevable que dans la dynamique d’une victoire. La longue marche
de la gauche ne fait que recommencer.
Gérard Courtois | |
Pour nombre de dirigeants socialistes, Dijon devait être un congrès «pour
rien»: aucune élection majeure ne suivait le rendez-vous. Pas de candidat à
désigner, donc. Mais le traumatisme du 21 avril 2002, son impact sur les Verts et le PCF,
un PS «inaudible» face à une droite active, ont changé la donne. Une campagne interne –
remportée par François Hollande – a animé le parti, dont les débats, innombrables, ont
tourné autour de la question: où va le socialisme ?
♦ La mondialisation. Elle est citée 150 fois, accompagnée de verbes
d’action – «combattre», «refuser», «réguler» –, dans les textes préparatoires. Dans ce
domaine particulièrement, les socialistes cherchent un nouveau «logiciel», et Porto
Alegre devient la référence obligée. Mais «il ne suffit pas de faire un petit tour
devant les caméras et de repartir aussi vite», assène la motion du courant Nouveau
Monde (Emmanuelli-Mélenchon). Si les objectifs sont partagés, les recettes, elles,
continuent de diverger. Sur les licenciements, là où la motion Hollande reprend une bonne
partie des mesures appliquées par le gouvernement Jospin (ou seulement envisagées, comme
les pénalités pour les entreprises à forte main-d’œuvre précaire), Nouveau Monde suggère
la création d’un «veto social» aux licenciements boursiers et le Nouveau Parti
socialiste (NPS) des «sanctions dissuasives» contre les délocalisations.
♦ L’Europe. Elle est devenue l’un des sujets de débat les plus saillants.
La guerre d’Irak a ajouté à la division. Il y a pourtant un socle commun: tous les
socialistes se disent «fervents européens» et désormais «fédéralistes» –
une évolution notable. «En 1994, quand je parlais de fédéralisme, on me traitait de
doux rêveur», note Henri Emmanuelli. Lequel pose ses conditions. «Quitte à
provoquer une crise» européenne, sa motion propose que «les socialistes fassent
d’une réforme des institutions politiques de l’Europe, de l’adoption d’un vrai traité
social et de l’accord des peuples concernés les conditions préalables à tout
élargissement». Cette position rejoint celle du NPS. Son chef de file, Arnaud
Montebourg, qualifie l’élargissement de «projet authentiquement libéral» et
réclame un référendum.
François Hollande juge cette attitude «irresponsable». «On ne peut revenir en
arrière. Refuser l’élargissement serait perçu comme un geste de défiance envers les pays
concernés», ont martelé ses partisans. Leur texte propose d’aller «jusqu’au bout de
la logique fédérale» dans une Europe où les décisions à la majorité deviendraient «la
règle». Le référendum serait réservé à la ratification, en 2004, de la Constitution.
♦ Les institutions. Presque tous les socialistes sont désormais d’accord
pour durcir les règles de non-cumul des mandats, renforcer les pouvoirs du premier
ministre et des parlementaires et réformer le Sénat. Mais seuls Nouveau Monde, le NPS et,
dans une moindre mesure, Marc Dolez, se sont clairement prononcés pour une VIe République.
Arnaud Montebourg, avec ses clubs de la «C6R», a toutefois retiré de son texte la
suppression du suffrage universel de l’élection du président de la République.
| Le choix des mots
indique «l’importance qu’accordent les motions à tel ou tel enjeu» |
♦ Le parti. Où va-t-il ? Et avec qui ? Ces questions se placent
dans un contexte où près de 20 000 nouveaux adhérents (sur 129 500) ont rejoint
le PS après le 21 avril 2002. Les opposants de François Hollande ont tenté, jusqu’au
bout, de jouer la carte «il faut sortir les sortants». La motion Dolez exigeait
que les représentants dans les instances nationales soient, pour moitié, désignés par
les fédérations, et non plus en fonction du poids proportionnel des courants. Sur ce
point, ils ont échoué.
Dans le même contexte se situe le débat sur la recomposition de la gauche. François
Hollande et ses partisans ont défendu un rassemblement dont le PS serait le pivot,
«sans complexes» vis-à-vis de l’extrême gauche. Ses opposants ont plaidé pour une
vision élargie à la «gauche mouvementiste». Jean-Luc Mélenchon brocardait encore,
le 10 mai, la peur vis-à-vis d’«Olivier Besancenot et de sa bicyclette». Par leur
vote, les militants ont, là encore, tranché. Le premier secrétaire s’est engagé à faire
du PS un parti «plus ouvert», plus représentatif de «toutes les couleurs de la
France». Sans chasser ni les ministres de Jospin ni les éléphants…
Isabelle Mandraud

| |
Le PS depuis Epinay, les données de base du socialisme en France et en Europe.
1971-1975: l’unité
Trente-deux ans après, même les mythes ont du mal à survivre. Il en est ainsi du «congrès
de l’unité des socialistes», réuni, en juin 1971 à Epinay-sur-Seine, pour célèbrer
l’unification de la famille socialiste. «Ce congrès mythique fut en réalité très
confus», se souvient Pierre Mauroy. Refondateur, il marquait la fin d’une longue
marche vers l’unité. Créée au moment de la candidature de François Mitterrand à
l’élection présidentielle de 1965, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste
(FGDS), groupant SFIO, radicaux, Convention des institutions républicaines (CIR) et
divers clubs, est emportée par la tempête de 1968. Le 4 mai 1969, la SFIO de Guy Mollet
se transforme, avec le renfort de l’Union des clubs pour le renouveau de la gauche (UCRG)
d’Alain Savary, en Nouveau Parti socialiste. Gaston Defferre, candidat à l’élection
présidentielle. n’obtient que 5,01%. Un désastre.
MITTERRAND «IMPERATOR»
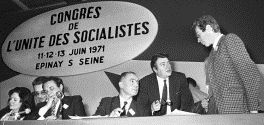 | <> Congrès d’Epinay, juin 1971.
Pierre Mauroy et
Pierre Joxe (à droite). |
Pourtant, la marche vers l’unité reprend. Du 11 au 13 juillet 1969, au congrès
d’Alfortville, ce sont les amis de Jean Poperen, ancien du PCF et du PSU, l’Union des
groupes et clubs socialistes (UGCS), qui rejoignent le PS. Avec la complicité de Guy
Mollet, Alain Savary est élu premier secrétaire, battant d’une voix Pierre Mauroy. Il
ne manque que les conventionnels (10 000) de François Mitterrand, l’ancien président
de la FGDS. Face à 70 000 socialistes, le député de la Nièvre arrive minoritaire, il
en sort majoritaire, imperator. Officiellement, l’unité étant acquise, l’enjeu du congrès
d’Epinay, qui se tient du 11 au 13 juin 1971 devant 957 délégués – 800 socialistes, 97
anciens de la CIR et 60 inorganisés –, porte sur l’union de la gauche. Cinq motions sont
en lice, mais la fracture essentielle est entre Savary et Mitterrand. Le premier, soutenu
par Guy Mollet et Jean Poperen, fait de la poursuite d’un dialogue idéologique avec le PC
et des garanties qu’il doit donner sur le respect de l’alternance, un préalable à un
accord de gouvernement. Le second, allié avec Gaston Defferre, et sa fédération des
Bouches-du-Rhône, et le Ceres de Jean-Pierre Chevènement, veut négocier un programme
commun. Les divergences sont minces, Roger Quilliot et Gaston Defferre prêchent la
fusion. En vain. En réalité, l’enjeu est le pouvoir. François Mitterrand veut tourner la
page Guy Mollet. Il multiplie les gages sur sa conversion au socialisme en proclamant que
«celui qui ne consent pas à la rupture avec la société capitaliste (…) ne peut être
adhérent au PS». Avec 51,26%, l’avocat de la «réforme de nature révolutionnaire»
l’emporte sur Savary. Il pousse Pierre Mauroy à la tête du PS. Mais celui-ci juge que
«le premier des socialistes dans le pays doit prendre la responsabilité d’être le
premier dans le parti». Le 16 juin, Mitterrand est élu premier secrétaire par le
comité directeur. Ancien conventionnel, Henri Emmanuelli rejoint le PS. Par le truchement
d’un autre conventionnel, Pierre Joxe, Lionel Jospin, venu du trotskisme lambertiste où
il milite encore, en fait autant à la fin de l’été.
«CHANGER LA VIE»
 |
<> Le programme commun, 27 juin 1972.
Mitterrand, Fabre et Marchais. |
Tout s’enchaîne très vite. Le 11 mars 1972, le PS adopte son programme «Changer la
vie». Le 27 juin 1972, il signe un programme commun de gouvernement avec le PCF de
Georges Marchais auquel se joignent les radicaux de gauche (MRG) de Robert Fabre. Le
surlendemain, à Vienne, devant l’Internationale socialiste, François Mitterrand reprend
un propos esquissé à Epinay: «Notre objectif fondamental c’est de refaire un grand
Parti socialiste sur le terrain occupé par le PCF lui-même afin de faire la démonstration
que sur les 5 millions d’électeurs communistes, 3 millions peuvent voter socialiste».
Après le congrès de Grenoble, en juin 1973, où Savary rejoint la majorité, Mitterrand est
mis en minorité sur l’Europe et, suivi par Jospin, doit menacer de démissionner pour
obtenir gain de cause. Candidat unique de la gauche à la présidentielle de mai 1974,
Mitterrand est battu par Valéry Giscard d’Estaing. Au lendemain de cette défaite, un
jeune énarque, Laurent Fabius, adhère au PS. Un nouveau pas vers l’unité est franchi les
12 et 13 octobre 1974 avec les Assises nationales du socialisme. Il s’agit de faire venir
au PS la mouvance autogestionnaire et chrétienne. Deux anciens secrétaires nationaux du
PSU, Michel Rocard, déjà présent dans l’état-major de campagne, et Robert Chapuis, des
dirigeants de la CFDT (Jacques Chérèque et Jacques Julliard), des chrétiens (Jacques
Delors) s’y engagent. La déclaration finale prône la création d’un «parti des
socialistes», elle reste sans suite. Rocard entre au PS. Au congrès de Pau (février
1975), le Ceres (25%) est exclu de la majorité. Gilles Martinet s’en sépare et présente
un amendement avec les rocardiens qui obtient 15%. Au sein de la majorité mitterrandiste,
le courant Rocard est né.
 | |
Le fantôme de Lionel Jospin et les sept présidentiables
le premier parti de gauche n’a pas de candidat «naturel». Revue des atouts et
des handicaps de ses candidats potentiels
|
TOUT le monde y pense mais personne n’en parle: l’élection présidentielle de 2007 est
l’angle mort du congrès de Dijon. En principe,ce n’est qu’en 2006,à son prochain congrès,
que le Parti socialiste pourrait choisir son candidat à l’Elysée. Pour l’heure, le
premier parti de gauche n’a mis en avant ni candidat «virtuel» ni candidat «naturel».
Même si Laurent Fabius est le seul à n’avoir jamais caché son désir de se présenter
à l’Elysée,il s’abstient soigneusement de toute préannonce. Depuis la refondation
d’Epinay,un seul premier secrétaire en exercice a été investi comme candidat à l’élection
présidentielle: François Mitterrand en 1974 puis en 1981. En 1993,alors premier
secrétaire, Michel Rocard fait figure de candidat «virtuel» mais il est laminé par son
échec aux européennes de 1994. En 1995,Henri Emmanuelli, alors patron du PS, concourt à
une primaire mais est battu par Lionel Jospin. Depuis le 21 avril 2002, et l’élimination
de M. Jospin, le PS est en quête d’un nouveau leader. «Le patron sera le candidat à
l’élection présidentielle»,assurait Vincent Peillon, en juillet 2002. Revue des
atouts et des handicaps de présidentiables.
|
 | <>
LAURENT FABIUS, 56 ans, député de Seine-Maritime, ancien premier ministre.
|
ATOUTS
Le principal atout de Laurent Fabius est d’être d’abord un homme d’expérience. Après avoir
été, en juillet 1984, à 37 ans, le «plus jeune premier ministre» donné par François
Mitterrand à la France, il est, par deux fois, président de l’Assemblée nationale
(1988-1992 et 1997-2000) et premier secrétaire du PS (janvier 1992-avril 1993). Le moins
subliminal des présidentiables socialistes est un très bon orateur, doté de compétences
multiples. Le 1er juin 1997, en Seine-Maritime,il est, avec 73% des voix, le mieux réélu
des députés socialistes. En 2002, il obtient 68,15%. Outre son courant, il dispose d’un
solide réseau dans le monde économique et social. Son intérêt pour les classes moyennes
fait de lui le présidentiable le plus apte à séduire l’électorat centriste.
HANDICAPS
Son principal adversaire,c’est lui-même. Il a encore du mal à convaincre ses camarades de
ses convictions socialistes. A l’automne 1995, il publie un ouvrage Les Blessures de
la vérité (Flammarion), destiné à redresser son image et à défendre son honneur,
durement atteint dans l’affaire du sang contaminé. Mais les plaies du passé sont mal
cicatrisées. Sa nomination, le 27 mars 2000, comme ministre de l’économie, marque la
volonté de réconciliation de Lionel Jospin. Mais quand François Hollande, en juin 2002,
le choisit comme numéro deux du PS,le «TSF» (tout sauf Fabius) resurgit. Dans l’opinion,
il a toujours du mal à décoller: il atteint 42% en mai 2000 dans le baromètre de la
Sofres mais retombe à 32% en mai 2003. Plus âgé que ses principaux rivaux,il est toujours
suspecté d’incarner le «social-libéralisme». Il s’en défend avec constance et vigueur.
Mais le PCF et les Verts continuent à s’en méfier.
|
 | <>
BERTRAND DELANOË, 52 ans, maire de Paris, ancien sénateur.
|
ATOUTS
Depuis son élection comme maire de Paris, il y a deux ans, Bertrand Delanoë est au zénith
des sondages, côtoyant Bernard Kouchner, Jack Lang et Ségolène Royal. Son élection à
Paris, où il a su séduire les «bobos» (bourgeois bohèmes),illustre l’équation de M. Jospin
qui prônait «une nouvelle alliance» entre les classes moyennes et les classes
populaires. Très apprécié des militants, actif dans les campagnes, il a une vision éthique
de la politique. Au nom du non-cumul, il a démissionné de son mandat de sénateur.
HANDICAPS
L’ex porte-parole du PS reste en marge du parti. L’éléphant, un tantinet autoritaire, n’a
pas de troupes. A «100% maire de Paris», il se défend farouchement d’être présidentiable.
En 2007,les municipales précéderont la présidentielle. Sauf si le calendrier change…
|
 | <>
ARNAUD MONTEBOURG, 40 ans, député de Saône-et-Loire, cofondateur du Nouveau Parti socialiste.
|
ATOUTS
Arnaud Montebourg a fait de sa jeunesse et de sa fougue de vrais atouts. Excellent
orateur, brillant avocat, le député de Saône-et-Loire a gardé son siège,conquis en 1997,
en défendant une certaine idée de la morale en politique, avec comme cibles,Jacques
Chirac d’abord et… Roland Dumas. Dans le PS,il a imposé le débat sur la rénovation.
HANDICAPS
Ses détracteurs dénoncent son arrogance et son opportunisme. Il n’a pas conquis les
nouveaux adhérents du PS. Enclin aux dérapages verbaux, l’ancien fabiusien qui se réfère
souvent au parcours de François Mitterrand a affiché son mépris de l’appareil. Le
fondateur de la Convention pour la VIe République, hostile à l’élection du président de
la République au suffrage universel,devrait avoir peu de goût pour la compétition
présidentielle. Sauf si,comme Mitterrand… |
|
 | <>
FRANÇOIS HOLLANDE, 48 ans, député de Corrèze, premier secrétaire du Parti socialiste.
|
ATOUTS
François Hollande a reconquis son pouvoir. En novembre 1997,il doit son élection au
poste de premier secrétaire au parrainage de Lionel Jospin qui,en le choisissant, avait
confié à ses amis: «C’est le meilleur, le plus brillant et le plus politique d’entre
vous». Réélu,en novembre 2000,sous le même parrainage, il devra sa réélection,le 22
mai, à lui-même, ce qui lui confère un supplément de légitimité. Vif et talentueux, il
est très populaire auprès des militants. Bon orateur en meeting,il a un bon palmarès
électoral: sa liste est en tête aux élections européennes de 1999; en 2001, il conquiert
la mairie de Tulle en «chiraquie»; il se fait réélire député de Corrèze en juin 2002.
HANDICAPS
Son horreur des conflits nuit à son autorité au sein du PS. Ses concurrents pointent son
manque de charisme. Sa majorité est hétérogène et, s’il compte quelques fidèles (François
Rebsamen, Michel Sapin, Michel Delebarre), il n’a pas encore de véritable courant. Dans
l’opinion,il souffre d’un déficit de popularité,voire de notoriété. Entré en mars 2000
dans le baromètre de la Sofres sur la cote d’avenir des personnalités politiques avec
30%, il culmine à 38% en janvier 2003. Député depuis quinze ans, il n’a jamais exercé de
fonction gouvernementale. Même s’il était promis à Matignon si…
|
 | <>
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, 54 ans, député du Val d’Oise, ancien ministre.
|
ATOUTS
C’est François Hollande qui avait le mieux défini les qualités de Dominique
Strauss-Kahn, en novembre 2001, au lendemain de sa relaxe dans l’affaire de la MNEF:
«Homme d’idées, homme inventif, homme de projet, homme de réflexion, homme
d’action». M. Jospin fait appel à cet économiste de talent en 1984 pour s’occuper des
études. D’abord ministre de l’industrie, il se révèle pleinement comme ministre de
l’économie (juin 1997-novembre 1999). Défricheur de nouveaux concepts, comme le
«socialisme de production», il réunit rocardiens et jospinistes dans un même
courant, Socialisme et démocratie (octobre 2000).
HANDICAPS
Tel un feu follet,il est insaisissable. S’il sait utiliser ses réseaux, comme la Fondation
Jean-Jaurès ou le club blairiste Policy Network, il paraît souvent dilettante. Les
affaires du PS l’ennuient. Malgré ses bonnes relations avec le PCF, son projet de «parti
de toute la gauche» inquiète. Derrière son «social-réformisme», d’aucuns voient pointer
le libéral. D’après la Sofres,sa cote est moyenne.
|
 | <>
MARTINE AUBRY, 52 ans, maire de Lille, ancien ministre.
|
ATOUTS
C’est une battante,une femme de convictions passionnée et courageuse. Numéro deux du
gouvernement Jospin, elle a porté la réforme emblématique des 35 heures. A l’aile gauche
de la majorité «hollandiste», Martine Aubry, fidèle à M. Jospin, conserve une forte
popularité chez les militants socialistes, en particulier les jeunes. Disposant d’un bon
réseau chez les intellectuels et dans les entreprises, elle défend une vision collective
de la politique, basée sur une mise en mouvement de la société.
HANDICAPS
Sa défaite aux élections législatives de 2002 l’oblige à se reconstruire d’abord
localement, notamment pour garder la mairie de Lille,où elle a succédé à Pierre Mauroy en
2001. Son caractère passionné la dessert aussi, ses détracteurs lui reprochant d’être
trop autoritaire, sur les 35 heures comme sur le projet 2002 du PS. Dans le baromètre
Sofres, elle a culminé à 61% (juillet 1997) avant de chuter (27% en mai 2003).
|
 | <>
HENRI EMMANUELLI, 57 ans, député des Landes, cofondateur de Nouveau Monde.
|
ATOUTS
Tout d’une pièce, sans compromis, Henri Emmanuelli incarne avec passion la gauche du PS.
Rugueux et digne, c’est un homme d’expérience: ancien ministre, ancien président de
l’Assemblée nationale, ancien premier secrétaire du PS. Il est,depuis 1978,
indéboulonnable dans les Landes.
HANDICAPS
S’il rendosse l’habit de présidentiable, comme en 1995, alors sans succès, ce sera pour
faire barrage à Laurent Fabius, dont il a été l’allié en 1994 et 1995, en pourfendeur du
«social-libéralisme». Ses adversaires lui reprochent son sectarisme et voient dans ses
combats autant de revanches sur sa condamnation dans l’affaire Urba.
Michel Noblecourt
|
|
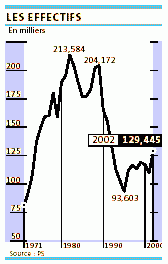 Le nombre des adhérents du PS est rythmée par les élections présidentielles et
législatives et par les événements internes. Avant Epinay, le PS ne compte que
70 392 membres. Dès 1971, le PS est renforcé par 10 000 conventionnels. Il
progresse jusqu’à la défaite législative de 1978 (180 000), rechute ensuite pour
progresser de nouveau avant la présidentielle de 1981. Il atteint son record en 1982 avec
213 584 adhérents. Il baisse de 1983 à 1987, remonte à 204 172 en 1989,
dégringole après le congrès de Rennes en 1990 (165 186) et la défaite de 1993
(113 005), remonte après le retour de Lionel Jospin (111 536 en 1996), et la
victoire législative de 1997 (116 708). Avec 129 445 membres en 2002, le PS se
retrouve sous le niveau de 1974.
Le nombre des adhérents du PS est rythmée par les élections présidentielles et
législatives et par les événements internes. Avant Epinay, le PS ne compte que
70 392 membres. Dès 1971, le PS est renforcé par 10 000 conventionnels. Il
progresse jusqu’à la défaite législative de 1978 (180 000), rechute ensuite pour
progresser de nouveau avant la présidentielle de 1981. Il atteint son record en 1982 avec
213 584 adhérents. Il baisse de 1983 à 1987, remonte à 204 172 en 1989,
dégringole après le congrès de Rennes en 1990 (165 186) et la défaite de 1993
(113 005), remonte après le retour de Lionel Jospin (111 536 en 1996), et la
victoire législative de 1997 (116 708). Avec 129 445 membres en 2002, le PS se
retrouve sous le niveau de 1974.
|
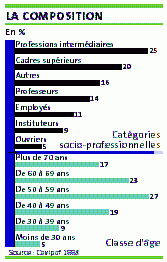 Le PS vieillit. L’étude du Cevipof, réalisée par Françoise Subileau, Colette Ysmal
et Henri Rey, sur les adhérents socialistes en 1998, est la dernière réalisée à une
échelle aussi importante (12 291 réponses à un questionnaire publié dans L’Hebdo
des socialistes). Mais les lecteurs de L’Hebdo sont sensiblement plus âgés que
les militants. Il reste que, par rapport à la précédente enquête de 1985, 67% ont 50 ans
et plus (contre 39%). En treize ans, le PS s’est peu féminisé et les femmes ne
représentent qu’un gros quart des adhérents. Le recrutement en milieu ouvrier faiblit (5%
contre 10%) et celui dans les classes moyennes progresse. Malgré l’obligation statutaire,
35% ne sont pas syndiqués, 24% sont à la CFDT, 12% à la FEN, 6% à la CGT et 6% à FO.
Le PS vieillit. L’étude du Cevipof, réalisée par Françoise Subileau, Colette Ysmal
et Henri Rey, sur les adhérents socialistes en 1998, est la dernière réalisée à une
échelle aussi importante (12 291 réponses à un questionnaire publié dans L’Hebdo
des socialistes). Mais les lecteurs de L’Hebdo sont sensiblement plus âgés que
les militants. Il reste que, par rapport à la précédente enquête de 1985, 67% ont 50 ans
et plus (contre 39%). En treize ans, le PS s’est peu féminisé et les femmes ne
représentent qu’un gros quart des adhérents. Le recrutement en milieu ouvrier faiblit (5%
contre 10%) et celui dans les classes moyennes progresse. Malgré l’obligation statutaire,
35% ne sont pas syndiqués, 24% sont à la CFDT, 12% à la FEN, 6% à la CGT et 6% à FO.
|
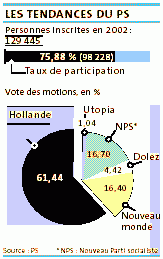 Le résultat des votes sur les motions pour le congrès de Dijon est clair: la motion
de François Hollande l’emporte largement avec 61,44% face aux quatre autres motions. Mais
par rapport au précédent congrès de Grenoble, en novembre 2000, le texte du premier
secrétaire qui s’appuyait sur un rassemblement un peu plus large (avec cette fois Julien
Dray et Marie-Noëlle Lienemann dans son camp) recule de 11,5 points, son opposition,
fragmentée, se renforçant d’autant. Si on met à part le congrès de Rennes, c’est le score
le plus faible pour la direction depuis le congrès de Metz (46,99%). Le score de M.
Hollande se rapproche, sans l’atteindre, de celui obtenu par François Mitterrand, au
congrès de Grenoble (65,35%), où quatre motions s’affrontaient.
Le résultat des votes sur les motions pour le congrès de Dijon est clair: la motion
de François Hollande l’emporte largement avec 61,44% face aux quatre autres motions. Mais
par rapport au précédent congrès de Grenoble, en novembre 2000, le texte du premier
secrétaire qui s’appuyait sur un rassemblement un peu plus large (avec cette fois Julien
Dray et Marie-Noëlle Lienemann dans son camp) recule de 11,5 points, son opposition,
fragmentée, se renforçant d’autant. Si on met à part le congrès de Rennes, c’est le score
le plus faible pour la direction depuis le congrès de Metz (46,99%). Le score de M.
Hollande se rapproche, sans l’atteindre, de celui obtenu par François Mitterrand, au
congrès de Grenoble (65,35%), où quatre motions s’affrontaient.
|
| |
 ♦
 1976-1979: la rupture
François Mitterrand règne en maître sur le Parti socialiste. Il est premier secrétaire
mais on l’appelle toujours «président». A sa garde rapprochée, composée
d’ex-conventionnels, comme Pierre Joxe, Georges Fillioud, Claude Estier et Charles Hernu,
et d’ex-PSU, tel Pierre Bérégovoy, s’agrègent des nouveaux. Laurent Fabius dirige son
cabinet. Lionel Jospin, entré au secrétariat national dès 1973, s’occupe de la
«dialectique de confrontation» avec le PCF, en gardant dans sa main le «talisman
de l’unité». «C’est le seul, dira Mitterrand, dont je suis sûr qu’il ne se
cachera pas sous la table si les communistes tapent dessus».
 |
<> Mitterrand et Rocard en 1974.
Le choc entre «deux cultures». |
En ce début de 1976, à la tête d’une majorité qui va de Jean Poperen à Michel Rocard,
François Mitterrand est le gardien de la ligne d’Epinay. Il parle de «rupture avec le
capitalisme» et désigne le «véritable ennemi», le monopole, à savoir
«toutes les puissances de l’argent, l’argent qui corrompt, l’argent qui achète,
l’argent qui écrase, l’argent qui tue, l’argent qui ruine, et l’argent qui pourrit
jusqu’à la conscience des hommes».
LE DIVORCE AVEC LE PCF
Au congrès de Nantes, les 17 et 18 juin 1977, la motion Mitterrand triomphe avec 75%.
Mais au sein de la majorité, Michel Rocard fait entendre sa petite musique sur les
«deux cultures» qui traversent le PS. Se référant au débat du début du siècle
entre Jean Jaurès et Jules Guesde, il oppose une culture «jacobine et
centralisatrice» et une culture «décentralisatrice, autogestionnaire et
libertaire». La deuxième gauche, tolérée plus qu’acceptée après les Assises du
socialisme de 1974, pointe son nez. Et les communistes s’inquiètent. Mitterrand évite de
parler du «rééquilibrage de la gauche», tout simplement parce qu’il juge qu’il est
entré dans les faits. Aux élections cantonales de 1976 et, plus encore, aux élections
municipales de 1977, le PS s’impose comme le premier parti de la gauche. Le PCF grogne,
soupçonne son allié de lorgner vers le centre et se lance dans des surenchères à
l’approche des négociations avec le PS et les radicaux de gauche sur l’actualisation du
programme commun. Le 23 septembre 1977, celles-ci échouent sur le champ des
nationalisations. Le divorce est consommé. Le PS et le PCF abordent les élections
législatives de mars 1978 en ordre dispersé. La défaite est évidemment au bout du chemin.
Au soir du second tour, Michel Rocard prend date: «La gauche vient de manquer un
nouveau rendez-vous avec l’histoire. Une autre stratégie, après tout, pourrait apporter
la victoire». La confrontation pour l’élection présidentielle de 1981 se profile. La
réplique vient, en juin 1978, avec un texte intitulé «contribution des Trente»,
signé par plusieurs proches de François Mitterrand, comme Pierre Joxe et Louis Mermaz,
et suggérant que si le PC s’est éloigné c’est aussi parce que le PS ne se positionne pas
assez à gauche.
LE CHOIX DE METZ
 | |
<> Congrès de Metz, 1979. Fabius, Jospin, Quilès, Mitterrand. |
L’affrontement entre les «deux cultures» et les deux présidentiables intervient au
congrès de Metz du 6 au 8 avril 1979. Hasard du calendrier, la CFDT tient son congrès un
mois plus tard à Brest. Proche de Rocard, Edmond Maire veut y faire entériner le
«recentrage», ou encore la dépolitisation, de son organisation. A l’ouverture du
congrès, François Mitterrand n’a recueilli que 40,1% sur sa motion et il est confronté à
quatre autres textes, ceux de Michel Rocard (21,26%), de Pierre Mauroy (16,01%), du Ceres
de Jean-Pierre Chevènement (14,4%) et de Gaston Defferre (6,89%). D’emblée, le premier
secrétaire place la barre haut et défend de nouveau le «front de classe» et la
rupture avec le capitalisme. «Tout passe d’abord par la transformation du régime
économique, ce qui pose en termes clairs le problème de la propriété»,
s’enflamme-t-il. Michel Rocard met en garde contre les dangers de l’unanimisme et du
sectarisme et invite le PS à ne pas être «un rassemblement hétéroclite de
mécontents». «Sans marché, la liberté n’est plus enracinée dans l’ordre économique
et elle est dès lors menacée», proclame le député des Yvelines. Sur un registre
voisin, le maire de Lille prévient que «la rupture est une chimère dangereuse» et
que «sans une approche clairement social-démocrate, nous ne parviendrons pas à faire
passer nos réformes». François Mitterrand fait monter au créneau son trio de
«sabras»: Lionel Jospin, Paul Quilès et Laurent Fabius. Le député de Seine-Maritime lance
qu’«entre le marché et le rationnement, il y a le socialisme». A l’issue du
congrès, Mitterrand l’emporte (46,99%), en fusionnant avec la motion Defferre. Quelques
semaines plus tard, le Ceres rallie la majorité. Rocard et Mauroy sont rejetés dans la
minorité. Jospin devient numéro deux du PS et le député des Yvelines promet qu’il ne sera
pas candidat à l’Elysée contre le premier secrétaire.
 ♦
 | |

L E S O C I A L I S M E
L E D É B A T
Comment sortir de la «panne» actuelle
Pierre Rosanvallon et Marc Lazar prônent un nouveau réformisme, Jacques Généreux un
retour aux sources du socialisme
Pendant des décennies, en Europe, la social-démocratie a été capable, soit de
prendre directement en charge le changement social, soit, dans l’opposition,
de l’accompagner. Est-ce encore le cas ?
 «Nous sommes à la fin d’un cycle général de l’idée
socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a
toute une histoire à refaire. Tout le projet d’émancipation est à refonder».
PIERRE ROSANVALLON
«Nous sommes à la fin d’un cycle général de l’idée
socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a
toute une histoire à refaire. Tout le projet d’émancipation est à refonder».
PIERRE ROSANVALLON |
Pierre Rosanvallon. Dans l’histoire du socialisme français, il faut distinguer
trois éléments. D’abord, depuis 1920, la séparation entre socialisme et communisme.
Cette polémique fondamentale constitue une première singularité. La deuxième est que
le socialisme français s’inscrit dans une sociologie. Communistes et socialistes avaient
en commun de représenter et d’être enracinés dans des classes populaires, avec, pour le
socialisme, un lien entre avec les fonctionnaires ou les classes moyennes. Le troisième
point tient au contenu: fondamentalement, le projet socialiste se définissait
négativement, dans une distance critique avec le programme communiste, et non,
prioritairement, dans une autonomie. La chute du communisme a bouleversé complètement
toute l’économie sociologique, historique et programmatique du Parti socialiste.
Marc Lazar. Je suis d’accord, avec deux nuances. Une lutte fratricide a existé,
mais le socialisme n’a pas toujours été, surtout après 1945, sur la défensive par rapport
au communisme. Il a aussi eu un projet positif. Avec, à partir des années 1930, en Suède,
puis en Angleterre après-guerre, puis en Allemagne, une volonté de transformer
profondément l’Europe autour de certaines questions, en particulier l’Etat social.
Ensuite est venue la construction européenne, laissée dans un premier temps aux
démocrates-chrétiens. Ce sont des éléments importants pour comprendre les tourments
actuels du socialisme.
La social-démocratie a été une des forces
qui ont façonné la physionomie de l’Europe occidentale. Les historiens tendent
aujourd’hui à ne retenir du XXe siècle que le communisme et le nazisme. Ce n’est qu’une
réalité partielle. Pour reprendre la formule d’Enrico Berlinguer [dirigeant réformateur
historique du communisme italien], avec la démocratie chrétienne, la social-démocratie a
constitué une «force propulsive». Nous assistons aujourd’hui à l’épuisement de la force
propulsive du socialisme.
Jacques Généreux. Je suis d’accord sur l’idée du projet social-démocrate comme
contrepoint ou réaction au communisme. Dès l’origine, selon moi, le socialisme prend un
autre chemin que le marxisme. Le socialisme authentique – celui d’un Pierre Leroux, en
France, en 1833, par exemple, ou des premiers mouvements ouvriers anglais – est un projet
d’égalité et de justice sociale, mais réalisé par la démocratie, par le consentement
mutuel des individus, par la libre association de citoyens, donc dans la liberté.
Contrairement à l’utopie marxiste qui
entend réaliser cette égalité par la mobilisation planifiée, autoritaire, des forces
productives, sous la direction d’une élite qui sait mieux que le peuple comment créer la
société d’abondance. Ce qui a fait la force du projet socialiste au XXe siècle fait
aujourd’hui sa faiblesse. Durant l’âge d’or social-démocrate des «trente glorieuses», ce
projet est en phase avec les conditions technologiques et économiques, qui poussent au
compromis social.
La rupture dans les modes de production,
à la charnière des années 1970 et 1980, a bouleversé la situation. Avec le retour de la
«guerre des classes», avec l’individualisation, l’éclatement des
intérêts, bref, les conflits, le compromis n’est plus naturel. A quoi tient la panne du
socialisme et de la social-démocratie en Europe ? Au fait que depuis vingt ans,
lorsque le compromis est devenu plus difficile, il y a eu un grand renoncement. L’un
parle de bouleversement, l’autre d’épuisement, le troisième de panne.
Quels sont les éléments constitutifs de la crise du socialisme ?
Pierre Rosanvallon. Il n’y a pas simplement panne. Le socialisme a été un
idéal, avec une gamme de moyens de réalisation. Or nous avons vécu une décomposition
successive de ses incarnations. Le socialisme marxiste s’est effondré. Le socialisme
social-étatique des nationalisations, du programme commun des années 1980, également. Le
socialisme social-démocrate, qui présupposait un compromis institutionnel entre les
grandes forces sociales, s’est aussi épuisé. La nouveauté, c’est que la figure du
socialisme libéral, de la «deuxième gauche», s’est également épuisée.
L’histoire du socialisme s’est
caractérisée par l’opposition entre un socialisme déclinant et un autre en croissance. Un
moment, le déclinant était le communisme, et l’ascendant le social-démocrate; à un autre,
le social-étatisme était déclinant, le social-libéralisme ascendant. Aujourd’hui,
l’ensemble des figures est en décomposition. Nous sommes à la fin d’un cycle général de
l’idée socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a
toute une histoire à refaire, des traditions occultées à redécouvrir. Tout le projet
d’émancipation est à refonder.
 «Nous sommes dans l’épuisement d’une
parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du nouveau
capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme a besoin
d’être refondé, pas réinventé». JACQUES GÉNÉREUX
«Nous sommes dans l’épuisement d’une
parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du nouveau
capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme a besoin
d’être refondé, pas réinventé». JACQUES GÉNÉREUX |
Jacques Généreux. Je ne suis pas du tout d’accord avec l’idée d’épuisement de
toutes les branches du socialisme. Nous sommes dans l’épuisement des compromis qu’ont
imposé les deux dernières décennies quand, face à l’attaque frontale du capital contre
des acquis sociaux-démocrates, les socialistes ont été incapables de répondre autrement
que par le renoncement ou par une trahison intellectuelle rebaptisée «troisième voie».
Mais l’idée socialiste de départ – qui consistait à «faire société», à bien vivre
ensemble, dans l’égalité et la justice, et d’y parvenir par la démocratie –, cette idée
est étonnamment d’actualité, face à une société déréglée et néolibérale qui pousse à la
compétition et à la guerre.
Ce monde ne souffre pas d’un déficit
d’autorité, mais d’un déficit de démocratie, un déficit de pouvoir citoyen. Nous sommes
donc dans l’épuisement d’une parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du
nouveau capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme des valeurs
universelles a besoin d’être refondé, mais pas réinventé.
Pierre Rosanvallon. Il suffirait donc de sortir d’une parenthèse de
renoncement, de dérapage du socialisme ?
Jacques Généreux. Absolument. Il n’y a pas d’autre issue que de revenir au
volontarisme politique, qui a toujours été le propre de la gauche. Le politique a
vocation à transformer la société. Mais revenir aux sources de l’inspiration n’est pas
forcément revenir aux instruments d’action antérieurs. La social-démocratie des «trente
glorieuses» a gravi une série de marches vers une société plus juste, plus coopérative.
Nous avons redescendu des marches. Il faut remonter, mais pas par le même escalier: les
conditions ont changé.
Marc Lazar. Il ne faut pas faire une rationalisation a posteriori. La question
du compromis a divisé historiquement les sociaux-démocrates. Et s’il y a un parti qui
s’est opposé au compromis social-démocratie, c’est bien le PS ! Au point que cette
hostilité plombe encore ses évolutions. Par ailleurs, le compromis entre le capital et le
travail est modifié, les rapports entre l’Etat et le marché redéfinis, l’équilibre de la
configuration entre efficacité économique et justice sociale est plus difficile. On se
retrouve dans un paradoxe historique très fort pour le socialisme: né de la question
sociale au XIXe siècle, il est rattrapé par elle au début du XXIe.
Or toutes les variantes doctrinales
basées sur l’idée d’une appropriation collective des moyens de production et de l’action
collective pour la redistribution des richesses ont fait long feu. Reste posée la
question du réformisme. Quel type de réformisme peut-on faire ? Avec quelles
forces ? Autour de quelles valeurs à définir ? Avec une nouvelle vision de
l’égalité et de la justice sociale, une reconnaissance de l’efficacité économique
capitaliste et la volonté de réduire les inégalités. Le front qui se dessine va au-delà
des frontières classiques du socialisme. Il y a la «troisième voie» anglaise. Il y a
aussi eu un texte célèbre de Massimo D’Alema et de Giuliano Amato sur l’idée d’une
«maison commune» des réformistes en Europe.
Le réformisme plutôt que le socialisme: il faudrait aussi que les forces sociales qui
s’y rattachent soient différentes.
Marc Lazar. Quel est l’électeur socialiste type aujourd’hui ? C’est plutôt
une femme, salariée, et en général dans le secteur public, d’environ 55 ans, vivant en
ville, ayant un haut niveau d’éducation, tolérante en matière de mode de vie. Il est de
moins en moins issu des catégories populaires. Ce n’est pas simplement le 21 avril, en
France, qui l’a démontré. C’est le cas pour la plupart des partis socialistes et
sociaux-démocrates européens. La base sociale historique du socialisme vacille partout,
avec une immense percée du côté des classes moyennes et une déperdition dans les
catégories populaires. Parallèlement, les nouvelles inégalités sociales et exclusions
soulèvent un problème fondamental. Comment les réformistes lisent-ils la société,
répondent-ils à ses attentes ? La social-démocratie classique n’y parvient plus.
Quelles sont les pistes de «rénovation» réformiste ou de «refondation» socialiste ?
Pierre Rosanvallon. Dans la société, il y a toujours de la domination, de
l’exploitation. Le projet de refonder l’émancipation, la protection, de refaire une
communauté politique, est donc fondamental. Nous devons prendre en compte l’épuisement
d’une certaine conception du réformisme. 1981 a permis un double apprentissage: on est
passé – c’était un progrès considérable – d’une culture d’opposition à une culture de
gouvernement. En même temps on a considéré que le réformisme se limitait à
l’apprentissage de la culture du gouvernement. C’est insuffisant.
Le réformisme n’est pas simplement le
communisme moins 20%, ou le libéralisme plus 20%. Il se définit comme une méthode
politique, mais aussi comme un contenu. J’appelle en quelque sorte à un peu plus de
marxisme: refaisons une analyse de la société réelle et du mode de production. Il n’y
aura pas de nouveau réformisme s’il n’y a pas de nouvelles analyses des transformations
sociales et de l’économie. Le mode de production s’est totalement modifié: il est plus
segmenté, plus individualisé. Il a développé de nouvelles possibilités de développement
personnel et mis en place, en même temps, des formes nouvelles d’aliénation et de
souffrance au travail. L’idée d’émancipation doit repartir de là.
Le réformisme se définit encore beaucoup
trop souvent de façon uniquement négative, par rapport au libéralisme, au populisme
d’extrême droite ou au radicalisme d’extrême gauche. Le réformisme comme contenu est à
redéfinir. Ce qui m’inquiète, aujourd’hui, c’est que le PS, dans tous ses courants, en
reste à un réformisme de méthode.
Jacques Généreux. Il ne faudrait pas embrouiller le débat en assimilant
implicitement socialisme et communisme. Si le «socialisme réel» des pays communistes
est fini, cela ne signifie pas que le socialisme est terminé. Nous sommes dans la
troisième manche de l’histoire: l’effondrement du socialisme réel a placé en position
de force le modèle néolibéral. Mais il est aussi destructeur que le communisme et repose
sur la même utopie du progrès par l’abondance de la production matérielle. Le temps est
donc venu d’un retour aux sources et aux valeurs du socialisme démocratique.
Sur le réformisme, je suis en accord
avec Pierre Rosanvallon: face aux réalités nouvelles de la société, aux mutations
technologiques et sociologiques, il y a eu une panne de la réflexion réformatrice. Mais
qui ne voit que c’est la logique de la domination de profits privés sur le bien commun
qui nous pousse à l’impasse écologique de notre modèle économique, à la dislocation de
la cohésion sociale, à l’aggravation des inégalités.
Dans la continuité d’une idée forte du
socialisme, il faut donc réaffirmer qu’il n’y a pas de réforme de ce système sans rupture
nécessaire avec cette domination du profit privé et la restauration d’une logique de
l’intérêt général. Comment ? Par la démocratie. La réflexion sur la démocratie
constitue le déficit majeur de la pensée socialiste au XXe siècle. Les socialistes se
sont coulés dans les institutions et les règles du jeu de la démocratie représentative
parce qu’ils y ont vu un instrument pour conquérir le pouvoir et faire passer
pacifiquement certaines réformes sociales.
Mais ce mouvement dominant a conduit à
abandonner une critique fondamentale, présente à l’origine du socialisme, d’une
démocratie bourgeoise, oligarchique, qui, sous couvert de démocratie, assure en réalité
la reproduction d’une élite qui gouverne la société. Aujourd’hui, le problème n’est pas
que l’économie n’est plus placée sous le contrôle du politique, comme disent beaucoup
d’altermondialistes. C’est que le politique n’est plus sous le contrôle des citoyens.
La première révolution culturelle du
socialisme, c’est mener à son terme cette réflexion critique sur la démocratie. Se
poser la question: comment remettre le politique sous le contrôle du citoyen – ce que
j’appellerai la démocratie effective. Une autre révolution est nécessaire: celle du
rapport à la production et à la croissance. Il y a une longue tradition productiviste
du progrès dans la gauche, le marxisme et le socialisme. Il faut rompre avec cette
tradition, non pour bannir l’idée de croissance, mais pour réaffirmer que production
et croissance sont des instruments au service du développement humain et du progrès
social, et pas des fins en soi.
| |
 ♦
 1980-1984: pouvoir
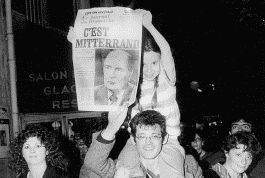 | |
<> 10 mai 1981, Paris. La victoire de François Mitterrand. |
Tout au long de l’année 1980, alors que le Parti socialiste est sous le feu roulant des
attaques du PC, François Mitterrand laisse entendre qu’il ne souhaite pas, une troisième
fois, être candidat à l’Elysée. Porte-parole des «modernes» face aux «archaïques», Michel
Rocard avance ses pions. Le 19 octobre 1980, depuis sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine,
le député des Yvelines annonce aux Français, avec solennité, qu’il est candidat à la
candidature. Il prend soin de répéter qu’il se retirera si, finalement, le premier
secrétaire se déclare. Aussitôt, Jean-Pierre Chevènement, architecte du projet socialiste,
adopté en janvier 1980 à Alfortville par 96% des suffrages, se met sur les rangs. Cette
double valse durera deux semaines. Le 8 novembre 1980, répondant à l’appel de 75
fédérations du PS, François Mitterrand se déclare. Les autres se retirent. Fermez le ban.
LA VICTOIRE TRANQUILLE
Le 24 janvier 1981, à Créteil (Val-de-Marne), un congrès extraordinaire du PS investit à
83,66% des votes celui qui, explique Lionel Jospin, «a rencontré le Parti socialiste,
l’a conquis et a été conquis par lui au point de l’incarner». Jusqu’alors secrétaire
national chargé des relations internationales, Lionel Jospin est élu, à l’unanimité,
premier secrétaire. Ce n’est pas un «intérim», précise le député de la Nièvre,
résolu, à partir de la thématique de rupture du congrès de Metz, à «battre Giscard
d’Estaing et, avec lui, la droite, le camp des privilèges et le grand capital». Dans
la salle, un jeune auditeur à la Cour des comptes, François Hollande, participe à
l’enthousiasme. Il vient de prendre sa carte. Sans renier le Projet socialiste, François
Mitterrand fait campagne sur ses 110 propositions. Il choisit comme slogan «la force
tranquille» mais n’est pas, cette fois, le candidat unique de la gauche. Georges
Marchais défend les couleurs du PCF. Les minoritaires de Metz trouvent une petite place
dans son équipe de campagne, dirigée par Paul Quilès: Pierre Mauroy est porte-parole et
Michel Rocard siège au conseil politique. Dès novembre 1980, le candidat avait proposé au
maire de Lille d’être son premier ministre en cas de victoire. Dix ans après Epinay, le
10 mai 1981, avec 51,75% des voix, François Mitterrand est élu président de la République.
Aux élections législatives qui suivent la dissolution, en juin, le PS, avec 285 élus,
conquiert la majorité avec le seul appoint des radicaux. La «chambre rose» ne compte que
44 communistes. Lionel Jospin, qui avait été le seul socialiste à affronter, le 20 avril
1980, Georges Marchais à la télévision, est chargé de négocier l’entrée du PC au
gouvernement. Avec quatre ministres, les communistes participent au deuxième cabinet de
Pierre Mauroy. Le premier ministre d’union de la gauche veut, à travers des réformes
flamboyantes (39 heures, 5e semaine de congés payés, nationalisations, abolition de la
peine de mort, etc.), instaurer le «socle du changement». Lionel Jospin participe
aux déjeuners hebdomadaires des «éléphants» à l’Elysée. Il y retrouve Pierre Joxe à la
tête des députés socialistes.
DES RÉFORMES À LA RIGUEUR
 |
<> Mitterrand et
Delors en 1983. |
D’abord légitimiste, le PS applaudit la politique du gouvernement, sauf quand il s’agit
d’amnistier les généraux félons de l’Algérie française, ferraille avec la droite et le
Conseil constitutionnel. Au congrès de Valence, du 23 au 25 octobre 1981, des accents de
radicalisation se font entendre. «Il faut frapper vite et fort contre le sabotage de
notre économie», lance Louis Mermaz. Mais la motion unique, adoptée à l’unanimité,
parle de «transformer graduellement le système économique». «Nous ne cherchons pas la
guerre. Nous souhaitons l’accommodement, le compromis», renchérit Jean Poperen,
numéro deux du PS. Jospin défend son «ni-ni»: ni «Etat PS» ni «parti
godillot». Et Laurent Fabius énonce son syllogisme: «Chaque militant c’est le PS,
le PS c’est le gouvernement, chaque militant c’est le gouvernement». A l’été 1982, un
exclu de la Ligue communiste révolutionnaire qui a fait ses classes à l’UNEF-ID, Julien
Dray, rejoint le PS avant de fonder SOS-Racisme. Mais la politique économique échoue. En
juin 1982, Pierre Mauroy bloque les salaires et, en mars 1983, après avoir empêché une
sortie de la France du système monétaire européen, il instaure la rigueur. Pour faire
avaler cette pilule amère, Lionel Jospin invente la «parenthèse»: «une façon de
supporter un changement avec l’espoir raisonnable de revenir au bout de deux ou trois ans
à notre politique». Dès février 1984, Jospin, au grand dam de Poperen, suggère de
retirer le projet de «grand service public unifié et laïque de l’éducation
nationale». Mais la grogne enfle. En juillet 1984, Mauroy démissionne. Laurent
Fabius, 37 ans, lui succède... sans le PC. Le 16 décembre 1984, François Hollande et ses
amis invitent le PS à «en appeler au réel bien plus qu’aux mythes». Les
«transcourants» sortent de l’ombre.
 ♦
 | |
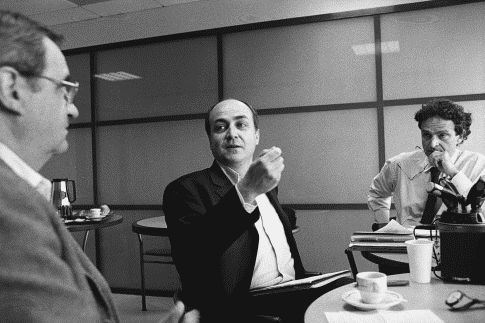
|
PIERRE ROSANVALLON (à gauche), l’un des principaux concepteurs de
la «deuxième gauche» dans les années 1970-1980, est professeur au Collège de France. Il a
récemment publié Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en
France (Gallimard, 1998) et La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté
du peuple en France (Gallimard, 2000).
JACQUES GÉNÉREUX (au centre) est professeur à l’IEP de Paris. Il est membre du
courant Nouveau Monde du PS. Il est l’auteur de Quel renouveau socialiste ?
(Textuel, 2003) et des Vraies Lois de l’économie (Seuil, 2002).
MARC LAZAR (à droite) est professeur à l’IEP de Paris, directeur de l’Ecole
doctorale de sciences politiques. Il est le coordinateur de La Gauche en Europe depuis
1945 (PUF, 1996) et a publié, récemment, Le Communisme, une passion française
(Perrin, 2002). |
Marc Lazar. Le grand changement qui se dessine, y compris dans l’intervention
de Jacques Généreux, c’est désormais un consensus très large sur le réformisme. Même dans
les courants les plus à gauche du PS, où la tentation reste forte d’un changement
radical, il y a l’idée réformiste. C’est un changement culturel profond. Des désaccords
subsistent sur le contenu, mais l’acceptation largement partagée du réformisme comme
méthode marque la renonciation à la révolution, à la rupture radicale, même si cette
renonciation est contestée de l’extérieur, par l’extrême gauche.
Reste que la social-démocratie est moins
innovante aujourd’hui que dans les années 1950 et 1970. Mais elle conserve d’importantes
capacités d’adaptation. De nouvelles thématiques, sur l’environnement, le développement
durable, le féminisme, ont été très vite reprises par les partis sociaux-démocrates.
André Philip, un socialiste un peu oublié, disait que le socialisme «était souple
dans la doctrine, précis dans le programme et irréductible dans les valeurs».
Etendre cette vision au réformisme donnerait quatre pistes de réflexion.
1) Souple dans la doctrine, le réformisme lit le monde en tenant compte de la
réalité;
2) Irréductible dans les valeurs, il repense la conception traditionnelle de l’égalité,
de la responsabilité et de la liberté des individus;
3) Précis dans son programme, ses alliances, il constate que la démocratie n’est pas
simplement représentative. Le réformisme doit innover face aux nouvelles exigences
démocratiques, y compris sur l’Europe et la régulation mondiale;
4) Ce réformisme doit être le pivot des alternances politiques et la plaque sensible
des sociétés. Il doit répondre aux cris de douleur et de colère des catégories les plus
humbles. «Le socialisme, disait Carlo Rosselli, c’est quand la liberté arrive
dans la vie des gens les plus pauvres». Le réformisme doit aussi traduire les
demandes d’émancipation des catégories les plus démunies.
Pierre Rosanvallon. Nous ne pouvons en rester à la réaffirmation de nos
valeurs. Le débat doit porter sur des réformes précises. Faut-il donner aux associations
un rôle de représentation auprès des municipalités ? Faut-il refonder l’idée de la
communauté ? Qu’est-ce qu’une société d’égaux et de semblables ? Le débat
actuel sur les retraites, par exemple, élude les problèmes considérables des
redistributions cachées et des espérances de vie différenciées. Les socialistes n’en
disent rien. De même, la montée en flèche des très hautes rémunérations change
complètement la vision d’une société de semblables. Où sont les propositions du PS sur
ces sujets essentiels ? On ne peut critiquer le libéralisme et refuser de parler des
questions concrètes.
Sur l’émancipation, il y a au moins un
point positif dans la «troisième voie» blairiste; c’est l’idée que les réformes sont
aussi l’extension du capital social des individus, pas seulement un changement des règles
générales. La capacité d’éducation, l’indemnisation du chômage, la réinsertion, tout ce
qui est lié aux problèmes spécifiques des individus, est devenu cardinal. On est dans un
retour aux sources: l’émancipation, c’est équiper l’individu pour qu’il puisse faire sa
vie. Ce qui me frappe, entre les différentes familles du socialisme jusqu’à l’extrême
gauche, c’est une capacité très forte à la discussion idéologique et une capacité si
faible à la discussion, concrète, sur le programme des réformes.
Jacques Généreux. Le réformisme est une méthode ? D’accord ! Mais il
ne peut être que radical, traiter des problèmes à la racine. Il n’est pas une posture, se
contentant de réformettes, mais un projet de transformation profonde de la société.
Que signifie «attaquer à la racine» ?
Jacques Généreux. Le PS ne dit effectivement rien de concret sur la nouvelle
redistribution du capital social. Mais, dans le PS et le mouvement social, certains
avancent des propositions sur la démocratie effective, une vraie culture et des
institutions du contrôle citoyen; la transformation des règles du jeu politiques.
Prenons l’entreprise. L’irruption de
l’idée démocratique dans l’économie, c’est que l’équilibre des pouvoirs entre partenaires
est aussi une condition de l’efficacité économique. La financiarisation du capitalisme et
la déréglementation désordonnée des marchés ont donné un pouvoir exorbitant aux détenteurs
du capital et aux actionnaires, qui induit une concurrence par la compression des coûts
salariaux, l’intensification du travail, des économies sur les conditions de sécurité ou
environnementales. Si on introduit des formes de cogestion élargies, de participation
stratégique, qui équilibrent les pouvoirs des actionnaires par ceux des managers, des
salariés ou des collectivités territoriales, on a des entreprises qui, dans une économie
de marché, se feront concurrence sur la qualité et la pertinence de leurs produits.
Marc Lazar. A la liste que dresse Pierre Rosanvallon des réformes à
entreprendre, il faut ajouter le douloureux chantier des services publics. Comment les
transformer aujourd’hui ? Comment n’être pas simplement dans une position
conservatrice, les maintenir sur un certain nombre de biens, mais accepter le principe de
leur émulation et de l’efficacité pour les usagers ? Si le réformisme ne prend pas
cette question en charge, d’autres, la droite en l’occurrence, le font.
Pierre Rosanvallon. Tout à fait. Le débat sur le service public ne doit pas
simplement porter sur leur mode de gestion, mais aussi sur leur définition même. Il y a
des produits collectifs, comme l’eau ou l’électricité, qui en ont moins besoin, alors
qu’il faut inventer de nouveaux services publics, pour la formation, le logement, la
ville, par exemple. Quant à la refondation du socialisme et à l’affirmation qu’il faut
davantage de politique dans notre société, qu’est-ce que ça veut dire ? L’appel à
davantage de volontarisme est trop court. La politique n’est pas simplement un théâtre
de l’incantation. C’est l’art de rendre visible la réalité des rapports sociaux, des
inégalités et des compromis. Il faut retrouver une plus grande lucidité sur les rapports
de forces et les relations sociales réelles.
En outre, refonder le socialisme, c’est
émanciper l’individu. La question clé de l’économie moderne, c’est comment donner plus de
capital social aux individus pour les rendre plus créatifs, plus autonomes, donc plus
productifs. Mais l’histoire du capitalisme contemporain, c’est qu’à travers la créativité
et l’autonomie se jouent aussi de nouvelles formes d’aliénation. Il faut, à la fois,
donner ce capital social et lutter contre les formes d’aliénation nouvelles et les
nouvelles souffrances dans le travail qu’il développe.
Le socialisme ne peut se limiter au
retour de la politique au poste de commandement, il doit aussi repenser la souffrance
sociale. Et y repenser à partir du plus concret, pas du baratin général. Lorsque le
langage politique est trop idéologique, ne correspond pas à la réalité sensible et vécue,
alors la parole populiste apparaît plus incarnée, plus proche des réalités. C’est un
problème fondamental pour les partis démocratiques.
Le PS est-il capable de prendre à bras-le-corps les problèmes que vous avez évoqués ?
 «Le PS est-il à la hauteur des enjeux de la société ? Je suis
très inquiet. D’autant qu’un cycle de radicalisation apparaît dans la jeunesse, portée
par des idéaux nouveaux, parfois en train de basculer dans des chimères».
MARC LAZAR
«Le PS est-il à la hauteur des enjeux de la société ? Je suis
très inquiet. D’autant qu’un cycle de radicalisation apparaît dans la jeunesse, portée
par des idéaux nouveaux, parfois en train de basculer dans des chimères».
MARC LAZAR |
Marc Lazar. Malgré ses difficultés et le traumatisme de 2002, le PS est le
grand parti pivot de la gauche. Il a trois problèmes devant lui. D’abord surmonter la
tentation de s’en remettre au jeu de balancier automatique qui, depuis 1981, fait
que tout gouvernement sortant perd les élections et qu’il suffirait à la gauche
d’attendre l’échec ou le rejet de la droite. Ce serait une lourde erreur.
Deuxième question: compte tenu de la
disparition du PCF et de l’incapacité des Verts à construire un parti, le PS pourra-t-il
étendre suffisamment son rayon d’action. Devra-t-il faire de nouvelles alliances, et
avec qui ?
Dernière question, essentielle: le PS
est-il à la hauteur des enjeux actuels de la société française, de ce nécessaire retour
au politique, de cette exigence de politique que nous avons évoqués ? Sur ce point,
je suis très inquiet, d’autant qu’un nouveau cycle de radicalisation apparaît dans la
jeunesse, portée par la quête de nouveaux idéaux, et parfois en train de basculer dans
des chimères idéologiques.
Jacques Généreux. Ou bien l’on se contente de croire que l’échec de la gauche
et le 21 avril ne sont qu’un problème de communication avec la société, que le pouvoir
rend sourd et que les classes populaires ne comprennent plus la modernité. Ou bien –
c’est ce qu’ont exprimé quatre militants socialistes sur dix avant leur congrès – on
admet que le 21 avril est le signe d’un déphasage avec la demande sociale et d’erreurs
politiques fondamentales commises par les socialistes au pouvoir.
Dans ce cas, il faut le reconnaître, dire
lesquelles et réfléchir aux vrais changements, notamment sur la question sociale. Si le
PS ne change pas la ligne, peut-être reviendra-t-il au pouvoir. Pour quoi faire ? La
même politique que MM. Aznar ou Berlusconi sur certains points ? La politique qui a
conduit à cet échec ? Si c’est ça, le réformisme de gauche, ça nous promet du
populisme, de l’extrême droite.
Pierre Rosanvallon. La question centrale qui se pose au PS est de passer d’un
réformisme de méthode, désormais acquis, à un réformisme de contenu, qui reste à
construire. Le deuxième point, plus inquiétant, c’est que le PS est un parti d’élus, de
cadres, de profs et de fonctionnaires. Sa base sociale est aujourd’hui trop étroite pour
en faire une puissance réformatrice. Il faut qu’il trouve le moyen d’aller à la rencontre
de la société française, qu’il ouvre et anime des états généraux de la société française.
Propos recueillis par Gérard Courtois, Sylvain Cypel et Isabelle Mandraud
| |
 ♦
 1985-1989: TENSION
Laurent Fabius a beau être le «plus jeune premier ministre» que François
Mitterrand ait donné à la France, la mayonnaise entre le gouvernement et le PS ne prend
pas toujours. La rigueur tient lieu de politique. Fabius parle de «modernisation» tous
azimuts sur fond de sévères restructurations industrielles et de grogne syndicale,
attisée par la CGT et par le PC. Le président de la République réhabilite le profit et
l’esprit d’entreprise. La page de la rupture avec le capitalisme est définitivement
tournée. Face à une droite qui n’a pas baissé la garde et prépare sa revanche aux
élections législatives de 1986, les socialistes peinent à se mettre en ordre de marche,
paralysés par la querelle entre le premier ministre et le premier secrétaire.
FABIUS CONTRE JOSPIN
Le 14 juin 1985, Laurent Fabius revendique le leadership: «Le premier ministre n’a
pas à diriger le Parti socialiste, en revanche, je suis le chef du gouvernement et de
la majorité». Aussitôt, Lionel Jospin prend la mouche. Le 6 juillet, il prévient le
comité directeur: «Mon mandat de premier secrétaire est entre vos mains. (...) Le PS
doit-il rester un parti indépendant conduit par ses dirigeants élus ou doit-il être
coiffé par le premier responsable gouvernemental, en particulier pour la campagne
électorale et donc être dirigé de l’extérieur ?» De l’extérieur ? Le
premier ministre, déjà embarqué dans une série de meetings, relève l’affront. François
Mitterrand est obligé d’arbitrer. Il le fait en faveur de Jospin: «L’armature
politique de la majorité étant le PS, il revient naturellement au responsable de ce parti
de conduire la campagne que les socialistes entendent mener à leur guise». Mais la
querelle laissera des traces au sein du courant mitterrandiste. Fabius charge son
lieutenant Claude Bartolone de créer son courant, le club Tradition et modernité. Jospin
refuse de faire de même. «Mon seul courant, c’est le PS», répéte-t-il. Le congrès
de Toulouse, du 11 au 13 octobre 1985, ne se ressent pas de cette rivalité naissante.
Lionel Jospin obtient sur sa motion 71,5%. Il évoque le «déclin irrémédiable» du
PC et fait un pas, sans prononcer le mot, vers la reconnaissance du caractère
social-démocrate du PS. «Le pays a besoin d’une grande force progressiste à caractère
socialiste», proclame-t-il. Michel Rocard, qui a démissionné six mois plus tôt du
gouvernement pour protester contre l’instauration de la proportionnelle aux élections
législatives, fait de la résistance. L’ancien ministre de l’agriculture défend l’économie
mixte et le rôle du marché et définit l’Etat non comme producteur mais comme régulateur.
Candidat quasiment déclaré à l’élection présidentielle de 1988, sa motion recueille
28,5%. Avec un bilan en demi-teinte et un échec contre le chômage, l’affaire Greenpeace
polluant un peu plus le climat, le gouvernement ne part pas favori. Grâce à la
proportionnelle, le PS limite les dégâts et avec 32% parle de «défaite victorieuse»
aux législatives. Mais il doit céder le pouvoir. Jacques Chirac devient premier ministre.
La première cohabitation commence...
 |
<> 1988, première cohabitation,
Chirac et Mitterrand. |
COHABITATIONS PLURIELLES
Alors que le PS fourbit ses armes pour «résister» au retour de la droite et gêner
autant que possible la cohabitation, 400 ex-trotskistes, venus du Parti communiste
internationaliste (PCI, lambertiste), emmenés par Jean-Christophe Cambadélis, ancien
président de l’UNEF-ID, entrent, en juin 1986, «sans conditions» au PS. D’abord tentés
par Fabius, ils rejoindront Jospin. Le premier secrétaire profite du congrès de Lille, du
3 au 5 avril 1987, où tous les courants se retrouvent sur la même motion, pour évincer
son numéro deux, Jean Poperen. Les éléphants, de Laurent Fabius à Pierre Mauroy, en
passant par Edith Cresson, Pierre Bérégovoy et Henri Emmanuelli investissent en masse le
 |
<> 1988, Pierre Mauroy, premier secrétaire
du PS, lors d’un meeting. |
secrétariat national. Mais déjà la campagne présidentielle de 1988 se profile. Le 11
juillet 1987, Mitterrand reçoit Jospin à Latché. «Préparez-vous à l’hypothèse de ma
candidature mais si vous la laissez entendre, je démentirai», prévient-il. Jospin
prépare affiches et meetings mais quand le président se déclare, le 22 mars 1988, le PS
se trouve tenu à l’écart. Avec sa «Lettre à tous les Français» et le thème de
«la France unie», le candidat joue l’ouverture au-delà du PS. Jospin annonce à
Mitterrand qu’en cas de victoire, il souhaite être ministre. Un septennat à la tête du
PS, ça suffit. Une fois Mitterrand réélu (à 54%), Michel Rocard est nommé à Matignon. Le
président souhaite que Fabius devienne premier secrétaire. Mais Pierre Mauroy se
présente, avec le soutien de Jospin. Les motions A et B (Mitterrand- Mauroy)
présélectionnent leur champion: 63 voix pour Mauroy et 54 pour Fabius. «On n’hérite
pas du PS comme d’une Aston Martin», commente cruellement Henri Emmanuelli.
 ♦
 | |

L E S O C I A L I S M E
E N E U R O P E
Mais comment font-ils, ces Suédois ?
la social-démocratie suédoise et sa «culture de gouvernement» fascinent nombre de responsables du PS
STOCKHOLM,
de notre correspondant
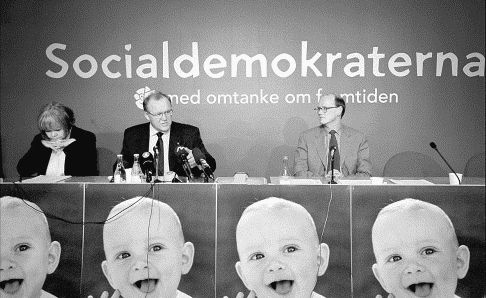
|
| Mai 2003, réunion du Parti social-démocrate (SAP).Le nombre
d’adhérents baisse, mais le modèle suédois fonctionne toujours. |
Scrutin après scrutin, décennie après décennie, la social-démocratie suédoise assure
sa pérennité avec une constance désarmante, qu’envient bon nombre de partis frères en
Europe. Se poser en adversaire de cette machine à gouverner, c’est s’exposer à de longues
traversées du désert. Les partis dits de tendance conservatrice, libérale,
chrétienne-démocrate ou centriste, en savent quelque chose:depuis 1945 et la fin de la
coalition nationale mise sur pied pendant la guerre, ils n’ont confisqué le pouvoir au
Parti social-démocrate (SAP) qu’à deux reprises, de 1976 à 1982, puis de 1991 à 1994.
Certes, la période où 45% des voix tombaient dans l’escarcelle rose semble révolue.
Le nombre de membres du SAP a chuté de 100 000 en dix ans, à 152 000. Mais,
plus que centenaire, cette formation a encore du répondant. En septembre 2002, quatre
ans après avoir enregistré son plus mauvais score depuis 1922 (36,4%), elle parvint à
frôler les 40% des suffrages alors qu’on lui promettait une inexorable décote, à l’image
de ses sœurs danoise, finlandaise et norvégienne.
A force d’être dirigés par le même parti – le premier gouvernement social-démocrate
remonte à 1932 – une majorité de Suédois ont fini par l’identifier à la société qu’il a
façonnée. «Le SAP est en harmonie avec ce qu’attendent les électeurs, ou bien
l’inverse», affirme Britt Bohlin, la présidente du groupe au Parlement. Des
responsables du parti ont expliqué l’amélioration de son score électoral par le fait
qu’il avait su mieux «écouter et comprendre» les électeurs, après avoir dû mener
une politique d’austérité.
Et que souhaite une majorité des neuf millions d’habitants du pays ? Un système
égalitaire de prise en charge de l’éducation, de la santé et de la retraite qui
fonctionne et une économie saine, à en croire différentes études. Autant d’éléments du
«modèle suédois», dont la réputation a contribué à l’image du pays à l’étranger depuis
les années 1960. «Contrairement aux Partis socialistes du reste du continent,
déclarait à cette époque Olof Palme, alors jeune premier ministre, le mouvement
ouvrier suédois ne s’est guère intéressé aux subtilités théoriques, mais beaucoup plus à
la construction concrète de la société». S’est établi alors un contrat implicite
entre les électeurs et le SAP: «Nous payons beaucoup d’impôts contre le droit à
disposer de bons services pour le bien-être, la santé et l’école», résume Per Olof
Edin, ancien chef économiste de la puissante confédération syndicale LO. Un contrat qui
tient toujours. Lorsqu’on demande aux Suédois s’ils sont prêts à payer plus d’impôts –
déjà les plus lourds d’Europe – ils répondent par l’affirmative si on leur garantit des
prestations sociales encore plus généreuses…
A quelques exceptions près, le SAP a, dès le début du XXe siècle, mené une politique
pragmatique, développant son audience au-delà du monde ouvrier, jusque dans les campagnes
où il pouvait compter sur le soutien de ligues de tempérance. «Le parti n’a jamais eu
pour but de nationaliser l’économie du pays», note Thomas Hempel, vieux routier du
journalisme politique. Plus tard, les sociaux-démocrates firent preuve de souplesse
idéologique en ne revenant pas sur le démantèlement des monopoles d’Etat dans les
télécommunications et la poste, décidé par le gouvernement de centre droite au début des
années 1990. D’une manière générale, le pragmatisme du SAP s’explique aussi par le fait
qu’il n’a jamais eu la majorité absolue au Parlement:il lui fallait trouver des compromis
au centre ou à sa gauche, comme c’est le cas depuis 1998 avec les anciens communistes et
les Verts.
| «Le mouvement
ouvrier suédois ne s’est guère intéressé aux subtilités théoriques, mais beaucoup
plus à la construction concrète de la société» |
L’absence d’un PC fort en Suède a d’ailleurs favorisé la prédominance sociale-démocrate.
Les communistes ne parvinrent jamais à se présenter comme une alternative. «Ils
étaient perçus comme une menace à l’encontre de la politique de bien-être», se
souvient Britt Bohlin. Au point qu’après 1945, et jusqu’aux années 1980, une alliance
tacite se forma entre la direction sociale-démocrate, le syndicat LO et le patronat,
pour limiter l’influence communiste dans les entreprises par des méthodes peu orthodoxes
(fichiers secrets, sanctions contre les militants «rouges»)…
La coopération entre le SAP et la confédération syndicale, forte de deux millions
de travailleurs, est l’un des principaux facteurs de la réussite sociale-démocrate
suédoise. «Le parti a toujours pris en considération les souhaits de LO qui lui a
assuré son soutien entier en période électorale, pointe Thomas Hempel. Lorsque
d’aventure le parti et LO s’éloignent, comme en 1991, les sociaux-démocrates enregistrent
de mauvais résultats». Ces liens se sont distendus récemment. Alors qu’il y a trente
ans, 80% des membres de LO votaient social-démocrate, ils n’étaient plus que 59% en 2002.
En revanche, le SAP attire davantage les catégories socioprofessionnelles plus élevées
– résultat, selon certains experts, du glissement de sa politique vers le centre.
Formation à l’organisation horizontale, le SAP n’est pas traversé par les guerres de
courants qui minent les socialistes français. Si le débat a lieu en son sein, la culture
du compromis est telle en Scandinavie que les congrès du SAP n’avalisent, généralement,
que des décisions jouissant d’un large soutien à sa base. En revanche, note Thomas Hempel,
«le parti réussit à se mettre en opposition contre lui-même au moment des campagnes
électorales, pour reprendre à son compte le mécontentement populaire que l’opposition
bourgeoise ne parvient pas à capter»…
Antoine Jacob
Les périlleux dilemmes allemands
Gerhard schröder doit faire face aux déficits publics sans toucher aux acquis sociaux
BERLIN
de notre correspondant
POUR les sociaux-démocrates allemands, l’épreuve a tout du périlleux exercice
d’équilibre. Comment, sans perdre leur âme, réformer leur système de protection sociale,
l’une des plus solides justifications de leur existence politique ? Sur ce
problème, responsables, syndicalistes, militants et experts du SPD se déchirent depuis
des mois. Entre ceux qui, tels les syndicats, craignent de voir les changements mettre en
cause les acquis, et ceux qui, tel le gouvernement, pris à la gorge par l’état des
finances publiques, ne voient d’autre issue que de tailler dans la masse, le parti
tangue, à la recherche d’un inaccessible compromis.
Certains députés évoquent une cure d’opposition pour ressourcer une formation qui
aurait perdu ses repères. Des syndicalistes parlent de trancher les liens qui les
attachent à la social-démocratie. La direction du SPD aligne les chiffres, faisant appel
à la responsabilité de tous. Sans doute, lors du prochain congrès extraordinaire du 1er
juin, Gerhard Schröder imposera-t-il finalement sa vision. Mais à quel prix ? Lors
des réunions régionales, en avril-mai, pour préparer le congrès, des délégués, moroses,
prophétisaient que, si l’appareil serait tenu, la base, elle, s’éloignerait doucement.
Que faire ? En vérité, personne ne le sait avec certitude. Ni Gerhard Schröder,
qui comprend qu’il doit réformer mais qui, ne disposant pas d’une majorité incontestée
pour le faire, sera obligé d’accepter des compromis qui diminueront d’autant la
pertinence de ses solutions; ni ses adversaires, qui, tel Michael Sommer, le patron de la
Confédération des syndicats allemands (DGB), ne proposent qu’une classique politique de
relance par la consommation et l’endettement, sans être autrement impressionnés par la
profondeur des déficits actuels.
CRISE À MULTIPLES FACETTES
Au pouvoir depuis cinq ans, Gerhard Schröder paie le prix de la crise à multiples
facettes qui frappe la société allemande, soulignant sa rigidité à se réformer. La
social-démocratie a bâti sa force sur ses capacités redistributives. Des salariés bien
payés reversaient sous forme d’impôts une partie de leurs revenus, redistribués sous
forme de prestations sociales. Tant que l’économie allemande était en expansion, la
machine tournait.
Avec l’intensification de la concurrence internationale et les crises de conjoncture,
l’économie allemande a perdu de sa compétitivité. Le patronat a combattu le coût du
travail par des gains de productivité, délocalisant ou supprimant des centaines de
milliers d’emplois, dont les titulaires non seulement ne produisaient plus de prestations
sociales, mais en devenaient consommateurs. Le coût de la réunification, qui transfère
vers l’Est des milliards d’euros chaque année, et le vieillissement de la population, qui
accroît le coût général des retraites et de la couverture de la santé, ont fait le reste,
rendant étroite la marge de manœuvre de tout gouvernement.
«Notre difficulté actuelle provient des changements démographiques profonds que
nous n’avons pas vus ou voulu voir», explique Angelika Swhall-Düren, députée SPD de
Rhénanie-du-Nord-Wesphalie. Selon elle, le parti doit cheminer le long de deux axes: les
restrictions, pour réduire les coûts des prestations sociales, et la recherche de
financements nouveaux, pour assurer le paiement des prestations encore en place. «Un
équilibre délicat à maîtriser», admet la députée, qui craint autant de trop grandes
restrictions qu’un laisser-aller électoralement dévastateur.
Dans quels secteurs écrémer, selon quelle logique et pour préserver quels acquis jugés
plus importants que d’autres ? Cette discussion, pour l’instant, paraît négligée.
Personne n’ignore que l’Allemagne devra y songer, réfléchir sur son système de formation
trop rigide comme sur son absence de politique démographique.
Mais, poussé par l’ampleur des déficits, handicapé par une opposition qui ne lui fait
pas de cadeaux, et gêné par son aile gauche, le gouvernement de Gerhard Schröder paraît
gouverner à courte vue, soucieux d’assurer la survie du système par quelques mesures
conservatoires.
Georges Marion
| |
 ♦
 1990-1994: DRAMES
A peine François Mitterrand a-t-il commencé son second septennat que les socialistes
pensent à l’après-mitterrandisme. A Matignon, Michel Rocard, qui ne dispose que d’une
majorité relative à l’Assemblée et est flanqué de centristes dans son gouvernement,
inaugure une nouvelle forme de cohabitation avec le président de la République. Pierre
Mauroy vit son arrivée à la tête du PS comme une «épreuve». Il cherche le consensus et, à
défaut de numéro deux, s’entoure d’une direction collégiale avec quatre jospinistes
(Henri Emmanuelli, Daniel Vaillant, Gérard Le Gall et Jean-Jack Queyranne), un fabiusien
(Marcel Debarge) et un rocardien (Gérard Lindeperg). Ministre d’Etat et ministre de
l’éducation nationale, Lionel Jospin s’est résigné à organiser son courant. Il y a ses
complices de la «bande du XVIIIe» (arrondissement de Paris), où il a été député en 1981,
comme Bertrand Delanoë, Daniel Vaillant et Claude Estier, mais aussi ses amis Dominique
Strauss-Kahn et Claude Allègre. A la présidence de l’Assemblée nationale, Laurent Fabius
reçoit beaucoup. C’est le «socialisme hôtelier», ironisent ses détracteurs.
 |
<> Congrès de Rennes, mars 1990.
Fabius ne réussit pas à s’emparer du PS. |
NAUFRAGE À RENNES
Quand s’ouvre, le 15 mars 1990, le congrès de Rennes, tout est en place pour un drame.
Laurent Fabius est soupçonné de vouloir, avec l’appui de l’Elysée, prendre sa revanche
sur Mauroy. Lionel Jospin est suspecté de chercher à s’allier avec Rocard pour l’en
empêcher. François Mitterrand s’inquiète: «Cette bande de petits fonctionnaires mettra
trois jours à défaire ce que j’ai fait en vingt ans». Rêvant de consensus interne, le
premier secrétaire avait fait adopter, le 13 janvier à l’unanimité du comité directeur,
une nouvelle «déclaration de principes». Succédant à celles de 1905, 1946 et 1968,
elle proclame que le PS, favorable à «une société d’économie mixte», «met le
réformisme au service des espérances révolutionnaires». Sa ratification à Rennes
passe inaperçue. La pièce se joue à travers les sept motions qui s’affrontent:
Jospin-Mauroy-Mermaz (28,95%); Poperen (7,2%); Rocard (24,2%); Jean-Luc Mélenchon
(1,35%); Fabius (28,84%); Marie-Noëlle Lienemann (0,6%); Chevènement (8,5%). Les
tractations se passent la nuit. D’emblée, Jospin et Mauroy s’allient avec Socialisme
et République, le nouveau courant de Chevènement, pour dégager «un nouvel axe
politique». Fabius, qui tente de faire de même avec Poperen, dénonce une «logique
d’écartement». Le premier ministre, Michel Rocard, fait semblant de ne pas voir les
fissures: «Jamais, depuis 1905, les socialistes n’ont été aussi unis sur le fond. Qui
donc pourrait imaginer que pour gagner les échéances qui nous attendent, on ne trouve pas
ensemble les trois premiers ministres socialistes de François Mitterrand et les deux
premiers secrétaires qui lui ont succédé à la tête du parti ?» Peine perdue.
DÉFAITES EN SÉRIES
Pierre Mauroy parle de divisions «artificielles» et cherche, contre l’avis de
Jospin, un accord avec un Fabius qui proclame qu’il faut «ancrer très résolument
l’action de notre gouvernement à gauche». Le président de l’Assemblée veut un poste
de numéro deux et de surcroît la Fédération des élus socialistes, exigence que l’Elysée
juge excessive. Peine perdue. Au matin du 18 mars, après une nuit de conciliabules
houleux, il n’y a pas de synthèse. Les militants huent les éléphants et Mauroy pose au
final seul à la tribune avec une rose abîmée… Trois jours plus tard, sur injonction de
Mitterrand, une synthèse rassemble tous les courants sur un texte, «Rassembler à
gauche». Pierre Mauroy est réélu à l’unanimité. Réunis dans une même opposition à
la participation française à la guerre du Golfe, Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon
fondent, en septembre 1991, la Gauche socialiste.
 |
<> Matignon, avril 1992.
Pierre Bérégovoy
succède à Edith Cresson. |
Du 13 au 15 décembre 1991, le PS tient un congrès extraordinaire à l’Arche de la
Défense, un essai de Bad-Godesberg à la française. Michel Charzat présente «un nouvel
horizon pour la France» qui propose un «rapport critique avec le capitalisme».
Le 9 janvier 1992, Mauroy abandonne la direction du PS à Fabius, à partir d’un partage du
pouvoir qui fait de Rocard le «candidat virtuel» à l’Elysée. En avril 1992, Pierre
Bérégovoy succède à Edith Cresson à Matignon. La cinglante défaite législative du PS en
mars 1993 oblige, le 3 avril, Fabius à jeter l’éponge. Le 25 avril, Jean-Pierre
Chevènement, qui avait fondé à l’automne 1992 le Mouvement des citoyens (MDC), rompt avec
le PS. Président provisoire du PS, Michel Rocard organise les états généraux des
socialistes en juillet 1993 à Lyon. En octobre, le congrès du Bourget l’élit premier
secrétaire. Le fiasco de sa liste aux européennes de 1994 (14,5%) entraîne sa chute à la
suite d’un «putsch» le 19 juin 1994. Henri Emmanuelli lui succède. Au congrès de Liévin, du
18 au 20 novembre 1994, où il est réélu à 87%, il imprime une ligne «à gauche toute»
et invite Jacques Delors à «faire son devoir» en se présentant à l’Elysée.
 ♦
 | |
POUR NYRUP ANCIEN PREMIER MINISTRE SOCIAL-DÉMOCRATE DANOIS
«La réforme, c’est donnant-donnant»
Le rapporteur sur la mondialisation et la modernisation du parti des socialistes
européens estime que «sans nouveau projet global commun, les socialistes seront perdants»
Il y a un sommet des leaders socialistes le 22 mai, à Berlin, le premier depuis
l’Irak. Va-t-on pouvoir se parler ?
Nous allons tous essayer de nous concentrer sur le futur, pas sur le passé. On va
profiter de l’occasion pour voir comment réussir le processus de paix en Irak, pour
discuter du Proche-Orient, de la globalisation, du processus de Lisbonne. La défense sera
une autre question. La France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg ont pris une
initiative. Au-delà, il faut savoir si nous sommes d’accord entre socialistes sur la
nécessité de renforcer la dimension de défense de l’Union européenne, pour être capable
d’être plus actif quand on en arrive à une situation de conflit, après que tous les
autres moyens ont été utilisés pour trouver une solution. Il ne s’agit pas de faire de
l’Europe une puissance militaire. Mais l’UE doit avoir des capacités importantes. C’est
pénible pour tout le monde de devoir faire appel à l’assistance américaine pour transporter
des soldats en Macédoine.
Bien que majoritaires durant «l’Europe rose», à la fin des années 1990, socialistes
et sociaux-démocrates ont été rarement capables de parler d’une seule voix sur les grands
sujets européens…
Les partis socialistes en Europe sont au début d’une nouvelle époque. Au XXe siècle,
après deux guerres mondiales, la construction de l’Etat-providence a été le grand
objectif politique pour protéger l’être humain, instaurer la sécurité et assurer un
meilleur futur pour l’individu. Au XXIe, c’est la poursuite de ce combat, mais dans
d’autres termes et d’autres structures. Nous vivons dans un monde globalisé, avec une
interdépendance que nous n’avons jamais connue. La gauche doit trouver une réponse.
Dans les deux rapports au Parti des
socialistes européens (PSE) que nous achevons, sur la mondialisation et sur le processus
de modernisation lancé au sommet européen de Lisbonne, en 2001, nous voulons faire
émerger une nouvelle vision politique. Dans le passé, notre tâche était de procurer des
emplois, une meilleure éducation, des logements. La réponse a été l’Etat-providence. Le
résultat de cette politique a été l’émergence de l’individu, de l’individualisme. Un
mouvement socialiste moderne doit comprendre que l’individu d’aujourd’hui veut décider
par luimême plus que dans le passé; cela dans un monde en changement permanent.
Quelles pistes suggèrent vos rapports ?
Il y a deux voies pour l’Europe: la première est la réponse nationaliste et populiste,
qui propose aux gens de se concentrer sur leur quotidien et de fermer la porte au reste
du monde; la deuxième, que doivent emprunter les socialistes, est de rechercher comment
intégrer la mondialisation et l’Europe dans ce processus. Avant, on a mis l’Etat au sommet
de l’édifice, pour équilibrer l’individu et le marché; au XXIe siècle, au sommet du
triangle, il y a l’individu; l’Etat est toujours là, mais dans un autre rôle, pour encadrer
le marché, et, avec l’Europe, pour développer une stratégie commune face à la globalisation.
Il faut refonder l’Etat, refonder l’Europe, créer une gouvernance globale pour surmonter
le sentiment d’insécurité des gens et trouver de nouvelles réponses politiques.
Sur ces sujets, il n’y a souvent pas les mêmes langages à gauche…
Les différents pays n’ont pas été touchés au même moment, ni dans les mêmes
circonstances, par la globalisation. Mais la nouvelle situation oblige à regarder d’un
œil nouveau nos différences historiques: nos partis se trouvent dans la même situation
face à la globalisation et à l’Europe. Cela n’était pas le cas avant. Pour des raisons
pratiques, mais aussi politiques et idéologiques, les chances de se rapprocher les uns
des autres sont plus grandes qu’elles l’ont été depuis des années.
N’est-ce pas une vision idéaliste, au moment où l’Irak a encore accru le fossé
entre les divers camps socialistes ?
Sur le plan de la politique extérieure et de défense, l’Irak a servi de catalyseur
pour montrer l’ambiguïté des discours tenus jusqu’ici sur la nécessité d’une politique
commune. En ce sens, cela a été utile pour clarifier ce que l’on veut faire. Sur les
autres questions – comment combattre le chômage, s’attaquer aux réformes, quelle réponse
européenne à la mondialisation ? – la réponse est de renforcer le processus de
Lisbonne. Il permet d’avancer avec ceux qui ne peuvent pas accepter une harmonisation
totale des politiques sociales, d’éducation, mais qui sont prêts à accepter que l’UE aide
à mieux coordonner les politiques. Probablement un jour viendra où il sera possible de
légiférer ensemble dans ces domaines. Mais on ne peut pas attendre jusque-là.
Quelles réformes privilégiez-vous ?
| Il faut proposer
un nouvel équilibre, un nouveau projet global commun |
Pendant les neuf ans où j’ai dirigé le gouvernement danois, j’ai eu beaucoup de
discussions avec les syndicats. J’ai réalisé que beaucoup de gens pensent aux réformes
comme si on allait leur prendre quelque chose. Or la réforme a pris un sens nouveau:
c’est un deal, donnant-donnant. Oui, nous réformons en reprenant quelque chose, mais nous
redonnons autre chose qui permet aux gens d’être mieux armés pour les temps modernes.
Exemple: avant, on pouvait compter sur la durée pour assurer aux travailleurs la sécurité
économique et sociale. Aujourd’hui, dans une période de changements permanents, on ne
peut plus assurer aux travailleurs un travail pour toute la vie, mais il faut leur donner
les moyens de s’adapter de manière permanente au changement. Il faut réformer nos
sociétés, mettre en place un système égalitaire où chacun aura accès à la formation
nécessaire, bref: une politique active du marché du travail. Ce processus de réforme doit
être initié au niveau européen et national. Les partis socialistes en France, en Italie
et en Allemagne commencent à bouger. Il faut proposer un nouvel équilibre, un nouveau
projet global commun, dans lequel les gens retrouvent leur compte. Si nous ne le faisons
pas, nous risquons d’être les perdants.
Propos recueillis par Henri de Bresson
L'ÉTAT DES FORCES AU CŒUR DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE HISTORIQUE
|
FRANCE
PS: Parti socialiste
Fondé en 1905: SFIO
en 1971: PS
Dans l'opposition depuis 2002
ALLEMAGNE
SPD: Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
Fondé en 1863
Parti social-démocrate
d'Allemagne
Au pouvoir depuis 1997
ROYAUME-UNI
Labour party
Parti travailliste
Fondé en 1900
Au pouvoir depuis 1997
ESPAGNE
PSOE: Partido Socialista
Obrero Espanol
Fondé en 1879
Parti socialiste ouvrier espagnol
Dans l'opposition depuis 1996
ITALIE
SDI: Socialisti Democratici
Italiani
Fondé en 1998
Socio-démocrates italiens
Dans l'opposition depuis 2001
DS: Democrati di Sinistra
Fondé en 1991
Démocrates de gauche
Dans l'opposition depuis 2001
|
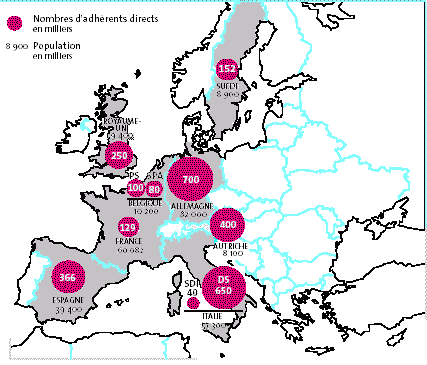
|
SUÈDE
SAP: Sveriges
Socialdemokratiska
Arbetareparti
Fondé en 1889
Parti social-démocrate
Au pouvoir depuis 70 ans
Liens étroits avec le syndicat
LO (Landsorganisationen)
|
AUTRICHE
SPÖ: Sozialdemokratische
Partei Österreichs
Parti social-démocrate
d'Autriche
Fondé en 1888
Dans l'opposition depuis 1999
|
BELGIQUE
PS (francophone)
Fondé en 1979
Parti socialiste
Au pouvoir dans des coalitions
SPA: Socialistiche Partij
Fondé en 1889
Parti socialiste autrement
Au pouvoir dans des coalitions
|
Blair, exemple et épouvantail
Une image écornée au PS
AU QG de campagne du député Arnaud Montebourg, la question s’est posée dès octobre
2002: adopter le nom de Nouveau Parti socialiste (NPS) pour donner naissance à un nouveau
courant, tout en tirant sur le «vieux parti», n’était-ce pas prendre le risque de faire
un peu trop «New Labour» ?
Le doute a été balayé, mais il est révélateur du rôle d’épouvantail que jouent Tony
Blair et sa fameuse «troisième voie» auprès des socialistes français. Encore que !
Lors des débats préparatoires du congrès de Dijon, François Hollande et ses partisans
ont souvent opposé à leurs adversaires l’exemple anglais pour défendre leur «réformisme
de gauche». Opter pour une voie plus radicale, expliquaient-ils, c’est prendre le risque
de se retrouver dans l’opposition pour vingt ans, à l’image des travaillistes
britanniques, dont la traversée du désert a commencé en 1979, après un congrès déchirant,
justement, pour s’achever en mai 1997.
Mais voilà qu’après la rivalité Jospin-Blair pour incarner une gauche «réelle», la
seconde guerre d’Irak a porté une nouvelle et sérieuse estafilade dans les relations
compliquées qu’entretiennent les socialistes des deux côtes de la Manche. D’épouvantail
étiqueté libéral de gauche, le «soldat Tony Blair» – dixit Henri Emmanuelli – a endossé,
à cette occasion, la panoplie du «traître», voire de l’«ennemi». Alors que le débat sur
la mondialisation et la construction européenne battait son plein, dans les discussions
d’avant-congrès au PS, la querelle s’est intensifiée.
«L’unilatéralisme américain et la mondialisation libérale procèdent d’une même
logique», écrivent ainsi Henri Emmanuelli et Jean-Luc Mélenchon dans leur motion.
«C’est parmi les défenseurs sociaux-démocrates les plus enthousiastes de la
mondialisation que l’on rencontre les plus grands atlantistes», dénoncent-ils,
évoquant «l’ampleur du désaccord» avec ceux, dont Tony Blair, qui ont apporté leur
soutien à George W. Bush. Dans ce contexte, François Hollande, vice-président du Parti
des socialistes européens (PSE), a accueilli comme une bouffée d’oxygène la démission du
gouvernement britannique de Robin Cook, président du PSE.
Mais, parmi ses partisans, il se trouve pourtant des personnalités pour assumer
ouvertement une proximité de pensée avec Tony Blair. «Pour moi, il n’est pas
Thatcher, affirme Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Ile-de-France.
Ses thèses sur la troisième voie ont évolué, il est revenu à gauche, notamment sur la
question des services publics, ajoute ce proche de Dominique Strauss-Kahn. Entre
Blair et Schröder, je ne sais pas aujourd’hui lequel est plus à droite.»
Alors, «en partie, oui», le premier ministre britannique reste un
«modèle» pour Michel Rocard. Ce dernier l’affirmait «sans blaguer» le 4
mai: Blair est «un modèle dans ce sens qu’il a complètement accepté que la société
contemporaine a des contraintes terribles et que c’est une société où joue pleinement
la compétition. (…) C’est un vrai social-démocrate sur une ligne courageuse. En ce
moment, ajoutait-il, Blair augmente dramatiquement ses impôts pour sauver ses
services publics. En France, ça ne serait déjà pas si mal, ça !».
Isabelle Mandraud
 ♦
1995-2003: SÉISMES
Au début de l’année 1995, le Parti socialiste est un «champ de ruines», selon la
formule de Michel Rocard. Lourdement défait aux législatives de 1993, il n’a plus que 54
députés. Son incapacité à enrayer la montée du chômage jointe aux affaires, notamment
l’affaire Urba sur son financement politique, a conduit à une Bérézina électorale.
Malade, François Mitterrand entame une seconde cohabitation avec, cette fois, Edouard
Balladur à Matignon. Pis, après la défection de Jacques Delors, le PS n’a plus de
candidat naturel ou virtuel à l’Elysée.
Retiré sur l’ Aventin depuis sa mise à l’écart du gouvernement de Pierre Bérégovoy,
Lionel Jospin hésite sur son avenir politique. Déjà, en 1992, il s’était tenu en dehors
du partage du pouvoir esquissé par Pierre Mauroy quand il avait confié les clefs du PS
à Laurent Fabius en faisant de Michel Rocard le candidat virtuel à l’Elysée.
Les trois succès de Jospin
Aux législatives de 1993, Jospin est battu en Haute-Garonne. Le 3 avril, il annonce
son retrait: «J’ai été battu, nous avons été battus. Il faut en tirer les
conséquences. Moi, j’ai décidé de m’éloigner de l’action politique et je pense que ça
devrait inspirer certaines démarches». Dès le congrès du Bourget, en octobre, il est
de retour, faisant dire à ses adversaires qu’il a fait sa «traversée du bac à
sable»...
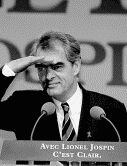
| | ♦ 1995, Emmanuelli va céder sa place à la tête du PS à
Jospin. |
Lorsque Michel Rocard est renversé, le 19 juin 1994, Jospin reste neutre et laisse son
propre courant exploser. Deux des ses amis, Dominique Strauss-Kahn et Henri Emmanuelli,
incarnant l’un la modernité l’autre la tradition socialistes, briguent la succession. Le
député des Landes l’emporte sans que Jospin s’en mêle. Pourtant, l’ancien ministre réunit
de nouveau ses fidèles, quitte à les surprendre, le 4 janvier 1995, en annonçant à un
bureau national du PS ébahi, sa candidature à la candidature. La primaire qui suit
l’oppose au premier secrétaire en place. Avec 65,83% des voix des militants, il l’emporte
largement sur Henri Emmanuelli, soutenu par Fabius. Lionel Jospin mène campagne sans la
mobilisation de l’appareil socialiste, sans le soutien – non sollicité – de François
Mitterrand et crée de nouveau la surprise en arrivant en tête au premier tour, avec 23,3%.
Le candidat, qui avait commencé dans son livre L’Invention du possible, en 1992,
à dresser le bilan contrasté du mitterrandisme, invente, le 9 avril 1995 au parc floral de
Vincennes, le «droit d’inventaire». La vieille garde socialiste grimace. Au second
tour, Jospin obtient 47,36%.
Fort de ce premier succès électoral, Lionel Jospin part à la reconquête du PS. Avec
panache, Henri Emmanuelli, qui vit douloureusement sa mise en examen dans l’affaire Urba,
avec le sentiment de payer seul pour tout le parti, se retire. Le 14 octobre 1995, Jospin
est triomphalement élu au vote direct des militants premier secrétaire du PS. Il s’appuie
sur trois piliers: le premier, le plus robuste, est composé des rénovateurs proches de
Martine Aubry, des rocardiens, des mauroyistes et des... jospinistes; le second, plus
sensible aux aléas de l’histoire, est composé des fabiusiens; le troisième, friable et
résigné, comprend l’aile gauche.
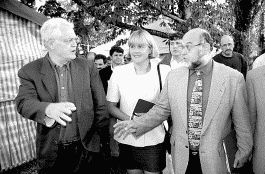
| | ♦ 1995, les leaders de la «gauche plurielle», Jospin,
Voynet et Hue. |
LES DEUX 21 AVRIL
Avec une équipe resserrée et œcuménique, Lionel Jospin remet le PS au travail. L’année
1996 est jalonnée par trois conventions sur l’Europe et la mondialisation, la démocratie
et la politique économique. Le PS tente de se réarmer doctrinalement et de préparer les
législatives de 1998. Mais, le 21 avril 1997, le président de la République, Jacques
Chirac, prononce la dissolution de l’Assemblée nationale. De ce séisme politique, Jospin
va faire son troisième succès, après la présidentielle de 1995 et le retour au PS.
Quand la dissolution survient, les socialistes sont prêts. Ils ont déjà investi leurs
candidats, avec 30% de femmes, conclu un accord électoral avec les Verts et n’ont plus
qu’à boucler, à la va-vite, celui avec le PCF de Robert Hue.
Dans le prolongement des Assises de la transformation sociale, lancées fin 1993 par
Michel Rocard avec le concours de Jean-Christophe Cambadèlis, Jospin met sur pied la
«gauche plurielle» avant même qu’elle ne devienne majoritaire, le 1er juin 1997. Lionel
Jospin est nommé premier ministre. Il prend la tête d’une équipe de gauche plurielle,
avec le PC, les Verts, les radicaux de gauche et le Mouvement des citoyens de Jean-Pierre
Chevènement, seul à ne pas aller jusqu’au bout de l’aventure en raison d’un désaccord sur
la Corse. Jospin confie le PS à l’ancien transcourant François Hollande, élu en novembre
1997, réélu en novembre 2000. Fort de son bilan, des 35 heures à la réduction du chômage,
Lionel Jospin se porte candidat à l’Elysée. Mais, le 21 avril 2002, il est éliminé au
premier tour. Un séisme que le PS va tenter de surmonter.
Michel Noblecourt
 ♦
| |

L E S O C I A L I S M E
l e s o r i g i n e s
| |
 JULES GUESDE (1845-1922). Marxiste de la première heure,
avec la création du journal L’Egalité (1877), il fonde le Parti ouvrier français
(1882), puis est élu député de Roubaix (1893). Avant, comme après la création de la SFIO,
en 1905, il défend, contre Jaurès, des thèses collectivistes rigoureuses. Il acceptera
d’être ministre d’Etat entre 1914 et 1916.
JULES GUESDE (1845-1922). Marxiste de la première heure,
avec la création du journal L’Egalité (1877), il fonde le Parti ouvrier français
(1882), puis est élu député de Roubaix (1893). Avant, comme après la création de la SFIO,
en 1905, il défend, contre Jaurès, des thèses collectivistes rigoureuses. Il acceptera
d’être ministre d’Etat entre 1914 et 1916. |
|  JEAN JAURÈS (1859-1914). Normalien, philosophe, député de
Carmaux (1893), dreyfusard combatif, il est le grand artisan, entre 1898 et 1905, de la
construction de l’unité des socialistes au sein de la SFIO. Opposé à la guerre, il est
assassiné par un nationaliste, le 31 juillet 1914, à la veille du déclenchement du
premier conflit mondial
JEAN JAURÈS (1859-1914). Normalien, philosophe, député de
Carmaux (1893), dreyfusard combatif, il est le grand artisan, entre 1898 et 1905, de la
construction de l’unité des socialistes au sein de la SFIO. Opposé à la guerre, il est
assassiné par un nationaliste, le 31 juillet 1914, à la veille du déclenchement du
premier conflit mondial
|
|
26 novembre 1900: Guesde et Jaurès s’affrontent devant 8 000 militants
D’OÙ vient la social-démocratie ? Dans le bouillonnement des courants
socialistes naissants de la fin du XIXe siècle, deux grandes orientations se dégagent,
incarnées par deux puissants orateurs, élus députés en 1893, le premier, Jules Guesde,
chez les ouvriers du textile de Roubaix, le second, Jean Jaurès, chez les mineurs de
Carmaux. Tous deux développent une analyse impeccablement marxiste du capitalisme et de
l’émancipation du prolétariat par la lutte des classes et la révolution.
Mais Guesde et ses partisans en font une lecture intransigeante, excluant toute
alliance entre le prolétariat et la bourgeoisie progressiste. Plus souple et acharné
à construire l’unité des socialistes – réalisée en 1905 –, Jaurès, au contraire, prend
fait et cause pour le capitaine Dreyfus, soutient la première participation
gouvernementale d’un socialiste, Alexandre Millerand, en 1899, défend l’action
parlementaire, plaide enfin pour des réformes améliorant le sort des ouvriers et
constituant, à ses yeux, non pas un renoncement mais le prélude à la révolution.
Les deux hommes s’affrontent le 26 novembre 1900, lors d’un grand débat organisé à
l’hippodrome de Lille, devant 8000 militants. Voici des extraits de leurs interventions.
Gérard Courtois
Révolution ou réforme
Jean Jaurès. Au nom de la lutte des classes, nous pouvons nous reconnaître
entre nous pour les directions générales de la bataille à livrer. Mais il ne vous est pas
possible, par la seule idée de la lutte des classes, de décider si le prolétariat doit
prendre part à la lutte électorale et dans quelles conditions; s’il peut ou s’il doit et
dans quelles conditions s’intéresser aux luttes des différentes fractions bourgeoises.
Dans chaque cas particulier, il faudra que vous examiniez l’intérêt particulier du
prolétariat. La société d’aujourd’hui est divisée entre capitalistes et prolétaires.
Mais en même temps, elle est menacée par le retour offensif de toutes les forces du
passé, de la barbarie féodale, de la toute-puissance de l’Eglise. Et quand la liberté
républicaine est en jeu, quand la liberté de conscience est menacée, quand les vieux
préjugés qui ressuscitent les haines de races et les atroces querelles religieuses des
siècles passés paraissent renaître, c’est le devoir du prolétariat socialiste de marcher
avec celle des fractions bourgeoises qui ne veut pas revenir en arrière.
Jules Guesde. Nous ne reconnaissons pas la lutte des classes, nous, pour
l’abandonner une fois proclamée. C’est le terrain exclusif sur lequel nous nous plaçons.
Malheur à nous si nous nous laissons arrêter le long de la route, attendant comme une
aumône les prétendues réformes que l’intérêt même de la bourgeoisie est quelquefois de
jeter à l’appétit de la foule, et qui ne sont et ne peuvent être que des trompe-la-faim.
Nous ne pouvons être qu’un parti de révolution, parce que notre émancipation et
l’émancipation de l’humanité ne peuvent s’opérer que révolutionnairement.
Nous détourner de cette lutte, camarades, c’est trahir, c’est déserter, c’est faire le
jeu des bourgeois d’aujourd’hui. Le jour où le prolétariat organisé pratiquerait la lutte
des classes sous la forme du partage du pouvoir politique avec la classe capitaliste, ce
jour-là il n’y aurait plus de socialisme.
Le bilan de l’affaire Dreyfus
Jean Jaurès. Il y a des heures où il est de l’intérêt du prolétariat d’empêcher
une trop violente dégradation intellectuelle et morale de la bourgeoisie elle-même. Voilà
pourquoi lorsque, à propos d’un crime militaire, une petite minorité bourgeoise, contre
l’ensemble de toutes les forces du mensonge déchaînées, a essayé de crier justice et de
faire entendre la vérité, c’était le devoir du prolétariat de ne pas rester neutre,
d’aller du côté où la vérité souffrait, où l’humanité criait. Peut-être les
révolutionnaires ont-ils trouvé que nous dépensions trop de notre force et de la force du
peuple dans ce combat. Mais, oui, il fallait poursuivre tous les faussaires, tous les
menteurs, tous les bourreaux, tous les traîtres. Il fallait les poursuivre à la pointe
de la vérité, comme à la pointe du glaive. Et c’est parce que, dans cette bataille, le
prolétariat a rempli son devoir envers luimême, envers la civilisation et l’humanité
qu’il est devenu le tuteur des libertés bourgeoises que la bourgeoisie était incapable de
défendre. C’est parce que prolétariat a joué un rôle décisif dans ce grand drame social
que la participation directe d’un socialiste [Alexandre Millerand] à un ministère
bourgeois a été rendue possible, signe éclatant de la croissance, de la puissance du
Parti socialiste.
Jules Guesde. On nous a dit: la lutte des classes ne défendait pas, elle
commandait au contraire au prolétariat, le jour où une condamnation inique était venue
atteindre un membre de la classe dirigeante, elle faisait un devoir, une loi aux
travailleurs d’oublier les iniquités dont ils sont tous les jours victimes. Le jour où un
capitaine d’état-major, le jour où un dirigeant de la bourgeoisie se trouvait frappé par
sa propre justice de classe, ce jour-là, le prolétariat devait tout abandonner, il devait
se précipiter comme réparateur de l’injustice commise.
Il a suffi qu’une première fois le Parti socialiste quittât fragmentairement son
terrain de classe; il a suffi qu’un jour il nouât une première alliance avec une fraction
de la bourgeoisie pour que, sur cette pente glissante, il menace de rouler jusqu’au bout.
Pour une œuvre de justice et de réparation individuelle, il s’est mêlé à la classe
ennemie, et le voilà maintenant entraîné à faire gouvernement commun avec cette classe.
Parlement et embourgeoisement
Jean Jaurès. Est-il juste, est-il sage, est-il conforme au principe, qu’un
socialiste participe au gouvernement de la bourgeoisie ? Nous savons très bien que
la société capitaliste est la terre de l’iniquité et que nous ne sortirons de l’iniquité
qu’en sortant du capitalisme. Mais nous savons aussi qu’il y a des ennemis plus forcenés
dans la société bourgeoise, des adversaires plus haineux et plus violents les uns que les
autres; et lorsque nous soutenons un ministère, ce n’est pas pour ce ministère, c’est
contre les autres plus mauvais qui voudraient le remplacer. L’heure viendra où le Parti
socialiste unifié, organisé, donnera l’ordre à l’un des siens, ou à plusieurs des siens,
d’aller s’asseoir dans les gouvernements de la bourgeoisie pour contrôler le mécanisme de
la société bourgeoise, pour collaborer le plus possible aux œuvres de réforme. À mesure
que grandit le pouvoir du Parti socialiste, grandit sa responsabilité. Mais de cette
responsabilité, nous n’avons pas peur. Pour faire œuvre de réforme et, dans la réforme,
œuvre commençante de révolution.
Jules Guesde. Il a fallu l’abandon de son terrain de classe par une partie du
prolétariat pour qu’à un moment donné on ait pu présenter comme une victoire la
pénétration dans un ministère d’un socialiste qui ne pouvait pas y faire la loi, d’un
socialiste qui devait y être prisonnier, d’un socialiste qui n’était qu’un otage. C’est
parce que le socialisme est devenu une force et un danger pour la bourgeoisie que
celle-ci à songé à s’introduire dans le prolétariat organisé pour le diviser et
l’annihiler. Mais ce n’est pas la conquête des pouvoirs publics par le socialisme, c’est
la conquête d’un socialiste et de ses suivants par les pouvoirs publics de la bourgeoisie.
Nous nous trouvons devant deux politiques: les uns préconisant la prise du pouvoir
politique en combattant, les autres poursuivant cette prise du pouvoir partiellement,
fragmentairement, homme par homme, portefeuille par portefeuille, en négociant. Nous ne
sommes pas pour le négoce: la lutte des classes interdit le commerce de classe.
| |

| | ♦ Congrès de Toulouse, 1908. Au centre (chapeau blanc), Marcel
Sembat, devant lui, Marcel Cachin. | |
[Incessant, ce débat est, à nouveau, au centre du congrès de la SFIO à Toulouse, en
1908. Paul Lafargue, gendre de Marx, exprime les positions de Jules Guesde, malade et
absent.]
Paul Lafargue. Je suis de ceux qui ont soutenu que le parlementarisme était la
forme de gouvernement propre à la classe bourgeoise, celle qui met entre les mains de la
bourgeoisie les ressources budgétaires et les forces militaires, judiciaires et politiques
de la nation. Les socialistes ne sont pas des parlementaires, ils sont au contraire des
antiparlementaires qui veulent renverser le gouvernement parlementaire, le régime du
mensonge et de l’incohérence. Le député qui prétend être le représentant de ses électeurs
ment, parce que son corps électoral est composé de bourgeois et d’ouvriers. Il ne peut
représenter les uns et les autres.
Jean Jaurès. Il ne s’agit pas pour nous d’une sorte de mécanisme réformiste. Je
ne crois pas plus à la fatalité de la réforme qu’à la fatalité de la révolution. Ce que
j’ai dit c’est que chaque réforme donnait à la classe ouvrière plus de force pour en
revendiquer et en réaliser d’autres. S’il y a une loi qui, malgré ses lacunes, malgré ses
vices, soit considérée par l’ensemble des ouvriers comme une loi bienfaisante, c’est la
loi d’assurance sur les accidents du travail, loi à coup sûr perfectible, mais de l’aveu
de tous les travailleurs soumis aux vicissitudes de la vie des ateliers, infiniment
supérieure au régime antérieur. (…)
La réforme des retraites
Jean Jaurès. (…) Pour les retraites ouvrières, c’est la même chose. C’est le
prolétariat européen qui, partout en Europe, directement ou indirectement, a imposé à
tous les pouvoirs, avant-hier en Allemagne, hier en France, aujourd’hui en Angleterre,
des projets variés de retraites ouvrières. Le nôtre, celui que les socialistes ont réussi
à perfectionner sérieusement devant la Chambre, je sais tous les reproches qu’on peut y
faire. Je comprends que nous discutions sur les modalités de ce projet, que nous
critiquions certaines de ces modalités, que nous cherchions le moyen de l’améliorer, je
comprends par exemple que plusieurs d’entre vous réclament qu’une part plus large soit
faite à la répartition et que la capitalisation, sans être supprimée, soit réduite à des
proportions moindres. Mais ce que je ne comprends pas c’est que le comité de la CGT dise
aux ouvriers: «Prenez garde, ce qu’on veut faire avec cette loi, c’est voler l’argent
des ouvriers». Cet enfantillage, ce sont des socialistes qui, les premiers, l’ont propagé
et accrédité.
Demain, si nous ne rectifions pas notre état d’esprit, si nous ne nous habituons pas
à être sérieux, à regarder toujours la réalité des choses, à mettre toujours nos pensées
en harmonie avec les actes et les faits, demain s’élargira de cercle en cercle, contre
les lois nécessaires, une suspicion, une défiance que nous aurons créées nous-mêmes.
C’est contre ce péril que je veux mettre en garde le Parti socialiste.
livres récents, sites internet et de recherche
EN LIBRAIRIE
UN AN APRÈS
de Pierre Moscovici
Codirecteur de la campagne de Lionel Jospin en 2002, proche de Dominique Strauss-Kahn
depuis, Pierre Moscovici revisite les échecs ou les autismes d’une gauche qui n’a «pas
su changer de logiciel». Il s’efforce d’inventer l’étape suivante.
Grasset, 418 p., 20,9 €.
COMMENT PEUT-ON ENCORE ÊTRE SOCIALISTE ?
de Julien Dray
Au-delà de l’échec électoral de la présidentielle, le député (PS) de l’Essonne, qui a
rompu avec Nouveau Parti socialiste pour rejoindre François Hollande, déplore la
«faiblesse culturelle» d’une gauche en panne d’idées.
Grasset, 273 p., 19 €.
LE BEL AVENIR DE LA GAUCHE
de Henri Weber
Le sénateur fabiusien de Seine-Maritime récuse les oraisons funèbres de la gauche et
ne veut pas désespérer des «capacités de rebond» de la social-démocratie européenne,
même si le salariat est, plus que jamais, sur la défensive».
Seuil, 206 p., 17 €.
L’ANNÉE ZÉRO DE LA GAUCHE
de Laurent Baumel et Laurent Bouvet
Récusant l’idée que le 21 avril 2002 ait été un accident, ces deux jeunes
intellectuels du PS dénonce son «immobilisme doctrinal» et prônent un réformisme
enfin assumé et ambitieux.
Michalon, 140 p., 12 €.
LE VOTE DE TOUS LES REFUS
sous la direction de Pascal Perrineau et Colette Ysmal
Les traditionnelles chroniques électorales du Cevipof analysent minutieusement les
causes, notamment sociologiques, de l’échec de Lionel Jospin en 2002, le lent déclin du
clivage gauche-droite et la restructuration de l’espace idéologique.
Presses de Sciences-Po, 444 p., 39 €.
L’ENCYCLOPÉDIE DU SOCIALISME
sous la direction de Denis Lefebvre
Cette nouvelle collection entend publier des essais sur l’histoire du socialisme ou
des textes de référence, souvent introuvables. Les quatre premiers volumes portent sur
l’histoire du PS entre 1965 et 1971, la biographie de Christian Pineau, le socialisme à
la fin du XIXe siècle et le discours de Léon Blum au congrès de Tours..
Chaque vol. 128 p., 7,5 €, diff. Dilisco.
SUR INTERNET
Fondation Jean-Jaurès (pdt: Pierre Mauroy):
http://193.45.254.92/affiche_site.pp
Cercle Galilée (Christian Paul, Vincent Peillon):
http://www.cercle-galilee.org
Socialisme et démocratie (Dominique Strauss-Kahn):
www.socialisme-et-democratie.net/
En temps réel (Zaki Laïdi):
http://en.temps.reel.free.fr/ETR_Semin_fr.htm
Convention pour la VIe République (C6R, Arnaud Montebourg):
http://www.c6r-fr.org/rubrique.php3?id_rubrique=7
Nouvelle Gauche (Benoît Hamon):
www.nouvellegauche.com/index.php
CENTRE DE RECHERCHE
Créé en 1969 par Guy Mollet, l’Office universitaire de recherche socialiste, l’OURS,
est un centre de recherche théoriques et historiques sur le mouvement socialiste.
Actuellement présidé par Alain Bergounioux, ce centre dispose d’une bibliothèque de
15 000 volumes et d’un remarquable ensemble d’archives, en particulier sur la SFIO.
86, rue de Lille, 75007 Paris,
www.lours.org |
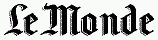
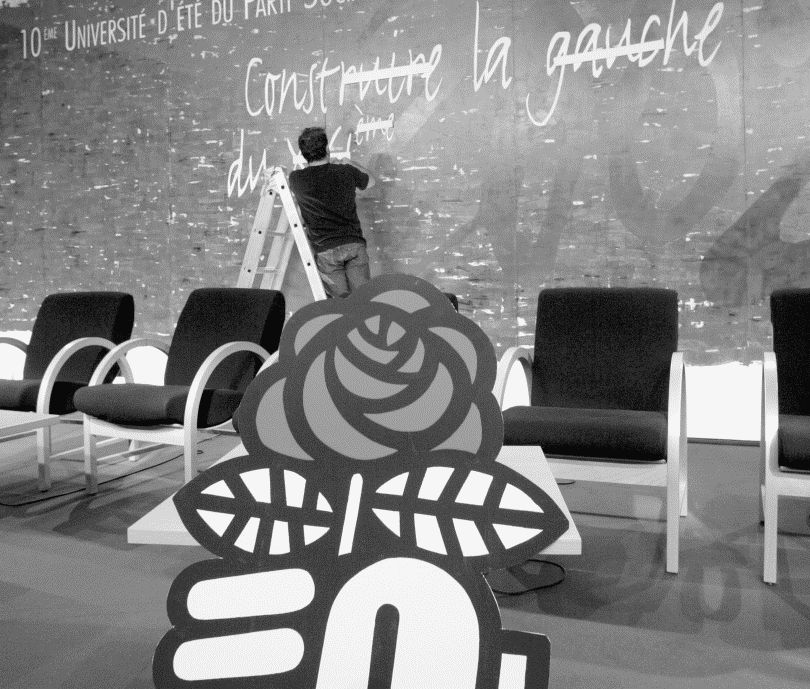

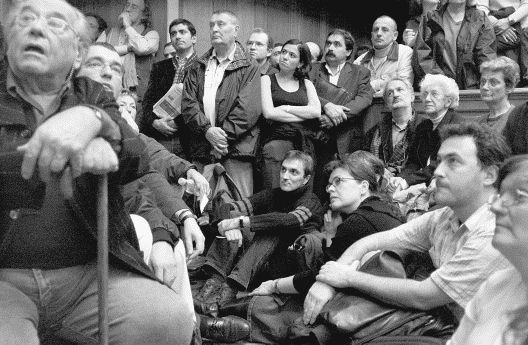

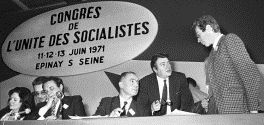








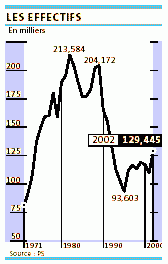 Le nombre des adhérents du PS est rythmée par les élections présidentielles et
législatives et par les événements internes. Avant Epinay, le PS ne compte que
70 392 membres. Dès 1971, le PS est renforcé par 10 000 conventionnels. Il
progresse jusqu’à la défaite législative de 1978 (180 000), rechute ensuite pour
progresser de nouveau avant la présidentielle de 1981. Il atteint son record en 1982 avec
213 584 adhérents. Il baisse de 1983 à 1987, remonte à 204 172 en 1989,
dégringole après le congrès de Rennes en 1990 (165 186) et la défaite de 1993
(113 005), remonte après le retour de Lionel Jospin (111 536 en 1996), et la
victoire législative de 1997 (116 708). Avec 129 445 membres en 2002, le PS se
retrouve sous le niveau de 1974.
Le nombre des adhérents du PS est rythmée par les élections présidentielles et
législatives et par les événements internes. Avant Epinay, le PS ne compte que
70 392 membres. Dès 1971, le PS est renforcé par 10 000 conventionnels. Il
progresse jusqu’à la défaite législative de 1978 (180 000), rechute ensuite pour
progresser de nouveau avant la présidentielle de 1981. Il atteint son record en 1982 avec
213 584 adhérents. Il baisse de 1983 à 1987, remonte à 204 172 en 1989,
dégringole après le congrès de Rennes en 1990 (165 186) et la défaite de 1993
(113 005), remonte après le retour de Lionel Jospin (111 536 en 1996), et la
victoire législative de 1997 (116 708). Avec 129 445 membres en 2002, le PS se
retrouve sous le niveau de 1974.
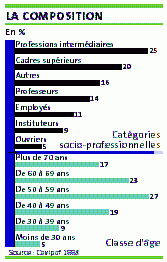 Le PS vieillit. L’étude du Cevipof, réalisée par Françoise Subileau, Colette Ysmal
et Henri Rey, sur les adhérents socialistes en 1998, est la dernière réalisée à une
échelle aussi importante (12 291 réponses à un questionnaire publié dans L’Hebdo
des socialistes). Mais les lecteurs de L’Hebdo sont sensiblement plus âgés que
les militants. Il reste que, par rapport à la précédente enquête de 1985, 67% ont 50 ans
et plus (contre 39%). En treize ans, le PS s’est peu féminisé et les femmes ne
représentent qu’un gros quart des adhérents. Le recrutement en milieu ouvrier faiblit (5%
contre 10%) et celui dans les classes moyennes progresse. Malgré l’obligation statutaire,
35% ne sont pas syndiqués, 24% sont à la CFDT, 12% à la FEN, 6% à la CGT et 6% à FO.
Le PS vieillit. L’étude du Cevipof, réalisée par Françoise Subileau, Colette Ysmal
et Henri Rey, sur les adhérents socialistes en 1998, est la dernière réalisée à une
échelle aussi importante (12 291 réponses à un questionnaire publié dans L’Hebdo
des socialistes). Mais les lecteurs de L’Hebdo sont sensiblement plus âgés que
les militants. Il reste que, par rapport à la précédente enquête de 1985, 67% ont 50 ans
et plus (contre 39%). En treize ans, le PS s’est peu féminisé et les femmes ne
représentent qu’un gros quart des adhérents. Le recrutement en milieu ouvrier faiblit (5%
contre 10%) et celui dans les classes moyennes progresse. Malgré l’obligation statutaire,
35% ne sont pas syndiqués, 24% sont à la CFDT, 12% à la FEN, 6% à la CGT et 6% à FO.
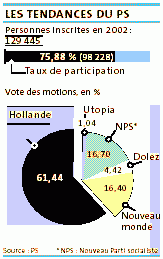 Le résultat des votes sur les motions pour le congrès de Dijon est clair: la motion
de François Hollande l’emporte largement avec 61,44% face aux quatre autres motions. Mais
par rapport au précédent congrès de Grenoble, en novembre 2000, le texte du premier
secrétaire qui s’appuyait sur un rassemblement un peu plus large (avec cette fois Julien
Dray et Marie-Noëlle Lienemann dans son camp) recule de 11,5 points, son opposition,
fragmentée, se renforçant d’autant. Si on met à part le congrès de Rennes, c’est le score
le plus faible pour la direction depuis le congrès de Metz (46,99%). Le score de M.
Hollande se rapproche, sans l’atteindre, de celui obtenu par François Mitterrand, au
congrès de Grenoble (65,35%), où quatre motions s’affrontaient.
Le résultat des votes sur les motions pour le congrès de Dijon est clair: la motion
de François Hollande l’emporte largement avec 61,44% face aux quatre autres motions. Mais
par rapport au précédent congrès de Grenoble, en novembre 2000, le texte du premier
secrétaire qui s’appuyait sur un rassemblement un peu plus large (avec cette fois Julien
Dray et Marie-Noëlle Lienemann dans son camp) recule de 11,5 points, son opposition,
fragmentée, se renforçant d’autant. Si on met à part le congrès de Rennes, c’est le score
le plus faible pour la direction depuis le congrès de Metz (46,99%). Le score de M.
Hollande se rapproche, sans l’atteindre, de celui obtenu par François Mitterrand, au
congrès de Grenoble (65,35%), où quatre motions s’affrontaient.



 «Nous sommes à la fin d’un cycle général de l’idée
socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a
toute une histoire à refaire. Tout le projet d’émancipation est à refonder».
PIERRE ROSANVALLON
«Nous sommes à la fin d’un cycle général de l’idée
socialiste; pas simplement la fin d’un élément de la culture socialiste. Il y a
toute une histoire à refaire. Tout le projet d’émancipation est à refonder».
PIERRE ROSANVALLON «Nous sommes dans l’épuisement d’une
parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du nouveau
capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme a besoin
d’être refondé, pas réinventé». JACQUES GÉNÉREUX
«Nous sommes dans l’épuisement d’une
parenthèse d’immobilisme, de tétanie devant l’offensive du nouveau
capitalisme, qui se clôt. Le renouveau est là. Le socialisme a besoin
d’être refondé, pas réinventé». JACQUES GÉNÉREUX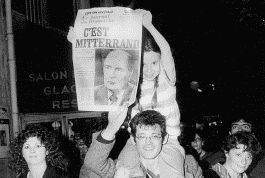

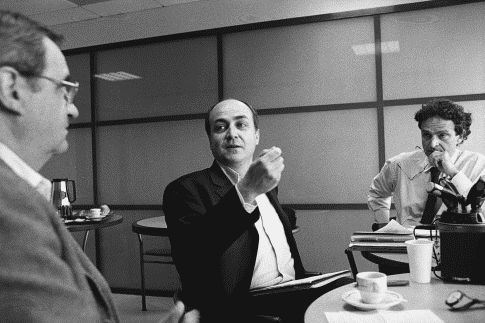
 «Le PS est-il à la hauteur des enjeux de la société ? Je suis
très inquiet. D’autant qu’un cycle de radicalisation apparaît dans la jeunesse, portée
par des idéaux nouveaux, parfois en train de basculer dans des chimères».
MARC LAZAR
«Le PS est-il à la hauteur des enjeux de la société ? Je suis
très inquiet. D’autant qu’un cycle de radicalisation apparaît dans la jeunesse, portée
par des idéaux nouveaux, parfois en train de basculer dans des chimères».
MARC LAZAR

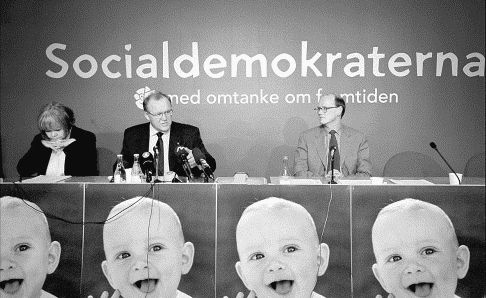


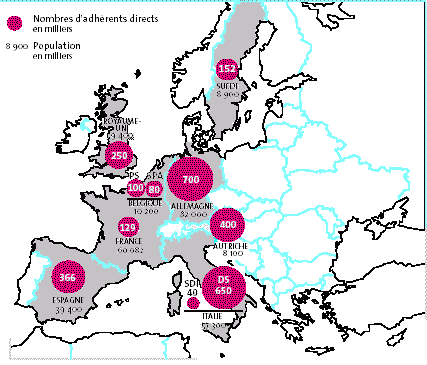
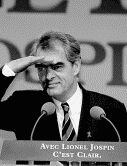
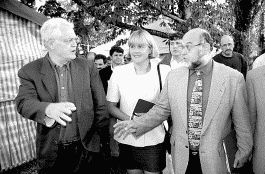
 JULES GUESDE (1845-1922). Marxiste de la première heure,
avec la création du journal L’Egalité (1877), il fonde le Parti ouvrier français
(1882), puis est élu député de Roubaix (1893). Avant, comme après la création de la SFIO,
en 1905, il défend, contre Jaurès, des thèses collectivistes rigoureuses. Il acceptera
d’être ministre d’Etat entre 1914 et 1916.
JULES GUESDE (1845-1922). Marxiste de la première heure,
avec la création du journal L’Egalité (1877), il fonde le Parti ouvrier français
(1882), puis est élu député de Roubaix (1893). Avant, comme après la création de la SFIO,
en 1905, il défend, contre Jaurès, des thèses collectivistes rigoureuses. Il acceptera
d’être ministre d’Etat entre 1914 et 1916. JEAN JAURÈS (1859-1914). Normalien, philosophe, député de
Carmaux (1893), dreyfusard combatif, il est le grand artisan, entre 1898 et 1905, de la
construction de l’unité des socialistes au sein de la SFIO. Opposé à la guerre, il est
assassiné par un nationaliste, le 31 juillet 1914, à la veille du déclenchement du
premier conflit mondial
JEAN JAURÈS (1859-1914). Normalien, philosophe, député de
Carmaux (1893), dreyfusard combatif, il est le grand artisan, entre 1898 et 1905, de la
construction de l’unité des socialistes au sein de la SFIO. Opposé à la guerre, il est
assassiné par un nationaliste, le 31 juillet 1914, à la veille du déclenchement du
premier conflit mondial
