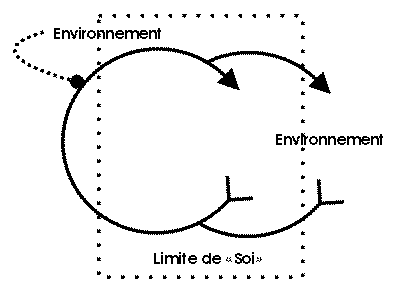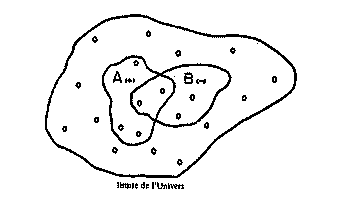Gregory Bateson & Jurgen Ruesch
Communication & Société
|

|

|

|
|
P A R T I E V I I – Information et codage
Gregory Bateson
|  |
S O M M A I R E
|
193
VII - Information et codage
– Approche philosophique –
Gregory Bateson
Jusqu'à présent, dans ce livre, il a été seulement question d'êtres humains,
en particulier des Américains et des psychiatres. Nous avons montré qu'il était
nécessaire d'intégrer deux catégories complémentaires d'informations pour
comprendre les théories et les pratiques qui ont cours en psychiatrie - à savoir,
connaître la matrice culturelle au sein de laquelle opère le psychiatre et
comprendre la nature de l'interaction qui se produit.
Ce chapitre et le suivant tenteront de réunir en une seule science ces deux sortes de
savoirs complémentaires. Nous tenterons une intégration des phénomènes humains d'ordre
culturel et des phénomènes d'interaction[1].
Pour ce faire, un retour aux principes fondamentaux sera nécessaire. 11 faudra
parler des phénomènes de communication tels qu'on les rencontre à de très bas
niveaux d'organisation chez des animaux et dans des machines en fonctionnement.
Partant de ce stade élémentaire, nous ajouterons progressivement des niveaux
supplémentaires de complexité, jusqu'à ce que nous arrivions à parler d'entités
qui se situent au niveau humain et culturel.
Ensuite, au chapitre X, on se servira de notre théorie complète pour
194
réexaminer certaines théories et certaines propositions des psychiatres américains.

EN QUOI CONSISTE LE CODAGE ?
Il est d'abord nécessaire de parler de certaines notions générales sur la nature des
processus intrapersonnels et neurophysiologiques - assez générales pour être
indépendantes des théories auxquelles le lecteur donne sa préférence. La notion de code
est, pensons-nous, d'une nature si universelle qu'elle est commune à toutes les théories
psychologiques, bien que ce ne soit pas toujours explicite.
Que nous soyons partisans des conceptions organicistes ou des conceptions mentalistes,
il est clair que les processus intrapersonnels sont distincts et différents des
événements du monde extérieur, et c'est le concept de codage qui renvoie à cette
différence. En termes organicistes, on pourrait dire que les impulsions et les ondées
d'impulsions qui circulent dans le système nerveux sont la représentation interne ou
l'image des événements extérieurs dont l'organisme reçoit des informations par ses
organes sensoriels. Ou bien, selon les théories mentalistes, on peut dire que les idées
et les propositions (qu'elles soient verbales ou non verbales) sont la traduction ou le
reflet d'événements extérieurs. Les tenants de l'une ou l'autre théorie - organiciste ou
mentaliste - conviennent que les événements intérieurs sont différents de ceux du dehors:
ils sont'des reflets ou des traductions d'événements qui se situent dans le monde
externe. Le terme qu'utilisent les ingénieurs des communications pour désigner le fait de
substituer un type d'événement à un autre, de sorte que l'événement substitutif
représente l'autre de quelque façon, c'est le terme «codage».
Les principes fondamentaux en fonction desquels l'information est codée dans le
cerveau ou dans l'esprit des êtres humains sont encore inconnus, mais, selon ce que
l'on sait des hommes et ce que les ingénieurs en communication peuvent nous dire,
certaines généralités se dégagent.
D'abord, il faut que le codage, par nature, soit systématique. Quels que soient
195
les objets, les événements ou les idées qui, à l'intérieur de l'individu, représentent
certains objets ou certains événements extérieurs, il faut qu'il y ait une relation
systématisée entre ce qu'il y a dehors et ce qu'il y a dedans; sans cela, l'information
ne serait pas utilisable. Pour les éléments qui ne sont pas systématisés dans un codage,
les ingénieurs emploient le terme de «bruit»; si ces éléments aléatoires étaient trop
nombreux, il n'y aurait pas de possibilité de «décodage» - c'est-à-dire pas de
possibilité pour l'organisme de se gouverner en fonction des événements extérieurs (À
strictement parler, il n'y a naturellement pas de «décodage», l'information codée, par
exemple sous la forme d'impulsions nerveuses, peut guider l'organisme dans ce qu'il fait
ou dans ce qu'il dit. Mais des productions de ce genre sont à nouveau des codages ou des
transformations des trains d'impulsions nerveuses. L'information n'est jamais retraduite
sous la forme même des objets auxquels elle renvoie).
Deuxièmement, il est évident qu'il faut que le codage soit tel que les relations entre
parties soient conservées. Il est impossible à un homme d'avoir à l'intérieur de lui-même
un arbre pareil à l'arbre qu'il perçoit à l'extérieur. Mais il est possible d'avoir des
objets ou des événements internes ayant entre eux des relations qui reflètent celles qui
existent entre les parties de l'arbre extérieur. Il est évident que des transformations
très profondes interviennent dans tout codage - et, en effet, le codage est une
transformation au sens mathématique du terme. On peut s'attendre, par exemple, à trouver
certains cas où des relations spatiales dans le monde extérieur sont représentées par des
relations temporelles dans le processus de l'esprit: quand l'œil inspecte un objet, la
forme de l'objet est certainement transformée en une séquence temporelle d'impulsions
dans le nerf optique. Et, dans d'autres cas, des séquences temporelles seront
représentées par des relations spatiales dans le cerveau: un souvenir de séquences
passées doit certainement être codé ainsi. Mais, quelles que soient les transformations
du codage, l'information serait purement et simplement perdue si les relations qui
existent entre les événements extérieurs n'étaient pas traduites d'une façon systématique
en d'autres relations équivalentes entre d'une part des événements et d'autre part des
processus de l'esprit [45; 182].
196
En outre, les ingénieurs [27] sont
capables de décrire plusieurs variétés de codage qui sont connues et avec lesquelles nous
pouvons comparer et confronter ce qui semble se produire dans les processus mentaux chez
les humains. En gros, il y a trois catégories importantes; on peut les rencontrer toutes
les trois dans les processus mentaux chez l'homme. Ces trois types de codage trouvent
aussi des exemples dans différentes sortes de machineries électroniques et on citera des
exemples mécaniques pour donner une idée plus nette de ce à quoi renvoie le terme «codage».
Premièrement, il y a ce que les ingénieurs appellent le codage «digital». C'est une
méthode utilisée couramment dans des machines à calculer de bureau; elles sont faites de
dents qui s'engrènent; ce sont essentiellement des mécanismes de calcul qui comptent les
dents qui s'engrènent et comptent combien de fois elles tournent dans une interaction
complexe. Dans ce type de codage, l'entrée diffère déjà très profondément des événements
extérieurs auxquels la machine «pense». En fait, avec des machines de ce genre, il faut
qu'il y ait un être humain qui code les événements extérieurs en des termes qui
correspondent à leurs relations arithmétiques, et il faut introduire ce codage dans la
machine d'une façon appropriée qui définisse quel problème elle doit résoudre.
Deuxièmement, il y a le type de machine à calculer que les ingénieurs appellent
«analogique». Dans ces équipements, les événements extérieurs à propos desquels la
machine doit «penser» sont représentés en elle par un modèle reconnaissable. Par exemple,
un tunnel de soufflerie est une machine à penser de ce genre. Dans de telles machines,
des changements dans le système extérieur peuvent être représentés par des changements
correspondants dans le modèle à l'intérieur, et l'on peut observer les résultats de cette
sorte de changements. Savoir si des mécanismes analogiques existent dans le système
nerveux central des humains est extrêmement problématique, mais subjectivement nous
croyons que nous formons des images du monde extérieur et ces images semblent nous aider
dans nos pensées. La nature de ces images conscientes est toutefois obscure et, en tout
cas, il est difficile d'imaginer que quelque véritable modèle analogique opère dans un
système tel que le système nerveux central qui n'a pas de parties mobiles. En dehors du
système nerveux central, cependant,
197
il y a une possibilité que l'ensemble des mobilités du corps soit utilisé comme composant
analogique. Il est probable, par exemple, que certaines personnes éprouvent par empathie
les émotions d'autres personnes par l'imitation kinesthésique. Dans cette façon de penser,
le corps serait un modèle expérimental analogique qui copierait des changements de
l'autre personne et les conclusions de ce genre d'expérience de simulation seraient tirées
par le système nerveux central, plus digital, qui reçoit des indications proprioceptives.
Il est certain également que les êtres humains utilisent souvent des parties du monde
extérieur comme modèles analogiques pour s'aider à résoudre leurs propres problèmes
internes. Par le fait, de nombreux patients utilisent le psychothérapeute de cette manière.
Troisièmement, il y a quelques machines qui sont capables de coder l'information
en unités comparables à ce que les psychologues appellent des Gestalten [108]. Un exemple de ce genre de machine est
l'appareil récemment inventé qui lit à haute voix ce qui est imprimé. La machine détecte
les vingt-six lettres et produit un son différent pour chaque lettre. En outre, elle
reconnaît ces lettres en dépit de petites différences entre diverses sortes et diverses
tailles de caractères d'imprimerie, et les lettres sont également reconnues quelle que soit
la place où leur image tombe sur l'écran. En somme, la machine doit admettre le déplacement
latéral et vertical sur une «rétine» et doit permettre de petits mouvements de rotation.
En réalisant ce genre d'identification, la machine fait quelque chose de très étroitement
comparable à cette perception des formes par laquelle un être humain sait qu'un carré est
un carré même si celui-ci peut être de n'importe quelle taille et présenté sous n'importe
quel angle. La caractéristique essentielle de cette sorte de machines, c'est qu'elles
peuvent identifier des relations formelles entre des objets et des événements du monde
extérieur et classer des groupes d'événements de ce genre en fonction de certaines
catégories formelles. Il est alors possible qu'un message qui dénote la présence d'un
événement correspondant à une certaine catégorie spécifique soit transmis, peut-être, par
un signal unique dans la machine. Cette dernière possibilité, de résumer un message
complexe en un unique «pip», c'est l'avantage que procure le codage en Gestalt. On
peut ainsi obtenir une énorme économie de communication à l'intérieur de la machine.
198
On peut donner un exemple de la différence fondamentale entre le codage par Gestalt
et un codage digital énumératif: on compare le codage dans le type de machine qui
transmettra par câble une image en demi-teinte et le genre de codage que nous appelons
vision. La machine transmet des millions de messages. Chaque message est la présence ou
l'absence d'un «pip», telle présence dénotant la présence ou l'absence d'un point sur le
bloc original. La machine n'est en aucune façon concernée par ce que le tableau représente.
Par contre, un être humain qui regarde un tableau de ce genre voit qu'il représente un
homme, un arbre ou Dieu sait quoi. L'ondée d'impulsions qui est initiée dans la rétine et
qui voyage le long du nerf optique, par certains côtés, n'est pas différente des trains
de «pips» transmis par la machine, mais, dans le cerveau, cette ondée nerveuse a un impact
sur un réseau qui a pour caractéristique d'être capable de distinguer des relations
formelles dans cette ondée - ces relations formelles sont, en fait, parentes de celles
qui existent dans le tableau original. L'être humain est ainsi capable de classer en
catégories de vastes secteurs du tableau sous forme de Gestalten.
La même vérité générale - que toute connaissance d'événements extérieurs est dérivée
des relations que ceux-ci entretiennent -, on peut la reconnaître dans ce fait: pour
parvenir à une perception plus exacte, un être humain aura toujours recours à un
changement dans la relation entre lui-même et l'objet extérieur. S'il est en train
d'examiner un point rugueux sur une surface au moyen du toucher, il fait bouger son
doigt sur ce point; il crée ainsi une ondée d'impulsions nerveuses qui a une structure
séquentielle définie; puis il peut dériver de celle-ci la forme statique et d'autres
caractéristiques de la chose examinée. Pour estimer le poids d'un objet, nous le
soupesons, et, pour inspecter soigneusement un objet qu'on voit, nous remuons les yeux
d'une manière telle que l'imagé de l'objet se déplace à travers la fovéa. En ce sens, nos
données initiales sont toujours des indications «dérivées premières»; elles sont des
énoncés à partir des différences qui existent à l'extérieur, ou bien elles sont des
indications sur des changements qui se produisent soit dans les objets, soit dans notre
relation à eux. Des objets ou des circonstances qui demeurent absolument stables par
rapport à l'observateur, sans changement dans leur propre mouvement, ni du fait
d'événements extérieurs, sont toujours difficiles, peut-être
199
même impossibles à percevoir. Ce que nous percevons facilement, c'est la différence et le
changement - et la différence est une relation.
Les tenants de la psychologie de la forme ont insisté sur la relation entre la «figure»
et le «fond», et, bien que notre préoccupation ne soit pas ici un exposé détaillé de la
psychologie de la forme, il nous faut souligner une caractéristique majeure du phénomène
figure-fond: il semble que la personne qui perçoit utilise le fait que certains organes
terminaux ne sont pas stimulés: ceci est un élément pour parvenir à une compréhension plus
complète de celles des impulsions qui proviennent des organes terminaux stimulés. Un sujet
humain, s'il place sa main dans une boîte illuminée et fermée, peut dire, à partir des
impulsions nerveuses de chaleur ou de douleur qui proviennent de sa main, qu'il y a
quelque chose d'allumé, mais il ne peut pas discriminer si la lumière vient d'une petite
source brillante ou bien si c'est une illumination générale de la boîte. Grâce à sa
rétine, par contre, il peut immédiatement percevoir la différence entre l'illumination
générale et une petite source de lumière. Ceci se fait en combinant dans le cerveau
l'information que certains organes terminaux ont été stimulés avec l'information que
certains autres ne l'ont pas été, ou ont été moins stimulés. De même, comme on l'a
remarqué précédemment dans la transmission d'un cliché en demi-teinte, l'absence de
«pip» sur le câble à un moment spécifique peut être un signal qui dénote l'absence d'un
point sur le tableau. (Le système mécanique aurait pu tout aussi facilement être réglé de
façon que l'absence d'un «pip» sur le câble dénote la présence d'un point sur le tableau).
Cette aptitude du cerveau humain à utiliser Yabsence de certaines impulsions
afférentes pour interpréter celles des impulsions qui parviennent effectivement semble
être une condition primordiale du phénomène figure-fond. On peut considérer la faculté
de distinguer entre l'illumination générale et une petite source de lumière comme une
forme élémentaire de perception de Gestalt.
En outre, il semblerait qu'en créant des Gestalten celui qui perçoit élimine
comme «fond» inutile un grand nombre d'impulsions qui, en fait, parviennent sur les
organes terminaux. La construction de Gestalten semblerait dépendre de quelque
chose comme l'inhibition - une négation partielle de certaines impulsions - qui permet
200
à celui qui perçoit de se consacrer aux «figures» qui sont importantes pour lui.
L'une des caractéristiques de l'information codée découle de ce qui a été dit plus
haut, spécialement dans la discussion de l'hypothèse figure-fond. C'est le fait que
l'information est toujours multiplicative. Chaque élément d'information a pour
caractéristique qu'il fait une assertion positive et qu'en même temps il fait une
dénégation de l'opposé de cette assertion. La perception la plus simple que l'on puisse
imaginer, sur laquelle on peut présumer que reposent, par exemple, les tropismes des
protozoaires, dira obligatoirement à l'organisme qu'il y a de la lumière dans telle
direction et pas de lumière dans telle autre direction. De nombreux éléments d'information
peuvent être plus compliqués que cela, mais il faut toujours que l'unité élémentaire
d'information contienne au moins ce double aspect d'affirmer une vérité et de nier quelque
autre contraire qui, souvent, n'est pas défini. De ceci découle que, lorsque nous avons
deux «bits» [155] d'information, la gamme
des événements extérieurs possibles auxquels peut référer cette information est réduite
non pas à la moitié mais au quart de ce qu'elle était au départ; de même, trois «bits»
d'information restreindront la gamme possible des événements extérieurs à un huitième.
La nature multiplicative de l'information peut être illustrée par le jeu des
vingt questions. Il faut que celui qui pose les questions dans ce jeu identifie
en vingt interrogations quel objet a en tête celui qui lui répond. Ce dernier ne
peut répondre aux questions que par «Oui» ou par «Non». Chaque réponse segmente
la quantité possible des objets auxquels pourrait penser le répondeur, et, si
celui qui interroge organise ses questions correctement, il peut en vingt
demandes trouver parmi quelque chose qui dépasse le million d'objets lequel est
celui que le répondeur a en tête (220 = 1.048.576).
L'interrogateur structure l'univers, possible des objets par un système ramifiant de
questions; ceci constitue ce que nous appellerions un «système de codage» et un petit
essai de ce jeu donnera au lecteur une idée des difficultés qui surviennent dans la
communication lorsque les deux personnes n'ont pas des systèmes de codage qui se
correspondent d'une façon précise - c'est-à-dire quand le répondeur comprend mal les
questions. Si le jeu est joué strictement selon les règles, il n'y a presque pas
201
de façons de corriger de tels malentendus: celui qui pose les questions ne peut guère
détecter ce qui est arrivé.

CODAGE ET VALEUR
En bref, le point de vue que nous défendrons ici, c'est que le système de codage et le
système des valeurs sont des aspects d'un même phénomène central. Cela fait deux mille ans
que les philosophes occidentaux sont incités à rechercher une relation précise entre la
notion de valeur et celle d'information. Il ne faut donc pas s'attendre à trouver dans ce
livre une formulation définitive. Il est cependant nécessaire de clarifier notre position
si nous voulons étudier comment se transmettent les valeurs et quel est leur impact.
Examinons d'abord certaines similitudes qui semblent communes aux valeurs et au codage.
- Le système des valeurs et le système de codage sont semblables en ce que chacun
est un système qui se ramifie à travers la totalité de l'univers de l'individu. Le
système des valeurs, tel qu'il est organisé en termes de préférences, constitue un
réseau dans lequel certains éléments sont choisis et d'autres sont laissés ou rejetés,
et ce réseau embrasse toutes choses dans la vie. De même, on a indiqué, en ce qui
concerne le système de codage, que tous les événements et toutes les choses qui se
présentent font, dans une certaine mesure, l'objet d'un classement dans le système
complexe des formes (Gestalten) qui est le système de communication humain.
- Une autre ressemblance provient du fait que, aussi bien dans le cas du codage que
dans le cas des valeurs, la classe niée n'est généralement pas définie. Dans le cas de la
préférence, un homme dira qu'il aime ceci ou cela, mais il oubliera souvent de définir
les alternatives auxquelles ceci ou cela est préféré. Inversement, il se peut qu'il dise
qu'il n'aime pas qui ou quoi et il omettra d'indiquer ce qu'il aimerait mieux. De la même
façon, dans le codage de l'information, les êtres humains écartent le
202
fond et observent la figure. Les gens diront que la figure a de la «signification» pour
eux; et ils diront que ce qui est préféré, ou bien ce qui n'est pas aimé, a une valeur,
par opposition à un fond indéfini d'alternatives.
- 11 est bien connu que le réseau de valeurs détermine partiellement le réseau de
perception. Ceci est illustré par des expériences d'Adalbert Ames junior. Dans ces
expériences, une personne est amenée à agir dans une situation où elle est soumise à une
illusion d'optique - c'est-à-dire qu'elle perçoit une Gestalt fausse. Bien qu'elle
sache qu'il y a illusion, il lui est presque impossible de corriger son action sinon en
multipliant les essais. Graduellement, le sujet apprend à corriger en fonction de la
forme dont il sait qu'elle correspond à la réalité même s'il ne peut pas voir que les
objets ont cette forme. Quand il parvient à la correction, l'image qu'il se fait des
objets change et il commence à les voir comme ils sont réellement - c'est-à-dire qu'il
commence à former une image telle que celle-ci lui permet, s'il agit en fonction de cette
image, d'atteindre le but qu'il s'est fixé.
Il est évident aussi que la perception détermine des valeurs: c'est en fonction de la façon
dont nous voyons les choses que nous agissons. Mais également le succès ou l'échec de notre
action déterminera notre vision ultérieure. Il est évident aussi que, en psychothérapie,
beaucoup de changements qui semblent être des changements dans le système des valeurs du
patient sont probablement des changements dans la façon dont il perçoit subjectivement les
choses. L'action semblerait être un moyen terme où se rencontrent perception et valeur.
- Il est bien connu que le désir et la perception coïncident partiellement. Cette
découverte est en fait l'une des contributions majeures de Freud. Non seulement chaque
être humain tend à voir dans le monde extérieur et en lui-même ce qui correspond à son
désir, mais, ayant vu dans le monde extérieur quelque chose, même de désastreux, il lui
faut encore désirer que son information soit vraie. Il lui faut agir en fonction de ce
qu'il sait - pour le meilleur et pour le pire - et, quand il agit, il éprouve de la
frustration et de la peine si les choses ne sont pas comme
203
il «sait» qu'elles sont. Par conséquent il lui faut, dans un certain sens, désirer
qu'elles soient comme il «sait» qu'elles sont.
- Le paragraphe précédent introduit une question d'une grande importance théorique:
c'est le problème de la relation entre le concept d'«information» et le concept
d'«entropie négative». Wiener [180] a
expliqué que ces deux concepts sont synonymes et cette proposition, à notre avis, marque
le plus grand changement dans la pensée humaine depuis l'époque de Platon et d'Aristote:
elle établit une liaison entre les sciences de la nature et les sciences humaines et
finalement elle explique les questions de téléologie et la dichotomie corps-esprit dont
la pensée occidentale a hérité de l'Athènes classique. Le concept d'entropie et le second
principe de la thermodynamique qui définit ce concept sont, toutefois, très vagues chez
beaucoup de chercheurs en sciences sociales, ce qui rend nécessaires quelques explications.
- Selon le second principe de la thermodynamique, tout système d'objets se trouvant
dans un état à partir duquel du travail peut être obtenu tendra à s'éloigner de cet état
si l'on permet que des événements aléatoires interviennent. L'exemple classique est celui
de molécules de gaz séparées dans deux récipients en fonction de leur vitesse
(c'est-à-dire de la température). Dans un tel système, a souligné Carnot, l'«énergie
disponible» du système est fonction de la différence de température entre le gaz contenu
dans chacun des deux récipients. Il a également montré qu'une énergie potentielle de
cette nature -c'est-à-dire de l'entropie négative - diminuera dans deux cas: si l'on fait
produire du travail au système, ou si l'on laisse se produire des événements aléatoires
tels que le mélange des molécules. Le système évoluera vers un état aléatoire le plus
probable - à savoir, vers l'entropie.
- Il est évident que Carnot et les autres ont appliqué leur propre système de valeurs
en tant qu'ingénieurs quand ils ont énoncé ces généralisations. Pour eux, l'«énergie
potentielle», c'était ce qu'ils désiraient dans les cylindres des moteurs thermiques.
- La loi de probabilité s'appliquera, toutefois, dans tous les cas; elle n'est pas
limitée aux cas dans lesquels l'ordonnancement est dû à la température, ou aux
circonstances dans lesquelles on peut obtenir un travail physique. Si, par exemple, un
204
jeu de cartes se trouve dans un certain état dans lequel on peut reconnaître un «ordre»,
le fait de battre les cartes désorganisera probablement cet arrangement.
- Wiener fait ressortir que toute la question des phénomènes d'entropie est
inévitablement liée au fait que nous sachions ou que nous ne sachions pas dans quel état
est le système. Si personne ne sait dans quel ordre sont les cartes dans le paquet, c'est
à tous égards et à toutes fins un jeu sans ordre. Par le fait, l'ignorance est tout ce
que l'on peut obtenir quand on bat un jeu.
- De ceci découle que le «système» dont on parle effectivement dans toute proposition
d'ordre et d'entropie négative inclut la personne qui parle; son propre système de
valeurs et son système de codage sont ainsi inextricablement impliqués dans tout énoncé
de cette sorte que cette personne peut faire.
- La relation entre information et valeur devient encore plus évidente lorsque l'on
examine le fait de poser des questions et d'autres formes de recherche d'information.
On peut comparer la recherche d'information et la recherche de valeurs.
Dans la recherche des valeurs, il est clair que, ce qui arrive, c'est qu'un homme cherche
à «piéger» le second principe de la thermodynamique. Il s'efforce d'interférer avec le
cours «naturel» ou aléatoire des événements, de façon à obtenir une issue qui, autrement,
serait improbable. Pour son petit déjeuner, il obtient un arrangement de bacon et d'œufs,
l'un à côté de l'autre, sur une assiette; et, pour obtenir cette improbabilité, il est
aidé par d'autres hommes qui trieront les porcs qu'il faut sur quelque marché lointain et
qui interféreront avec la juxtaposition naturelle des poules et des œufs.
De même, en faisant la cour à une certaine jeune fille, il essaiera de faire en sorte
qu'elle tombe amoureuse de lui - et il empêchera qu'elle se conduise d'une manière
aléatoire.
En bref, dans la quête de valeurs, il obtient une coïncidence ou une congruence entre
«quelque chose dans sa tête» - une idée de ce que devrait être le petit déjeuner - et
quelque chose à l'extérieur, un arrangement effectif d'œufs et de bacon. Il obtient
cette coïncidence par un changement dans ce qui est à l'extérieur.
205
Par contre, quand il cherche de l'information, là encore il essaie d'obtenir une
congruence entre «quelque chose dans sa tête» et le monde extérieur; mais maintenant il
essaie de faire cela en changeant ce qu'il y a dans sa tête.
Entropie négative, valeur et information sont en fait semblables dans la mesure où le
système auquel s'appliquent ces notions est «l'homme plus l'environnement», et, aussi bien
dans la recherche d'information que dans la recherche de valeur, l'homme essaie d'établir
entre des idées et des événements une congruence qui, autrement, serait improbable.
- A partir de ce qui a été dit ci-dessus, il serait naturel que le lecteur pose une
question dans le genre de celle-ci: «Si le système de valeurs et le système de codage de
l'information ne sont réellement que des aspects d'un même phénomène central, comment
traduiriez-vous des énoncés faits dans les termes de l'un de ces systèmes en énoncés dans
les termes de l'autre ?» En effet, seule une réponse adéquate à cette question
pourrait nous montrer clairement ce que nous voulons dire ici en parlant des deux aspects
du système. C'est ce que nous allons essayer maintenant.
Quel que soit le genre de communication que nous prenions en considération, que ce soit
la transmission d'impulsions dans un système nerveux ou bien la transmission de mots dans
une conversation, il est évident que chaque message qui transite a deux sortes de
«signification» [117; 155]. D'une part, ce message est un énoncé ou un rapport
sur des événements d'un moment antérieur et, d'autre part, c'est un commandement - une
cause ou une stimulation pour ces événements à un moment ultérieur.
Considérons le cas de trois neurones A, B et C disposés en série de sorte que le
fonctionnement de A conduise au fonctionnement de B, et que le fonctionnement de B
déclenche celui de C. Même dans ce cas extrêmement simple, le message transmis par B a
les deux sortes de significations indiquées ci-dessus [105]. D'une part, il peut être considéré comme un
«rapport» sur le fait que A a fonctionné à un moment précédent et, d'autre part, c'est un
«ordre» ou une cause du fonctionnement ultérieur de C.
La même chose est vraie de toute communication verbale et, par le fait, de toute
communication quelle qu'elle soit: quand A parle à B, quels que soient
206
les mots qu'il utilise, ils auront ces deux aspects: ils parleront à B de A, véhiculant
de l'information sur quelque perception ou quelque connaissance portée par A, et ils
seront une cause ou un fondement d'actions ultérieures de B.
Dans le cas du langage, cependant, la présence de ces deux significations peut être
obscurcie par la syntaxe. Les paroles de A peuvent avoir la syntaxe d'un commandement, ce
qui voilera partiellement les aspects de rapport. Par exemple, A peut dire «Halte !»
et B peut obéir à ce commandement en ignorant les aspects informationnels - par exemple,
le fait que les paroles de A indiquent quelque perception ou quelque autre processus
mental dont son commandement est une indication. Ou bien les paroles de A peuvent avoir
la syntaxe d'un rapport et B peut manquer de remarquer que ce rapport l'a influencé dans
une certaine direction.
Ce double aspect que revêt toute communication est naturellement un lieu commun de
l'entretien psychiatrique; il est, en fait, également pour une grande part à la base de
toutes les différences qui existent entre ce qui est conscient et l'inconscient. Il est
constant que le patient ne se rende compte que d'un seul des aspects de ce qu'il est en
train de dire - que ce soit le «rapport» ou le «commandement» - et le psychiatre est
constamment en train d'attirer son attention sur celui des aspects qu'il préférerait ne
pas reconnaître. A l'inverse, il n'est pas rare que le psychiatre, et souvent
délibérément, influence le patient par des commentaires et des interprétations qui ont
l'apparence d'un rapport, mais qui, en fait, exercent de l'incitation sur le malade. Quoi
qu'il en soit, du point de vue de la présente étude, nous indiquons clairement que toute
communication a cette dualité d'aspects et nous remarquons qu'il demeure important de
rechercher lequel de ces deux aspects est perçu par les consciences sélectives du
thérapeute et du patient respectivement, dans le contexte donné.
Si nous revenons maintenant à la question de traduire des énoncés sur le codage de
l'information en énoncés sur le système de valeurs, il semble que cette traduction
comporte exactement le même type de difficulté que l'on trouverait dans la tâche qui
consisterait à traduire les aspects de rapport du message de A en son aspect de
commandement. On peut résumer cette difficulté
207
de la façon suivante: la traduction est impossible si l'on n'a pas une totale connaissance
du mécanisme psychologique de B. Si A dit que le chat est sur le paillasson, l'observateur
peut prédire les réponses de B à cette information seulement dans la mesure où il connaît
les habitudes psychiques de B, spécialement son évaluation des chats et des paillassons,
et les inhibitions qui peuvent l'empêcher d'agir comme il aimerait agir.
Dans la discussion ci-dessus, une inexactitude a pu s'insinuer. La question était: comment
traduire ces énoncés émis dans le système de codage de A en énoncés dans le système de
valeurs de A ? Mais à cette question a été substituée une question différente, celle
de prédire ce que sera le contenu de stimulation ou de commandement du message de A tel
qu'il sera reçu par B. Par analogie, nous avons comparé d'une part l'individu intégré qui
à la fois perçoit et agit et d'autre part une relation qui implique deux individus: l'un,
A, qui perçoit, code et transmet l'information, et un autre, B, qui réagit à cette
information. Toute comparaison de ce genre est tout simplement trompeuse. En effet, notre
thèse est la suivante: c'est précisément cette inexactitude qui est impliquée dans toutes
les tentatives de distinction entre le système de valeurs d'un individu et son système de
codage. Toutes les tentatives de traduction d'un système dans un autre conduiront
inévitablement à quelque inexactitude de ce genre: elles amèneront à décrire l'individu
comme s'il était deux personnes séparées dont l'une perçoit et l'autre agit.
Essayons maintenant, par conséquent, de rassembler les deux moitiés de l'individu. Nous
pouvons dire qu'il perçoit et qu'il agit en fonction de sa perception; mais ces deux
indications sont effectivement inséparables. Les seules données que nous avons sur la
façon dont il code des événements extérieurs sont dérivées de ses réactions (les rapports
introspectifs n'étant qu'un cas spécial parmi d'autres réactions). Les réactions sont, en
fait, une nouvelle étape de codage, une autre transformation complexe dérivée des
événements originaux. Deux étapes de codage ou de transformation sont survenues entre les
événements extérieurs et la réaction de l'individu à ces événements, et l'observateur n'a
accès qu'au «produit» (au sens mathématique du terme) des deux stades qui sont surimposés.
À partir de ce produit, il n'est pas possible d'arriver à quelque connaissance que ce soit
208
de l'un des stades en tant que processus séparé. Si l'individu étudié commet des erreurs
évidentes dans sa réaction à des événements extérieurs (ce qui est fréquent chez des
patients), l'observateur n'a aucun moyen de savoir où réside l'erreur. Le sujet peut
avoir mal «perçu» les événements, ou bien il peut avoir traduit des perceptions correctes
en actions erronées: mais laquelle de ces deux erreurs a été commise ? C'est ce que
l'observateur extérieur ne peut pas dire. On ne peut pas répondre à cette question, qui
est donc irréaliste.
- Ceci, donc, serait notre conclusion en ce qui concerne la nature de la relation entre
codage et évaluation: ces deux processus peuvent intervenir séparément, mais, si l'on veut
en discuter d'une façon rigoureusement scientifique, il faut les traiter comme un unique
processus et les étudier à travers les caractéristiques complexes de la relation entre
l'entrée (c'est-à-dire le stimulus) et la sortie (c'est-à-dire la réaction) de l'individu.
- Mais il y a aussi ce point: qu'il soit réaliste ou non de séparer ces deux aspects du
processus unique, les êtres humains dans les cultures occidentales parlent et agissent
effectivement comme si les deux processus étaient séparables. A tort ou à raison, l'idée
que la valeur et le codage sont des phénomènes différents modifie le comportement en
psychiatrie. Les êtres humains, dans leur interaction en thérapie et dans la vie
quotidienne, font réciproquement des inférences sur leurs valeurs et leurs motivations;
ils formulent ces inférences (pour autant qu'ils prennent la peine de les formuler) en
termes de valeur et de perception - c'est-à-dire en des termes qui présupposent une
division dans ce qui, d'après l'argumentation que nous développons, devrait être maintenu
sous le titre «codage-évaluation». Dans un passage ultérieur, nous exposerons que ce sont
spécifiquement ces inférences qui sont cruciales dans le changement thérapeutique.
- Enfin, il nous faut dire un mot sur la conscience, non pas pour résoudre les vieux
problèmes soulevés par cette étrange donnée subjective, mais plutôt pour indiquer comment
ces problèmes sont reliés au schéma conceptuel que nous présentons ici. Quel que puisse
être le fondement mécaniciste ou psychique de
209
ce phénomène, il est certainement un cas spécial de codage et de simplification
réductrice de l'information sur certaines parties de la vie psychique plus générale. Il
est naturellement vrai que la présence de la conscience dénote une extraordinaire
complication du psychisme; et beaucoup d'inadaptation et de problèmes humains surviennent
à partir du reflet dans le champ de la conscience d'une partie seulement du psychisme
total. Mais il semble pourtant évident que le contenu de la conscience est une extrême
réduction du riche continuum que constitue la totalité des événements psychiques. Toute
réduction de ce genre est une transformation ou un codage dans le sens même où ce terme
est employé ici, et, comme dans tous les autres cas de codage, la nature de la
transformation n'est pas elle-même susceptible d'introspection directe ou de contrôle
volontaire. Ceci est effectivement le point que nous voulons souligner. Alors que le
sentiment (peut-être illusoire) de libre arbitre est en liaison étroite avec l'expérience
subjective de la conscience, le processus par lequel les éléments sont choisis pour être
focalisés dans le miroir de la conscience est lui-même un processus inconscient. Ce
processus n'est à aucun moment susceptible d'être soumis à l'exercice de la volonté. Avec
le temps, un individu peut «s'entraîner» à diverses sortes particulières de conscience,
et, dans cette mesure, il peut modifier le codage des idées entrant dans la conscience,
mais, à un instant donné, le déterminisme de cet instant-là est apparemment complet.
De nombreuses écoles de thérapie ont pour prémisse que le changement thérapeutique est
en fait un changement dans l'étendue et dans le contenu de la conscience, et la question
a, par conséquent, son importance dans notre étude. Pour le moment, cependant, le
problème de tels changements peut être reformulé comme suit: la personne qui «s'entraîne»
le fait comme un résultat de son expérience antérieure - notamment de son expérience
interpersonnelle - qui a déterminé sa capacité et sa motivation à entreprendre des
changements de ce genre. De tels changements se produisent en thérapie et il nous faut
donc nous interroger sur les événements interpersonnels et les contextes de thérapie qui
motivent ou qui facilitent ces changements. En bref, l'introduction de la conscience
comme concept ne modifiera pas profondément le type de question que nous étudions ici.
210

INTÉGRATION SÉLECTIVE ET
INTÉGRATION PROGRESSIVE ET CONTINUE
Nous allons maintenant porter notre attention sur certaines des caractéristiques
de l'ensemble du processus global de «codage-évaluation». Ceci devrait nous permettre
de nous interroger sur les changements qui surviennent dans ce processus - de tels
changements sont, en effet, selon notre hypothèse, essentiels en thérapie.
En gros, il semble y avoir deux sortes de processus qui interviennent dans le courant
général de codage-évaluation. On peut les distinguer à partir de deux exemples contrastés.
Le premier de ces processus, nous l'appellerons décision par intégration sélective et
nous en donnerons comme exemple un homme qui est en train de faire un choix parmi un
certain nombre d'objets. Pour faire ce choix, il identifie les objets spécifiques comme
des pommes, des poires, des oranges, etc.; et, par son expérience passée, il sait
lesquelles il aime et il sait quelles actions et quelles gratifications accompagneront
le fait de manger l'une ou l'autre sorte. S'il y a un fruit inconnu dans la qualité,
celui-ci également sera identifié, comme «inconnu», et c'est une catégorie qui aura une
valeur positive ou négative, cette valeur étant également déterminée par ses expériences
antérieures. Dans ce processus d'intégration sélective, l'homme classe et évalue des
alternatives en fonction d'impressions provenant de son passé. Il compare et différencie
des éléments d'un présent spécifique et unique, selon son vécu, avec d'autres éléments de
son passé personnel également unique.
A l'opposé, c'est un processus de décision entièrement différent qui semble
intervenir, par exemple, chez un danseur qui improvise. Pour tout mouvement donné
au sein d'une séquence de mouvements, il est évident qu'il y a un certain type
de choix qui intervient, et ce genre de décision est différent du fait de choisir
un fruit d'une espèce donnée. Le choix du danseur est influencé, dans une très large
mesure, par les caractéristiques ambiantes
211
de sa séquence d'action, et même, peut-être, par la séquence en cours d'un ou d'une
partenaire. Ce second type de choix, c'est ce que nous appellerons décision par
intégration progressive; et nous prolongerons cet exemple en disant que ce phénomène ne
se limite pas à des activités impliquant un mouvement physique rapide; mais le mouvement
du danseur est cependant un modèle adéquat pour caractériser l'état de toute personne
dont les actions impliquent un mouvement complexe relativement rapide dans l'«espace
psychologique». Il semble que ce type d'intégration progressive soit une caractéristique
plus particulière des séquences d'action composées de gestes dont le détail est
imparfaitement différencié et catégorisé, et où la rapidité de décision est importante.
Aussi bien le processus sélectif que le processus progressif sont probablement l'un et
l'autre présents dans une certaine mesure dans toute décision humaine. L'homme qui est en
train de choisir un fruit est partiellement influencé par les séquences ambiantes de son
propre métabolisme, par sa préférence pour certaines séquences de goût et par les
intrications de la courtoisie environnante entre lui-même et toute autre personne
présente. Dans cette mesure, il agit par intégration progressive et continue.
D'une façon correspondante, le danseur peut envisager des actions alternatives (y
compris l'alternative de cesser de danser) et introspectivement il peut penser qu'il
fait un choix parmi ces catégories.
En général, il semble que le phénomène sélectif ainsi que le phénomène progressif
puissent survenir chacun dans un cadre défini par l'autre: après que l'on a décidé de
manger un certain fruit, les détails de l'action de manger peuvent être déterminés
progressivement dans le cadrage de la décision sélective. Et, à l'opposé, dans des
décisions progressives continues qui impliquent de longs laps de temps, il est
courant qu'un individu agisse sélectivement à chaque stade et qu'il découvre qu'il
a graduellement pris une décision majeure (par exemple le choix d'une profession)
par quelque processus progressif.
Il est clair aussi que les personnes sont différentes quant à l'importance relative de
l'un et l'autre de ces deux processus pour chacune d'elles. Certains essaieront d'agir
sélectivement dans des contextes où les relations temporelles et les actions sembleraient
demander l'intégration progressive; d'autres se laisseront
212
guider par un élan psychologique progressif même dans des contextes où les
alternatives auraient pu être plus conventionnellement évaluées en catégories. D'un point
de vue thérapeutique, il est important de remarquer que certains types de patients
auraient avantage à apprendre à catégoriser l'univers tandis que d'autres doivent
apprendre à agir plus librement en termes d'intégration progressive.
Il semble que diffèrent aussi avec les cultures les proportions dans lesquelles les
individus vivent en fonction de l'une ou l'autre de ces modalités. Selon les cultures
diffèrent également les relations entre ces deux modes. Dans la culture balinaise, par
exemple, la structure du caractère de l'individu semble être codée en termes de
kinesthésie et de sensibilité tactile plutôt qu'en fonction de zones érogènes. Il est
manifeste que les catégories de l'intégration sélective sont alors nécessaires pour
mettre tout individu à même de déterminer quel type de séquence d'action progressive
serait à enchaîner. Les catégories sélectives de l'organisation sociale, dans la culture
balinaise, sont les prémisses majeures dans le cadre desquelles l'individu peut se
comporter très librement par intégration progressive. Il lui faut connaître la caste de
l'individu auquel il s'adresse avant de commencer quelque conversation que ce soit. Il
lui faut connaître la nature du contexte dans lequel il se trouve à ce moment-là; mais,
une fois que ces catégories sont déterminées, il est libre d'agir avec une spontanéité
progressive que beaucoup d'Occidentaux peuvent envier. Les cultures occidentales semblent
souvent véhiculer une catégorisation compulsive des détails du comportement alors
qu'elles laissent à l'individu une assez grande liberté d'agir en termes d'intégration
progressive en ce qui concerne les décisions plus importantes. Ces généralisations sont
cependant susceptibles d'être inversées ou modifiées d'un individu à l'autre.

LA DIVERSITÉ DES CODAGES
Comme nous le signalions précédemment, il y a des différences entre les gens: leurs
propres paroles ou leurs propres actions,
213
ainsi que celles des autres, leur suscitent plus ou moins de perceptions et de réactions
par leur aspect «rapports» ou par leur aspect «ordres». De même varie la proportion dans
laquelle ils fonctionnent sélectivement ou progressivement. La partie de notre exposé que
nous présentons ici tient compte de ces deux catégories de différences individuelles; et
nous tentons de présenter un schéma suffisamment général et abstrait pour classer tout
ce qu'il est concevable que les individus élaborent comme sortes de codage-évaluation.
Ce serait une tâche surhumaine de vouloir énumérer toutes les variétés de codage
et d'évaluation des humains. C'est pourquoi nous nous contenterons d'esquisser ici
une grille de classement dans le cadre de laquelle pourront être faites des mises
en relation de nombreuses catégories - et cette tâche ne devrait pas dépasser
les possibilités de nos esprits.

(figure 1) |
Si l'on veut élaborer un schéma de ce genre, il convient de prendre pour point de départ
un modèle plus simple que le modèle humain et qui sera totalement incapable de faire les
codages et évaluations complexes caractéristiques chez l'homme. Nous pourrons ensuite
élaborer nos idées en anthropomorphisant délibérément et systématiquement le modèle.
C'est un modèle de ce genre que propose la figure 1; elle représente le modèle minimal
dont on puisse parler significativement. Les flèches représentent des chaînes causales et
tout le diagramme représente une entité qui consiste en un circuit causal interne
autocorrecteur sur lequel agit un environnement et qui agit sur lui.
214
Le lecteur qui désire un tableau plus complet peut imaginer, s'il lui plaît, soit un
protozoaire engagé dans un tropisme positif, soit un servomécanisme engagé dans la
poursuite d'une cible. En tout cas, quelle que soit l'image que l'on s'en fait, il est de
toute façon incapable des codages et évaluations complexes qui sont du domaine de la
présente étude. Tout au plus peut-il distinguer des éléments de l'environnement
(«lumière», «pas de lumière», etc.), mais certainement il ne sera pas capable de
conceptualiser des notions telles que «Je perçois de la lumière», «Je vois de la
lumière», «La perception de la lumière est un plaisir», ou bien «La lumière m'oblige à
aller vers elle». Dans les actions et les autocorrections de systèmes de ce genre à
tropismes simples, on ne peut pas percevoir de principes évaluatifs de ces niveaux assez
élevés et ce sont des principes de ce genre que nous cherchons à classer. Ce modèle,
donc, est utile en ce sens qu'il nous laisse carte blanche[NT 1] pour un cheminement systématique vers l'anthropomorphisme.
Ultérieurement, nous essaierons de considérer le cas plus complexe de l'interaction
entre deux modèles de ce genre, et nous nous interrogerons sur les possibilités de codage
et d'évaluation dans les processus d'interaction entre des personnes. Ici, dans une
intention heuristique et de simplification, nous nous occupons d'abord des organismes en
rapport avec un environnement impersonnel et nous examinons des types de complexité qui
sont concevables dans ce cas simple mais réel.
Les catégories suivantes de codage-évaluation se présentent: elles sont énumérées dans
un ordre logique (nous ne suggérons pas que l'évolution s'est faite dans cet ordre).
- Discrimination d'entite's perçues dans la partie du circuit total que nous appelons
l'environnement. Nous nous référons ici à la reconnaissance dans l'environnement de
Gestalten et à la délimitation de celles-ci («chênes», «lumière», etc.). Cette
catégorisation est triviale en ce qui concerne notre présente étude parce qu'il est
relativement aisé dans le cours de la communication entre des personnes d'aplanir des
malentendus à ce niveau, et qu'il est particulièrement facile de le faire quand on peut
215
adjoindre à la communication verbale le fait de désigner des objets et des événements. En
répertoriant les diversités des codages possibles, nous remarquons que les Gestalten
perçues par l'organisme sont en tout cas arbitraires, mais interdépendantes.
L'organisme est libre, comme l'est d'ailleurs le scientifique, de délimiter les systèmes
et les entités qu'il lui plaît dans le monde extérieur; mais, une fois que certaines
entités ont été discriminées, les classements ultérieurs se feront en fonction du système
de discrimination dans lequel l'organisme est déjà engagé par ses distinctions antérieures.
S'il a discriminé «des chênes» et «de la lumière», la distinction entre «des aulnes» et
«des chênes» ainsi que celle entre «le bleu» et «le rouge» s'ensuivront probablement.
- Subdivision du sous-circuit que nous appelons l'organisme. Nous nous référons
ici à la reconnaissance et à la discrimination par l'organisme de parties du corps, de
sensations, d'actions et autres. A ce stade, il devient possible d'associer des
sensations à des parties du corps et peut-être de conceptualiser des buts en fonction de
la localisation des sensations - déjà une conceptualisation plus fine de la totalité de
l'interaction entre l'organisme et l'environnement. Peut-être à ce stade devient-il
possible que des parties de l'image du corps soient falsifiées et que ces falsifications
soient projetées sur d'autres parties du circuit total, en particulier dans l'environnement.
- Subdivision du circuit total en deux parties, le Soi et l'environnement. Dans
l'ontogenèse, cette étape est sans doute facilitée par la présence d'autres organismes
similaires et par la reconnaissance que ceux-ci sont semblables à soi; et il est possible
qu'on ne puisse parvenir à aucune conception de soi en l'absence d'autres organismes
similaires. Mais, quoi qu'il puisse en être, la différenciation de soi et de
l'environnement peut se concevoir sans la présence d'autres organismes et par conséquent
nous en discuterons ici. Une distinction de ce genre, comme toutes celles auxquelles nous
avons affaire, est en un certain sens arbitraire et sa nature arbitraire est claire si
l'on considère le modèle simplifié avec lequel nous avons commencé. L'organisme que nous
imaginons est libre de tracer une ligne fermée n'importe où sur
216
ce diagramme et de considérer comme «Soi» tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette ligne
et au contraire de considérer comme «environnement» tout ce qu'il y a à l'extérieur;
l'utilité effective de ce modèle fait ressortir cette liberté.
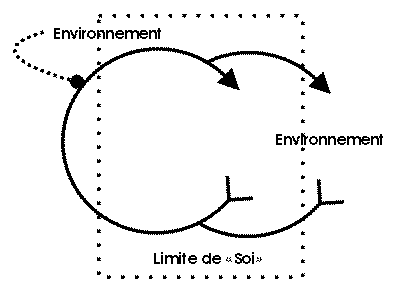
(figure 2) |
La figure 2 représente le cas où l'organisme inclut à l'intérieur d'un «Soi» divers
objets et divers événements qui sont à l'extérieur de sa peau, mais se trouvent
intimement reliés à lui. Il inclut le cas également où il désigne comme appartenant à
l'environnement certaines des parties ou des fonctions de son corps sur lesquelles il
ressent qu'il n'a pas de contrôle. Il n'existe en fait aucune façon de se délimiter qui
soit juste; l'échec de la communication, la frustration et finalement l'hostilité et la
pathologie peuvent provenir de ce que des organismes qui ont des prémisses conflictuelles
à ce sujet cherchent à communiquer. En outre, leur communication sera rendue d'autant
plus difficile que probablement ni l'un ni l'autre ne sera pleinement conscient de ce
qu'il inclut lui-même dans sa notion de «Soi». Être à même de conceptualiser: «J'inclus
ceci et cela dans mon "Soi"», est une performance déjà beaucoup plus complexe que le
simple: «Je suis et il y a des choses qui ne sont pas moi.» La reconnaissance de
phénomènes de conceptualisation sera étudiée plus loin.
217
- Conceptualisation du contrôle entre soi et l'environnement. Ceci est encore
une autre étape au-delà de la simple différenciation entre Soi et l'environnement. Cette
étape amène l'organisme à percevoir l'environnement comme coercitif ou à se considérer
lui-même comme coercitif envers l'environnement - chacune des deux conceptions étant
généralement une simplification erronée de l'interaction réelle. La diversité des codages
inclura toutes ces attributions de passivité et d'activité au Soi et à l'environnement.
- Conceptualisation d'arcs de causalité séparés à l'intérieur de soi. Nous nous
référons ici à des prémisses telles que: «Je suis le maître de mon âme», ainsi qu'à la
dichotomie de l'esprit et du corps. Il se peut que chacune de ces prémisses soit dérivée
d'un codage qui identifierait peut-être des parties de l'organisme lui-même comme
«environnementales», combinées avec des prémisses sur le contrôle de l'environnement ou
par l'environnement. En fait, il est probable que la division interne de l'individu soit
un écho symbolique des relations présumées entre soi et l'environnement.
- Multiplicité des niveaux d'abstraction. Dans le paragraphe précédent, nous
avons introduit une étape d'un genre spécial. Nous avons supposé que l'organisme peut
adopter, comme dispositif pour coder des relations entre des arcs de causalité à
l'intérieur de soi, certaines prémisses antérieurement utilisées dans le codage entre soi
et l'environnement. Nous remarquons en passant qu'une telle façon de faire, qui repose
sur l'analogie, peut très bien induire en erreur, mais que cela ne se produit pas
obligatoirement. Ce sont, en fait, la possibilité et la nature de démarches de ce genre
dans le codage qui nous intéressent plutôt que leur validité. En somme, l'organisme
perçoit la Gestalt A et la Gestalt B et code en supposant qu'il y a une
relation (de similitude ou de non-similitude) entre A et B. Cette procédure implique soit
explicitement, soit implicitement un plus haut niveau d'abstraction que celui impliqué
dans le codage primaire des deux Gestalten. La «similitude ou non-similitude» est
plus abstraite que la Gestalt A ou la Gestalt B. Par des démarches de ce
genre, le système de codage de l'organisme devient de plus en plus élaboré et peut
comporter de nombreux niveaux d'abstraction
218
dont les interrelations sont susceptibles d'une grande diversité.
- Gestalten qui impliquent des durées différentes. L'organisme peut
considérer qu'un mouvement isolé est un «acte»; il peut aussi bien voir des séquences
entières d'événements, en même temps y compris ses propres actions et les résultats de
ces actions, comme constituant une unité en relation avec une finalité ou avec un échec.
Il peut même conceptualiser en même temps avec les limitations de sa propre vie, et, avec
des notions de ce genre étendues symboliquement, il peut voir une cérémonie d'initiation,
ou même sa propre expérience thérapeutique, comme une sorte de mort ou de renaissance.
- La réification des concepts. Finalement, l'organisme peut utiliser son propre
système de codage de différentes façons. Dès que la complexité atteinte est suffisante
pour permettre deux ou plusieurs niveaux d'abstraction, l'organisme devient susceptible
de traiter des abstractions d'un niveau plus élevé comme si elles étaient équivalentes
à des abstractions d'un moindre niveau. En bref, l'organisme peut réifier n'importe
quel concept dans le cadre de toute la gamme qui a été énumérée ci-dessus; il peut
aussi doter le concept, par exemple, d'efficacité causale ou de contrôle. La «moralité»
(qui est une abstraction tirée des actions et des paroles de soi-même et des autres)
peut être considérée comme une contrainte pour ses propres actions; l'organisme peut
respecter les «conventions culturelles» ou il peut se révolter contre elles; il peut
même railler ou répudier la mort (une abstraction sur laquelle il ne peut, en
l'occurrence, avoir aucune information subjective).
Ce très bref examen des niveaux de complexité du codage et de la diversité de ses
possibilités servira à préparer le lecteur à une généralisation: c'est que tout organisme
peut commettre de nombreux types d'erreurs dans son codage et dans ses interprétations du
monde. La partie qui suit va essayer de définir quelques-unes de ces catégories d'erreurs.
219

CONTRADICTIONS INTERNES DU CODAGE-ÉVALUATION
Le passage qui précède était un exposé sur la diversité que l'on peut rencontrer dans
le flux de codage et d'évaluation; mais nous nous sommes arrêtés avant de prendre en
considération les contradictions qui peuvent survenir dans des systèmes de ce genre.
Nous introduisons maintenant un degré de complexité complémentaire: nous affirmons
qu'il est compréhensible que la contradiction (c'est-à-dire l'ambivalence) survienne dans
n'importe lequel des types de codages qui ont été esquissés: elle peut se produire à tous
les niveaux d'abstraction, et une contradiction donnée peut effectivement concerner deux
ou plusieurs de ces niveaux. Dans la vie quotidienne comme dans l'expérience psychiatrique,
on observe couramment qu'une personne peut voir et évaluer des événements semblables d'une
certaine façon dans un ensemble de circonstances et d'une façon différente dans un autre
concours de circonstances. La différence de situation qui détermine un changement de ce
genre peut être soit interne (par exemple un changement d'humeur), soit externe (ce que
l'on peut approuver et valoriser en temps de guerre peut être considéré avec horreur en
temps de paix). Des difficultés surgissent lorsque l'individu ne réussit pas à porter une
attention suffisante au contexte de son évaluation et s'il fait équivaloir, par exemple,
certaines actions pertinentes en temps de guerre avec certaines actions similaires en
temps de paix. Il crée ainsi pour lui-même un concept ou une Gestalt (par exemple
la «violence») qui sont chargés à la fois de valeur positive et de valeur négative.
Peut-être les humains pourraient-ils éviter les complications des conflits intérieurs
et des conflits avec les autres s'ils étaient capables de rester lucides quant aux
contextes de leurs perceptions et de leurs évaluations. Mais c'est quelque chose à quoi
ils ne peuvent pas parvenir. S'il était possible de ne jamais confondre un type donné
d'événement (E1) dans un certain ensemble de circonstances internes et externes (C1) avec
220
des événements semblables (E2) dans d'autres ensembles de circonstances (C2), tout
irait bien. Mais ceci est impossible si l'on ne veut pas sacrifier tout le codage
de type Gestalt. Le prix que l'homme paie pour l'économie que procure le
codage Gestalt, c'est que celui-ci véhicule le risque d'ambivalence. Après
tout, la grande économie que permet ce type de code est précisément due au fait
que cela nous met à même d'identifier El avec E2 (par exemple, de reconnaître
un carré comme un carré bien qu'il nous soit présenté de différentes façons). Le
codage en termes de Gestalten nous permet de résumer l'expérience et c'est
du fait que l'expérience est résumée que provient l'ambivalence.
En outre, une seconde sorte de contradiction interne dans le système de
codage-évaluation découle du fait que tout résumé est une condensation arbitraire des
données non résumées. Toute étiquette de Gestalt est une catégorisation faite par
l'homme d'événements dans un univers où ils pourraient être catégorisés de façons
infiniment diverses. Dans l'instant même de la perception ou de l'action, l'individu
applique de nombreuses étiquettes de ce genre à l'ensemble donné d'événements ou
d'objets. Inévitablement, il y aura des cas où les étiquettes se chevaucheront et
véhiculeront une valeur contradictoire ou des implications contradictoires pour l'action.
En raison de la variété des contradictions internes de ce genre qui peuvent se produire,
toute possibilité de passer en revue tout l'ensemble des ambivalences possibles est
peut-être sans espoir; cependant, puisque l'on peut définir quelques types avec une
certaine rigueur, nous en ferons la liste.
- Il y a des cas où les Gestalten qui sont utilisées se chevauchent au même
niveau d'abstraction. On peut décrire ces cas avec un diagramme. La figure 3 représente
un univers d'objets et d'événements tels qu'un individu les perçoit, y compris, entre
autres, les propres actions de cet individu lui-même. À l'intérieur de cet univers, il
perçoit un sous-ensemble d'éléments comme constituant une unité en Gestalt A; il
perçoit également un sous-ensemble différent qui forme aussi une autre unité en
Gestalt B. Eh bien, s'il y a des éléments qui sont communs à A et à B et si A est
valorisé positivement alors que B est valorisé négativement, le résultat sera une forme
d'ambivalence. Les éléments dans la zone de chevauchement seront valorisés positivement
221
quand ils seront perçus comme des parties de A, mais ils seront valorisés négativement
quand ils seront perçus comme des parties de B.
Dans ce type de contradiction, il est important de remarquer qu'il n'y a pas nécessairement
tendance à ce que la perception de la Gestalt A favorise la perception de la
Gestalt B, ou vice versa; nous nous attendrions plutôt à ce que la perception
de l'une gêne la perception de l'autre. Il est cependant facile d'imaginer des exemples
dans lesquels la perception de l'une de ces Gestalten puisse orienter l'individu
vers la perception de l'autre. Ce seraient là des cas intermédiaires entre les premiers
types de contradiction et les seconds que nous allons maintenant décrire.
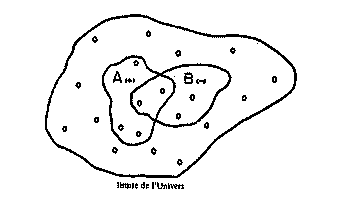
(figure 3) |
- Il y a des cas qui sont comparables dans leur forme au fameux paradoxe de Russell [177]. On peut présenter ce paradoxe de la
façon suivante: l'homme répartit des entités en classes, et chaque classe qu'il définit
établit une classe d'autres entités qui ne sont pas membres de la première. Il remarque
que la classe des éléphants n'est pas elle-même un éléphant, mais que la classe des
non-éléphants est elle-même un non-éléphant. Il généralise que certaines classes sont
membres d'elles-mêmes alors que d'autres ne le sont pas. Par conséquent, il établit deux
222
classes de classes plus grandes. Il lui faut alors prendre une décision: est-ce que la
classe des classes qui ne sont pas membres d'elles-mêmes est un membre d'elle-même ?
Si la réponse à cette question est «Oui», alors il s'ensuit que cette classe doit
être l'une de celles qui ne sont pas membres d'elles-mêmes, puisque tous les membres sont
de ce type - et, par conséquent, il faut que la réponse, en fait, soit «Non». Si, par
contre, la réponse est «Non», alors il faut que la classe soit un membre de cette autre
classe dont c'est la caractéristique que ses membres sont membres d'elle-même - il faut
donc que la réponse soit «Oui»; et ainsi de suite. Si la réponse est «Oui», il faut
qu'elle soit «Non» - mais, si c'est «Non», alors il faut que ce soit «Oui».
Un autre paradoxe qui a essentiellement la même structure est celui de l'homme qui dit:
«Je mens.» Est-ce qu'il dit la vérité ?
Un modèle mécanique d'un système oscillant ou paradoxal de ce genre peut être utile au
lecteur. La sonnette électrique courante d'une maison peut fournir un tel modèle. Cet
appareil consiste en un électro-aimant qui agit sur une armature (un ressort métallique
léger) à travers laquelle doit passer le courant qui active l'aimant. L'armature est
disposée de telle façon que le courant est interrompu chaque fois que l'aimant est activé
et fait courber le ressort. Mais le courant est rétabli par le relâchement du ressort
quand l'aimant cesse d'agir. Nous pouvons traduire ce système en propositions logiques en
donnant des noms aux positions du ressort: nous appellerons «Oui» la position du ressort
qui ferme le circuit; et nous appellerons «Non» la position opposée qui interrompt le
circuit. Nous pouvons alors énoncer les deux propositions suivantes:
- Si le ressort est sur «Oui», le circuit est fermé et l'électro-aimant opère; par
conséquent, le ressort doit aller à «Non».
- Mais, si le ressort est à «Non», l'aimant n'opère pas, et par conséquent le ressort
doit aller à «Oui».
C'est ainsi que les implications de «Oui» sont «Non» et que les implications de «Non»
sont «Oui». Ce modèle constitue une illustration précise du paradoxe de Russell dans la
mesure où le «Oui» et le «Non» sont l'un et l'autre utilisés à deux niveaux d'abstraction.
Dans la proposition A, «Oui» réfère à la position, tandis que «Non» réfère à la direction
du changement; dans la proposition B, «Non» réfère à
223
la position, tandis que «Oui» réfère a la direction du changement. Le «Non» auquel «Oui»
est une réponse n'est donc pas le même que le «Non» qui est une réponse à «Oui».
De la même façon, le paradoxe présent dans l'énoncé «Je mens» peut être rapporté à une
confusion de niveaux d'abstraction. Les deux mots, qui sont tout ce dont nous disposons,
sont simultanément et à la fois un énoncé (niveau 1) et un énoncé (niveau 2) sur la
fausseté du premier énoncé; et le second énoncé est d'un ordre d'abstraction plus élevé
que le premier. Dans la présentation formelle du paradoxe par Russell en termes de «classes
de classes», les niveaux d'abstraction sont devenus explicites et le paradoxe est élucidé.
Nous consacrons ici un certain développement à cette question des paradoxes parce
qu'il est impossible d'aller loin dans la pensée sur la communication et le codage sans
se précipiter dans des enchevêtrements de ce type; et de tels enchevêtrements d'abstraction
sont courants dans les prémisses de la culture humaine (chapitre
VIII) et chez les patients en psychiatrie. En fait, c'est ce type de contradiction
interne que Korzybski [90] et l'école de
la sémantique générale essaient de corriger dans leur thérapie. Leur traitement consiste à
entraîner le patient à ne pas confondre ses niveaux d'abstraction. En fait, leur traitement
suit les lignes de la résolution du paradoxe que Russell a tentée par l'assertion de la
règle qu'aucune classe ne doit jamais être considérée comme un membre d'elle-même.
Le lecteur, s'il soumet sa propre pensée à cheminer à travers le paradoxe russellien,
observera qu'un élément de temps est impliqué. Pendant un moment, il est satisfaisant
d'accepter la réponse «Oui»; mais il observera que, alors qu'il perçoit les détails plus
intimes de la forme (Gestalt) établie par cette réponse, il est poussé à la
rejeter. Alors, pour un moment, la réponse «Non» est acceptable, jusqu'à ce que ses
implications soient aperçues, et ainsi de suite.
Du point de vue psychologique, cette caractéristique temporelle est importante: il ne
s'agit pas d'un phénomène d'indécision statique, mais d'un phénomène d'«oscillation» dans
le temps. Il est probable que dans la vie courante chacun a eu des expériences dans
lesquelles une familiarité accrue avec une Gestalt conduit à la rejeter en faveur
de quelque autre qui, ensuite, à son tour,
224
devient inacceptable. Ce sont, en fait, des systèmes de contradiction dans lesquels
l'occupation temporaire de l'un des pôles promeut la préférence pour l'autre, et vice
versa. Tenter de résoudre le conflit en faveur de l'une de ses polarités engendre
ipso facto une préférence pour le pôle opposé. Le mécanisme est par conséquent très
différent de celui dont nous avons parlé ci-dessus au point 1, bien que l'on puisse
concevoir que les deux mécanismes fonctionnent en combinaison.
- Une troisième forme de contradiction interne apparente dans le système de
codage-évaluation est celle de la préférence circulaire [106]. Quand les possibilités sont présentées par paires,
il peut survenir que: A est préféré à B; B est préféré à C; et C est préféré à A. Dans un
système de ce genre, on peut présumer qu'il y a impossibilité de décision quand les trois
possibilités sont présentes simultanément. Les données concernant des systèmes de
préférence de cette sorte sont maigres, mais le phénomène est d'une grande importance
théorique. On dit que ce phénomène se produit dans des expérimentations sur les
préférences esthétiques - par exemple quand des rectangles sont présentés par paires et
que l'on demande au sujet d'exprimer une préférence pour un membre de chaque paire.
Les mécanismes impliqués dans la préférence circulaire peuvent être divers:
- Il se peut que, dans la Gestalt «A + B», l'évaluation de chaque membre soit
fonction de la présence de l'autre; de sorte que, lorsque B est présenté en présence de C
et que l'on veut la Gestalt «B + C», B sera évalué différemment et peut-être selon
des critères différents.
- Le mécanisme de décision peut consister en des entités à liaisons multiples ayant
chacune sa propre affinité. Le mécanisme de décision total serait alors quelque chose comme
le vote d'une population; et il est notoire que, dans de tels systèmes, s'il y a trois
votants (ou trois partis égaux), il est possible à l'électeur qui n'envoie pas de candidat
à l'élection de déplacer la décision sur celui des deux autres candidats qu'il préfère.
- McCulloch a présenté un type possible de circuit nerveux produisant un résultat
semblable; et l'on obtient un phénomène apparenté dans les solutions alternatives de
certains types de jeux de von Neumann [168].
225
On ne sait pas s'il y a d'autres types de contradictions internes ou si toutes peuvent
être finalement réduites aux trois sortes que nous venons de mentionner ci-dessus.

COMMUNICATION À SENS UNIQUE: L'OBSERVATEUR NON OBSERVÉ
Avant d'examiner le cas plus complexe de deux ou plusieurs organismes qui communiquent
entre eux, il vaut la peine de se demander comment une personne qui observe à son insu un
organisme isolé pourrait faire des inférences sur le système de codage-évaluation de cet
organisme. Le cas de cette communication unilatérale, involontaire, nous préparera à une
généralisation importante applicable à des cas plus complexes.
Si, par exemple, l'observateur voit l'organisme se déplacer en ligne droite vers une
certaine cible telle qu'une source lumineuse, cette observation limitée ne le mettra pas
en mesure d'être certain ne serait-ce que d'un simple tropisme. Même la répétition
d'observations de ce genre ne lui permettra de vérifier qu'une hypothèse très générale
que la coïncidence entre la direction du mouvement de l'organisme et la direction dans
laquelle se situe la lumière est due à quelque chose de plus que le hasard. Il ne saura
pas si la direction du mouvement est choisie par quelque processus interne de
l'organisme. Pour en apprendre plus, ou bien il faut que l'observateur fasse des
expériences réitérées, ou bien il faut qu'il observe de façon répétitive que l'organisme
se corrige à chaque fois que la course dévie de la direction de la cible. De plus, il
sera nécessaire que les expérimentations de l'observateur se fassent d'une manière qui
consiste à placer l'organisme dans l'erreur (par exemple, il mettra la lumière quelque
part ailleurs que dans la direction où l'organisme est en train d'aller et il regardera
alors ce que fera cet organisme). Et de ceci il découle que les données que l'observateur
obtient par l'expérimentation sont du même type général que celles qu'il obtiendrait en
observant les autocorrections du sujet dans des circonstances variées.
De cette argumentation ressort principalement la conclusion suivante:
226
c'est que la correction des erreurs est un moyen fondamental de communication; c'est
effectivement l'unique sorte de communication qui permettra à un observateur non observé
de faire des inférences sur le système de codage-évaluation de celui qu'il observe.
Un cas particulier est intéressant: celui dans lequel un organisme qui est en train
d'accomplir une certaine action se parle à lui-même et est entendu par l'observateur;
mais ce cas n'invalide pas l'argumentation précédente.
- Si ce langage n'est pas familier à l'observateur, le seul moyen dont celui-ci dispose
pour parvenir à comprendre sera de considérer le comportement verbal et les séquences
d'action de l'observé comme un seul et unique système d'autocorrection en fonctionnement.
De cette façon, il finira par découvrir ce que les mots veulent dire et chaque émission
verbale aura une signification en ce sens qu'elle aura été choisie par l'observé dans un
processus d'autocorrection. L'observateur apprendra, en fait, les polarités du codage
dans le langage; il sera capable d'attribuer à chaque mot une signification positive dans
la mesure où le mot délimite un ensemble d'alternatives niées.
- L'observateur peut connaître déjà partiellement ou complètement le langage de
l'observé; il aura alors tendance à fonctionner en s'identifiant lui-même à ce dernier et
en lui attribuant sa propre compréhension des mots utilisés. Ce faisant, ou bien il
n'apprendra rien de nouveau sur le système de codage du sujet, ou bien il découvrira
qu'il est lui-même en train de faire des erreurs d'interprétation de ce qui est dit; en
ce qui concerne ces parties du système de codage-évaluation de l'observé, il sera en fait
dans la position d'ignorance du langage. Dans tous les cas, à moins que le courant verbal
ne soit accompagné par l'action, et qu'il soit autocorrecteur, par rapport à l'action,
l'observateur ne sera pas à même d'apprendre quoi que ce soit sur le langage.
Cette généralisation fait écho à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la
nature du système de codage-évaluation. On a indiqué alors que, aussi bien en codage
qu'en évaluation, l'univers est structuré en réseau. Dans le cas du codage, il s'agit
d'un réseau dont les nœuds sont les discriminations bipolaires ou multipolaires de la
perception; dans le cas de l'évaluation, le réseau a des ramifications qui définissent
la polarisation des préférences. En étudiant les erreurs et les autocorrections de
227
l'organisme, l'observateur est, en fait, en train de recueillir les données nécessaires
pour établir un repérage des polarités de tels réseaux. Il apprendra - quoique
laborieusement - quelles discriminations peut faire l'organisme, à partir de quels
indices il agit, quelles caractéristiques de ses propres actions il peut percevoir,
comment le système d'action est relié aux indices donnés, etc.

COMMUNICATION INTRAPERSONNELLE L'AUTO-OBSERVATION
Une question de très grande importance théorique et pratique dans le domaine de la
psychiatrie est celle de l'observation de soi-même et de l'autothérapie. Une question du
même ordre s'impose aux anthropologues qui savent bien qu'il est particulièrement
difficile à un étudiant de parvenir, de l'intérieur de sa propre culture, à comprendre
celle-ci. Les anthropologues d'aujourd'hui s'accordent à penser qu'une compréhension
intime et détaillée de sa propre culture ne peut être obtenue que par la méthode
comparative. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'homme n'est parvenu que tardivement
au cours de son histoire à la compréhension de ses propres prémisses culturelles; ce qui
l'y a aidé, c'est la comparaison des cultures. Il est naturel, en la matière, de trouver
une analogie entre l'anthropologie et la psychiatrie. On suggère que la nécessité d'une
approche comparative en anthropologie est comparable au besoin que l'on a en thérapie
d'une autre personne qui soit différente de soi-même; et en comparaison avec laquelle nos
particularités puissent ressortir sur cet arrière-plan. Cette analogie, toutefois, ne
peut pas être poussée trop loin. Ce qui est curieux, c'est que, alors que la question
particulièrement importante de la formation d'un anthropologue est d'avoir une expérience
directe d'une culture totalement étrangère, ce qui correspond à ceci dans la formation
d'un psychiatre, c'est sa propre psychanalyse.
Il y a des divergences d'opinions quant à ce qu'un individu peut faire pour essayer de
comprendre sa propre personnalité s'il n'est aidé par aucun thérapeute; et le problème se
complique encore du fait que, à l'évidence, un progrès thérapeutique peut,
228
dans certaines circonstances, survenir sans qu'on le comprenne. Il est possible qu'un
thérapeute soit nécessaire s'il faut que le patient arrive à comprendre, mais que
d'autres types de progrès puissent intervenir sans cette compréhension.
Dans la présente étude, les problèmes de l'auto-observation ont leur place:
ils font partie de la plate-forme à partir de laquelle nous pourrons continuer
notre investigation de la communication interpersonnelle. En bref, la question
est celle-ci: quelles sont les limites de l'auto-observation comme processus par
lequel un individu peut parvenir à une nouvelle compréhension, ou obtenir de
l'information sur son propre système de codage-évaluation ?
Le problème a de nombreuses ramifications:
- Il serait souhaitable de décrire les phénomènes d'auto-observation d'une façon qui ne
personnifie pas un soi à l'intérieur du Soi.
- La question appelle à définir ce que l'on entend par «nouvelle» compréhension qui soit
distincte de l'élucidation de contradictions préexistantes à l'intérieur du système de
codage-évaluation de l'individu.
- Il faut examiner d'une façon formelle les limites réelles de la découverte de
soi-même qui proviennent du fait qu'un individu ne peut - obligatoirement - percevoir sa
propre vie et ses propres actions que dans les termes de son propre système de codage et
évaluation. 11 est en tout cas incapable de percevoir les caractéristiques du système en
fonction duquel et à travers lequel il perçoit.
De ces problèmes, c'est le troisième qui présente un intérêt particulier du point de
vue de la présente étude. Le problème épistémologique de la conscience et de la nature du
soi à l'intérieur du Soi, nous proposons de le différer, car il est pour le moment hors
de portée de l'investigation scientifique. On a effectivement suggéré que l'expérience
subjective de la conscience est déterminée par le conflit ou par la contradiction interne.
Une telle hypothèse ôterait partiellement du champ de l'épistémologie le problème de la
conscience et le placerait dans le domaine de la seconde des questions que nous avons
posées ci-dessus - celle de l'élucidation des contradictions internes préexistantes.
Cette seconde question peut être renvoyée après la troisième qui présente l'avantage
229
heuristique d'une plus grande simplicité. Si nous pouvons repérer des limites aux
possibilités de l'autoperception, dans un organisme qui n'a pas été rendu complexe
par la contradiction interne, ces limites seront appropriées pour la prise en
considération de cas dont la complexité est plus grande.
Nous considérons maintenant les possibilités d'autoperception d'un organisme non
conflictuel. Ici encore, pour des raisons heuristiques, nous prenons d'abord le cas d'un
organisme dans un environnement tel que les prémisses de codage-évaluation internes à
l'organisme sont justes et qu'elles sont suffisantes pour l'environnement dans lequel il
vit. Un organisme hypothétique de ce genre parviendra toujours à ses buts, précisément au
moyen des sortes de codage et d'autocorrection qui constituent les caractéristiques mêmes
de cet organisme; et il ne s'attaquera à aucun objectif impossible. La question est de
savoir si, à partir d'une telle automaticité séquentielle de réussites, l'organisme ne
pourra jamais accéder à une nouvelle compréhension (insight) de ses propres
processus automatiques d'autocorrection.
La réponse est certainement tout à fait négative. De tout ce que l'on sait sur
l'apprentissage, il découlerait que, dans l'hypothèse d'un cas de ce genre, non
seulement aucune compréhension nouvelle ne se produirait, mais en outre aucun
apprentissage de quelque sorte que ce soit ne surviendrait non plus. En fait,
ce cas hypothétique dont nous discutons ici est précisément celui du joueur
abstrait de la théorie de von Neumann. Si, au contraire, il y a des contradictions
non pas internes à l'organisme mais entre les prémisses de l'organisme et celles
qu'il obtient de l'environnement, alors la position est entièrement différente.
Nous savons, à la suite des expérimentations des comportementalistes, que, dans des
cas de ce genre, un organisme qui se trouvait antérieurement agir en fonction d'un
certain système de prémisses pourra, après une période d'essais et d'erreurs,
commencer graduellement ou soudainement à agir comme si c'était en fonction d'un
autre système, différent et plus pertinent. En outre, nous savons, par les rapports
introspectifs, qu'un apprentissage de ce genre peut être accompagné d'un changement
dans la perception consciente que l'organisme a de l'environnement.
Ceci, à nouveau, est un problème d'erreurs et de correction d'erreurs semblable à
celui dont nous avons parlé dans le passage précédent. L'organisme a été «induit en
erreur» par l'environnement
230
et la question est maintenant: Quel ordre d'information nouvelle l'organisme peut-il
obtenir comme résultat de son passage à travers toute l'expérience de frustration et
d'autocorrection et étant parvenu à ce nouveau système de codage et d'évaluation grâce
auquel la frustration est réduite ? Ayant été mis dans l'erreur, l'organisme se
corrige, non seulement en modifiant ses actions, mais en modifiant - plus ou moins
profondément - les processus et les mécanismes de base par lesquels les actions sont
reliées aux indices de l'environnement. L'erreur corrigée dans cette séquence est d'un
ordre très différent de l'acte d'autocorrection qui caractérisait l'organisme à l'issue
de l'expérience. L'organisme a maintenant modifié son système d'autocorrection. Les
considérations suivantes sont applicables si l'on compare le processus thérapeutique et
les modifications du système auxquelles peut parvenir un organisme isolément.
- Le changement dans un organisme isolé, dans la mesure où c'est une amélioration de
l'adaptation, peut être considéré comme thérapeutique.
- On sait par expérience que, si l'organisme ne réussit pas à ajuster ses prémisses aux
conditions de l'environnement, ce peut être antithérapeutique, et ceci peut conduire à la
névrose expérimentale. C'est-à-dire que l'organisme peut être affecté du fait de l'échec
- il peut, dans ce sens, avoir de l'information sur l'échec.
- Il est peu probable que les anciennes prémisses soient totalement oblitérées à
l'occasion de ce changement. Il est plutôt probable qu'elles survivent sous une forme
modifiée ou «réprimée». Il est possible, en fait, que l'organisme, à un certain stade du
processus d'apprentissage - et peut-être définitivement par la suite -, entretienne des
prémisses conflictuelles avec toutes les complications qui peuvent s'ensuivre.
- Il se peut que l'organisme acquière une nouvelle compréhension de l'environnement,
mais il est douteux qu'il obtienne une nouvelle compréhension de lui-même. Il se peut
qu'il y ait un apprentissage secondaire, c'est-à-dire un apprentissage de l'apprendre ou
un apprentissage sur l'apprentissage (cf. chapitre VIII)
- de sorte que l'organisme, lorsqu'il sera à nouveau mis dans l'erreur, sera, par exemple,
moins inquiet en raison d'une confiance accrue en son aptitude à traiter de telles
infortunes. Mais il est problématique que ceci soit une augmentation
231
de la compréhension de soi. En effet, il est très douteux qu'un tel développement puisse
survenir comme résultat des changements qui ont été considérés ici.
Avant l'expérience, l'organisme percevait ses propres actions d'une certaine manière
déterminée par les prémisses qui existaient alors; après l'expérience, il se percevra
lui-même et il percevra ses propres actions en fonction des nouvelles prémisses. Mais
ce n'est pas un changement dans l'ordre de l'autoperception tel que nous puissions
crier: «Eurêka.» L'étape suivante - voir le soi comme une entité qui a manifestement
accompli ce changement - ne se produit pas obligatoirement. Un changement dans les
prémisses de codage-évaluation ne dénote pas nécessairement une plus grande
compréhension de ces prémisses, à moins que l'individu puisse voir ce changement
comme un contraste, se comparant lui-même avec ce qu'il était précédemment. En faisant
ce genre de comparaison, il agit essentiellement comme deux personnes entre lesquelles
on peut opérer une distinction, et une méthode comparative est appliquée, qui mène à
une compréhension accrue: il est en train de faire quelque chose qui, normalement,
se produit dans un système de deux personnes.
Il apparaît donc que, d'une façon ou d'une autre, quelque sorte de système de deux
personnes sera toujours nécessaire pour une thérapie de compréhension, mais peut-être pas
pour d'autres types d'apprentissage. Il nous faut cependant aussi nous attendre à ce que
d'autres types d'apprentissage, souvent eux-mêmes thérapeutiques, surviennent dans la
situation à deux personnes, même si la présence de la seconde personne peut ne pas être
nécessaire. Nous avons maintenant une base suffisante pour porter notre attention sur un
système de deux personnes.

COMMUNICATION ENTRE DEUX PERSONNES ET MÉTACOMMUNICAT1ON
La démarche suivante consiste à étendre ce qui a été dit dans les parties précédentes
aux phénomènes des relations entre deux ou plusieurs personnes - des organismes
anthropomorphiques. Le problème primordial dans une communication de ce genre a
232
été posé d'une façon pertinente par Janet Baker (à l'âge de dix ans), comme ceci:
Quand les gens ont pensé à un langage, comment y ont-ils pensé s'il n'y
avait pas de mots pour y penser ? Après qu'ils y ont pensé, comment ont-ils amené
d'autres personnes à le comprendre ? S'ils sont allés de porte en porte en
expliquant, les gens ont dû penser qu'ils étaient devenus fous parce qu'ils ne savaient
pas ce que les mots voulaient dire. Après le commencement du premier langage, comment ont
été formés les autres ? Ces questions font que je me dis: «Je me demande comment les
gens ont appris à parler» [10].
Cette façon de présenter la question conduit à l'ultime problème auquel mène la
présente investigation; mais il faut se rappeler qu'entre des êtres humains bien
portants, après la petite enfance, il ne peut jamais y avoir une absence totale de
compréhension de part et d'autre. Il est certain qu'il peut y avoir des malentendus, et
ceux-ci peuvent être profonds et dramatiques au point de paraître absolus, mais, en fait,
même pour que survienne un malentendu, il faut qu'il existe quelques prémisses de
codage-évaluation qui soient communes, partagées. Il faut bien que chaque personne ait au
moins quelques notions sur elle-même et sur l'autre; il faut bien, par exemple, qu'elle
pense que tous deux sont semblables en ce qu'ils sont vivants et capables d'émettre et de
recevoir de la communication. En fait, si le malentendu engendre de l'hostilité, il est
immédiatement évident qu'il faut bien qu'il existe des prémisses en commun concernant la
colère et la douleur. L'amorce d'un système de codage commun est latente dans notre
nature biologique, dans notre anatomie commune et dans notre expérience commune du
fonctionnement du corps et de sa maturation. Quand deux êtres humains se rencontrent, ils
partagent inévitablement de nombreuses prémisses sur de nombreux sujets tels que les
membres, les organes sensoriels, la faim et la peine.
En ce qui concerne les indices extérieurs, il est notoirement évident que, parmi les
oiseaux, les poissons et les invertébrés, les membres d'une espèce peuvent partager une
tendance innée à répondre d'une manière complexe à un indice particulier spécifiquement
défini ou à une séquence d'indices - une odeur, une
233
forme, une taille, une tache de couleur, et ainsi de suite - émanant d'autres individus.
Ce genre de réponse mutuelle peut orendre l'apparence d'une interaction progressive
continue. Par exemple, chez les épinoches, il y a entre les sexes un échange
comportemental de ce genre qui mène à la reproduction. Chaque sexe dispose d'une série de
réponses spécifiques différenciées à échanger. La réponse de chaque partenaire est un
stimulus pour une nouvelle réponse de la part de l'autre, jusqu'à ce que, finalement, le
mâle féconde la femelle et reste avec les œufs pondus par elle dans le nid qui a été
construit [184].
Dans le cas des mammifères, et particulièrement de l'homme, il semble que ce genre de
tendances innées à répondre d'une manière complexe et différenciée à des indices
extérieurs hautement spécifiques, ou bien soit très peu développée, ou bien ait été
transformée ou estompée par les apprentissages ultérieurs. L'équipement instinctif de
l'homme est recouvert par des élaborations culturelles, mais il reste encore, commun à
l'espèce, un certain nombre de tendances à répondre de façon globale et diffuse à
certains stimuli globaux et diffus tels que de grands bruits, la perte de supports, la
chaleur ou le froid, la douleur, et ainsi de suite.
En outre, tous les êtres humains, telle que nous connaissons l'espèce aujourd'hui,
partagent la notion que le langage et les gestes sont des moyens de communiquer[1], même si chaque culture a des variantes
spécifiques de ces moyens [184]. Au sein
même de la culture, le poète peut avoir sur l'utilisation du
234
langage des prémisses extraordinairement différentes de ce que sont celles de personnes
appartenant aux milieux de la publicité. Un danseur peut avoir un ensemble d'idées sur
l'emploi de la posture pour la communication, alors que le catatonique en a d'autres; et
cependant tous deux partagent l'idée que la posture est communicationnelle et, à un
certain niveau d'abstraction, leurs deux systèmes de communication se rejoignent
probablement sur de nombreuses prémisses communes concernant le corps. Si les personnes
qui s'opposent appartiennent à la même culture, elles partageront aussi quelque vague
reconnaissance - même déformée - des points sur lesquels elles diffèrent.
Dans cette étude, nous nous intéressons particulièrement à la communication entre des
personnes qui ont en commun une grande quantité de vocabulaire et qui partagent
l'ambiance du contexte culturel américain; ce sont des personnes qui ont vécu une grande
partie de leur vie dans la variante américaine de la culture occidentale. Et cependant,
dans le cas du patient et du thérapeute, il peut y avoir une très profonde différence
entre leurs prémisses en ce qui concerne des questions comme celles dont nous avons parlé
précédemment. Il se peut qu'il y ait des différences tranchées dans leurs idées sur les
limites de soi; il est possible que chacun perçoive sa relation aux autres êtres humains
en fonction de sa propre idiosyncrasie. Le paranoïaque peut croire que l'environnement
est tout-puissant et veut obstinément le détruire. Mais il est impossible de prédire
quelle formulation le thérapeute peut faire de sa propre relation à son environnement.
Certains thérapeutes sont désireux de se voir modeler leur vis-à-vis humain et d'autres
ne le sont pas. C'est notre thèse dans ce livre que seulement par la communication peut
se produire la thérapie; et la communication dépendra des prémisses que les deux
personnes ont en commun, ainsi que des complexités du système des deux personnes.
Dans le système interpersonnel émergent certaines caractéristiques qui ne sont pas
significativement présentes dans l'hypothèse du système comportant un seul organisme.
D'abord, chaque organisme reçoit des indices qui ont un niveau de complexité différent
de ceux émis par les objets inanimés. Effectivement, les messages échangés d'une façon
externe entre des organismes doivent être comparés aux processus intra-organiques du
codage et de l'évaluation, plutôt qu'aux données que l'individu récolte dans
235
l'environnement. Nous avons parlé précédemment de l'extraordinaire complexité du codage
intraorganiaue et nous avons alors remarqué que cette complexité est, autant que nous
sachions, obtenue par des signaux nerveux très simples parcourant des cheminements
extrêmement complexes comportant des milliards de nœuds synaptiques. Grâce à ce réseau
nerveux, et peut-être à d'autres parties du corps, l'organisme élabore les unités
complexes de la communication interne que nous appelons Gestalten. Le fait
significatif, pour notre présent propos, c'est que, dans la communication
interpersonnelle, les unités et les assemblages de messages parviennent à ce même niveau
parce que les mots et les postures réfèrent déjà à des Gestalten complexes qui
correspondent à certaines de celles qu'utilisé le système interne. La communication entre
des personnes est naturellement pathétiquement appauvrie si on la compare à la richesse
de la conscience intrapersonnelle, qui, à son tour, n'est qu'une version appauvrie et
restreinte de la totalité de la vie psychique de la personne. Mais pourtant il est
important que la communication externe soit un codage de la vie psychique interne et que
le destinataire d'une communication de ce genre reçoive un produit déjà élaboré par la
vie psychique d'un autre individu. En ceci, la communication interpersonnelle diffère
profondément de toute perception de l'environnement inanimé. L'individu qui perçoit doit
synthétiser ses données sur l'environnement inanimé et il a une certaine liberté de le
faire d'une manière idiosyncrasique tandis qu'au contraire, en recevant une communication
d'une autre personne, verbale ou autre, il a moins de liberté parce que la matière du
message est déjà synthétisée en Gestalten (mots ou phrases) par l'émetteur. Même
la compréhension du message par le récepteur est fonction du fait qu'il s'est habitué aux
conventions de codage étroitement définies que la culture impose.
Chaque individu reçoit, naturellement, des données sensorielles du type ordinaire
concernant l'autre; chacun voit et entend l'autre comme une entité physique. Mais en
outre chacun reçoit du partenaire de la matière symbolique, verbale ou autre; chacun a
par conséquent l'opportunité de combiner ces deux types de données en un unique courant
plus complexe, enrichissant le flux verbal avec des observations simultanées des
mouvements corporels et autres. On a suggéré plus haut que, dans les processus
236
intrapersonnels, le corps pourrait servir de fonction analogique complétant les processus
plus digitaux de l'activité nerveuse. Nous remarquons ici que les processus corporels de
l'autre personne - ses postures, son tonus, sa coloration ou autres - contribuent à une
fonction correspondante dans la communication interpersonnelle. Chaque personne est en
mesure d'obtenir une perception multidimensionnelle de son vis-à-vis et d'enrichir le
courant des symboles uniquement verbaux par l'identification des processus corporels de
l'autre; et ces symboles sont plus ou moins intelligibles en fonction de l'arrière-plan
biologique commun et du conditionnement culturel.
Ceci mérite d'être illustré et nous évoquerons un détail curieux qui rend
la séance psychanalytique freudienne orthodoxe différente de la plupart des
systèmes de deux personnes.
Quand le malade est sur le divan et l'analyste sur une chaise en retrait de sa tête, le
docteur a une vue passable, mais qui peut être suffisante, des postures et des expressions
faciales du patient, tandis que ce dernier est empêché de voir son thérapeute. Les
dissymétries qui sont introduites dans la situation thérapeutique par cette disposition
sont sans doute très complexes et varient sûrement d'un thérapeute à l'autre et d'un
malade à l'autre. Mais, du point de vue de la présente discussion, il est significatif que
le patient ne reçoive de l'analyste que des messages verbaux et qu'il dispose ainsi d'un
maximum de latitude pour échafauder une image fantasmatique des aspects affectifs de la
personnalité de l'analyste. Cette image pourra être étudiée ultérieurement dans l'analyse
du transfert. Au début, le patient, en fonction de ses habitudes enracinées, tente de
faire des inférences sur l'analyste de façon à adapter ses paroles à la mesure de cette
personne. Peut-être découvre-t-il ensuite au cours de la séance thérapeutique qu'un tel
ajustement est difficile et il est alors ramené à des paroles et à des actes
«authentiques» que l'introjection de telles images ne stimule qu'a minima.
Une autre caractéristique émerge du système interpersonnel alors qu'elle était
négligeable dans la simple relation limitée de l'organisme et de son environnement: c'est
que l'existence même du groupe est l'un des déterminants des actions et des
communications des personnes individuellement. La relation entre organisme et
environnement est déjà une interaction et, dans un
237
système dynamique tel qu'un homme en train de conduire une automobile, ou bien un homme en
train de marcher ou de danser, aU neut ne'ttement reconnaître une totalité en interaction
qui détermine effectivement des fonctionnements des parties constitutives. Mais, avec un
système de deux personnes, une nouvelle sorte d'intégration intervient. La condition pour
qu'il existe un groupe déterminant dans ce sens semble être que chaque participant ait
conscience des perceptions de l'autre. Si je sais que l'autre personne me perçoit et si
elle sait que je la perçois, cette conscience mutuelle devient une partie déterminante de
toute notre action et de l'interaction. Au moment où s'établit une telle prise de
conscience, l'autre et moi constituons un «groupe déterminant» et les caractéristiques de
processus progressif dans cette entité plus grande contrôlent dans une certaine mesure les
deux individus. Ici encore deviendront efficaces les prémisses culturelles partagées.
Sur l'évolution de «groupe» dans ce sens, on trouve peu d'informations, mais la question
d'une évolution de ce genre vaut la peine d'être examinée, ne serait-ce que pour souligner
que le groupe ainsi défini en tant que conscience de se percevoir mutuellement est quelque
chose de différent des groupes qui sont simplement déterminés par l'irritabilité mutuelle
ou par des réponses réciproques. Dans le cas des épinoches, mentionné précédemment, il y a
des réponses mutuelles complexes, mais aucune évidence qui indiquerait que tel individu
est conscient de la perception de l'autre. De même, dans la communication élaborée que
von Frisch a étudiée chez les abeilles, il n'y a pas de raisons de croire qu'une telle
conscience se produit. Il est probable que cette étape de l'évolution est survenue pour
la première fois chez les mammifères et peut-être que ce phénomène ne se produit que chez
les primates et chez les animaux intimement domestiqués par l'homme.
Cette question mérite une investigation critique.
Opérationnellement, pour déterminer si un groupe s'élève à ce niveau, il serait
nécessaire d'observer au moins si chaque participant modifie son émission de signaux
d'une manière autocorrectrice selon que les signaux sont probablement audibles, visibles
pu intelligibles ou non pour les autres participants. Chez les animaux, l'autocorrection
de ce genre est certainement inhabituelle.
238
Chez les hommes, elle est souhaitable, mais pas toujours présente.
Il serait important également d'identifier chez les animaux des signaux
des types suivants:
- des signaux dont la seule signification serait la reconnaissance d'un signal
émis par un autre;
- des signaux qui demanderaient qu'un signal soit répété;
- des signaux indiquant que la réception d'un signal a été manquée;
- des signaux qui ponctuent le courant de signaux, etc.
En cas de connaissance complète de la perception de l'autre, un individu devrait
cesser de répéter un signal après qu'il a été reçu et que sa réception a été confirmée
par l'autre individu, et ce type d'autocorrection indiquerait la conscience de se
percevoir mutuellement. Parallèlement, l'absence d'une telle adaptation - que l'on peut
souvent observer chez les gens - dénoterait une connaissance imparfaite de la perception
de l'autre, excepté dans les cas où un certain changement dans la signification ou dans
l'intensité est véhiculée par la répétition du message. Enfin, la motivation à falsifier
délibérément peut difficilement exister sans la connaissance de la perception par l'autre
individu, non plus que la probabilité que la falsification réussisse. Ainsi, l'occurrence
de la falsification devient une évidence que le groupe est un groupe qui repose sur la
conscience de se percevoir mutuellement[3]. Tous ces critères de l'existence
d'une perception mutuelle contribuent à élaborer un tableau d'un ordre entièrement
nouveau de communication qui émerge avec cette conscience. Pour désigner ce nouvel ordre
de communication, nous introduisons ici le terme «métacommunication» et nous le
définissons comme «communication sur la communication». Nous décrivons comme
métacommunication tout échange d'indices et de propositions sur a) le codage et
b) la relation entre ceux qui communiquent.
Nous supposerons qu'une majorité des propositions sur le codage sont aussi des
propositions implicites sur la relation et vice versa, de sorte que l'on ne peut
tracer une ligne bien nette
239
entre ces deux sortes de métacommunication. De plus, nous nous attendrons à trouver que
les qualités et les caractéristiques de I métacommunication entre les personnes dépendront
des qualités et du degré de la conscience qu'elles ont de leurs perceptions mutuelles.
L'existence de ce genre de conscience peut se reconnaître en observant le fait que
l'individu autocorrige des signaux qu'il émet (et tous les critères ne sont effectivement
que des cas particuliers d'une telle autocorrection); il en découle que certaines des
caractéristiques attribuées à l'autre individu acquièrent une valeur déterminante dans la
formation et la motivation du comportement de l'émetteur. Les signaux sont modulés en
fonction de ce que celui qui émet pense de celui qui reçoit. Et c'est à partir de ceci
que l'on peut comprendre ce qui s'en est suivi de l'évolution d'un certain nombre
d'habitudes et de caractéristiques humaines - l'introjection, l'identification, la
projection et l'empathie. La possibilité pour un être humain d'exercer de la contrainte
sur un autre devient même fonction d'une perception correcte ou incorrecte de l'idée que
l'autre se fait de l'univers.
Cette discussion sur l'importance de l'inférence interpersonnelle introduit pour le
système de deux personnes une série d'autres variables significatives qui n'étaient pas
apparues dans l'hypothèse des systèmes impliquant seulement une personne.
Quand le système se compose de deux personnes, il est possible qu'elles soient semblables
ou dissemblables quant aux caractéristiques de leur codage. Elles peuvent se ressembler dans
la façon dont elles perçoivent l'univers et dans la façon de réagir à cette perception ou
bien elles peuvent être différentes à cet égard. La nouvelle variable que nous remarquons
est donc l'indication de similitude ou de dissimilitude entre les deux personnes.
Une autre variable différente qui émerge seulement quand deux personnes communiquent
indiquera si les prémisses des deux personnes sont en conflit ou non. Il est évidemment
possible que, bien que deux personnes soient très semblables, les points mêmes sur
lesquels elles se ressemblent puissent être cause réciproque de conflit. Si, par exemple,
ils ont l'un et l'autre des visées expansionnistes, ces visées peuvent bien coïncider et
la rivalité et la jalousie peuvent bien se développer. En effet, comme les éducateurs le
savent bien, l'établissement d'une relation
240
compétitive entre des personnes est l'une des méthodes les plus efficaces pour former les
participants à percevoir et à évaluer d'une même façon l'univers commun dans lequel ils
vivent. Plus formellement, ce sont des cas dans lesquels la formulation que fait «A» de
la relation entre le «Soi de A» et une partie de l'environnement est apparemment la même
que la formulation de «B» de la relation entre la même partie de l'environnement et le
«Soi de B». Tous deux peuvent dire: «C'est ma formulation.» Et des formulations de ce
genre sont en fait différentes parce que les deux «Soi» ne coïncident pas.
A l'inverse, quand deux personnes ont à l'évidence des formulations différentes de
l'univers, elles ne sont pas nécessairement en conflit. Il est possible que ces positions
soient complémentaires, de sorte qu'une «concordance» survient [149] et les deux individus peuvent être à même de
coopérer dans une relation asymétrique. Ceci se produit, par exemple, dans les relations
entre des personnes de sexe opposé. Et il est remarquable que, dans des cas de ce genre,
il n'est même pas nécessaire que chacune des personnes comprenne l'univers de l'autre,
bien qu'il puisse être important qu'ils reconnaissent le fait de la différence. Au-delà
de cette reconnaissance, il se peut que les efforts pour comprendre mènent à un échec de
communication. Ce sont ici toutefois des questions qui ne peuvent guère être étudiées
séparément du rôle de la matrice culturelle qui sera examinée au prochain chapitre.
[NT 1] En français dans le texte [NdT].
[1] En ce qui concerne les questions
cybernétiques qui sont évoquées ici, je veux exprimer ma gratitude à la Fondation Josiah
Macy Junior qui a patronné une série de colloques à ce sujet auxquels j'ai pu participer.
Je veux également exprimer ma gratitude aux docteurs McCulloch, Wiener, Pitts, Hutchinson
et aux autres participants de ces colloques dont la pensée a fortement influencé la mienne.
[2] Le regretté docteur Stuterheim, anthropologue
officiel à Java, avait l'habitude de raconter l'histoire suivante. Peu de temps avant
l'arrivée de l'homme blanc, il y eut une tempête sur les côtes de Java dans le voisinage
de l'une des capitales. Après la tempête, les gens sont descendus sur la plage et ont
trouvé, trempé par les vagues et presque mort, un grand singe blanc d'espèce inconnue.
Les experts religieux expliquèrent que ce singe avait été membre de la cour de Beroena,
le Dieu de la Mer, et qu'à cause de quelque offense le singe avait été rejeté par le Dieu
dont la colère s'était exprimée dans la tempête. Le Rajah donna des ordres pour que le
grand singe blanc soit conservé en vie, enchaîné à une certaine pierre. Ce fut fait. Le
docteur Stutterheim m'a dit qu'il avait vu cette pierre et que, griffonné grossièrement
dessus, en latin, en hollandais et en anglais, il y avait le nom d'un homme et des
indications sur son naufrage. Apparemment, ce marin trilingue n'établit jamais de
communication verbale avec ceux qui l'avaient capturé. Il n'était sûrement pas au fait
des prémisses qui le cataloguaient comme un singe blanc et par conséquent pas susceptible
de recevoir des messages verbaux. Il ne lui est probablement jamais venu à l'esprit
qu'ils puissent douter de son humanité. Il se peut qu'il ait douté de la leur.
[3] Les falsifications implicites, dans le mimétisme
animal, la coloration protectrice et autres présentent un problème spécial. Ici, selon
les hypothèses orthodoxes, le système correcteur n'est pas l'animal individuellement,
mais c'est le système supérieur de toute l'écologie au sein duquel la sélection naturelle
opère les corrections sur la population.